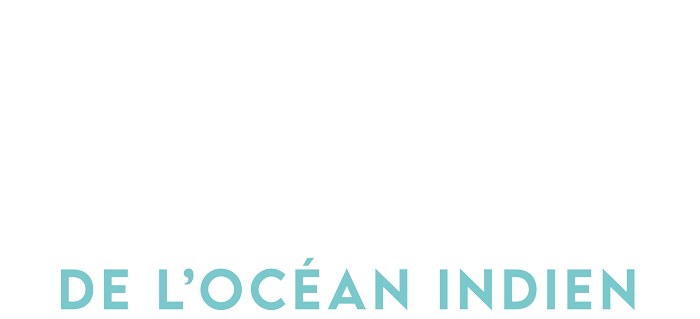Le coco de mer est le plus ancien migrant de l’océan Indien, le premier à avoir laissé supposer, sur les rivages où il venait s’échouer, qu’il existait des pays fabuleux, dont on ne savait rien. Il pèse entre quinze et vingt-cinq kilos, c’est le fruit le plus gros et le plus lourd du monde, comment n’aurait-il pas fait naître les légendes ? Originaire des Seychelles, mais ramassé sur les plages des Maldives, de la côte Malabar, de l’Afrique orientale ou d’ailleurs, il a longtemps exploré, au hasard des vents et des courants, une Indianocéanie qu’il était seul encore à entrevoir. Sorte de géographe avant la lettre, il dessinait en pointillés les contours d’un monde possible au-delà de l’horizon, laissait soupçonner des routes maritimes inconnues de tous, et que lui avait suivies pourtant. À moins qu’il ne vînt de forêts marines qui croissaient dans les profondeurs ? Peut-être aussi était-il doté de pouvoirs magiques ou thérapeutiques précieux ? Peut-être, par ses formes féminines et suggestives, incarnait-il également une étonnante « graine de vie » ?
Bien avant qu’ils aient eu connaissance les uns des autres, le coco de mer a tissé des liens et des rêves entre les pays riverains de l’océan Indien, il a servi de trait d’union mystérieux entre des sociétés voisines qui s’ignoraient. En venant s’échouer sur tant de rivages éloignés des Seychelles, il établissait une relation inattendue entre des pays qui s’interrogent dès alors sur sa provenance, et construisent des hypothèses merveilleuses pour la justifier. Comme les courants le faisaient dériver souvent vers les Maldives, que c’est sur leurs plages qu’on en ramassait le plus, on l’a cru d’abord originaire de cet archipel. Dès 1563, Garcia da Orta1 le nommait coco das Maldivas. En 1609, João dos Santos rapporte que l’on trouve sur les côtes du cap Delgado « des noix de cocos des Maldives2 », et c’est également à cet archipel que Jean Mocquet fait référence pour décrire en 1610 « la noix […] fort grosse, longue et noire en forme de gondole3 ». Pyrard de Laval, longtemps prisonnier aux Maldives après le naufrage du Corbin, rapporte en 1611 ce qu’il a observé par lui-même, « une certaine noix que la mer jette quelquefois au bord, qui est grosse comme la tête d’un homme, […] les Portugais la nomme coco des Maldives4 ». Son origine exacte, l’île Praslin5 aux Seychelles, à plus de 2 000 kms des Maldives, fut établie par Marion-Dufresne en 1768. Dès l’année suivante, Bernardin de Saint-Pierre se fait l’écho de cette découverte dans le Voyage à l’Ile de France : « On vient de trouver à l’île Séchelles un palmier qui porte des cocos doubles, dont quelques-uns pèsent plus de quarante livres6. » Les longues dérives des cocos de mer vont retenir durablement l’attention de Bernardin. Il rappelle à plusieurs reprises dans les Études de la Nature en 1784 que « la mer porte régulièrement chaque année à 400 lieues de là, sur la côte Malabare7, » les cocos des Seychelles, parce que leur improbable voyage entre en résonance avec une question qui le hante depuis longtemps : comment étudier la force et la direction des courants ? Parmi les inconnues susceptibles de dévier gravement la route d’un vaisseau, et donc de compromettre une navigation, les courants figurent en première place. La navigation à l’estime est la seule pratiquée jusqu’à l’invention des chronomètres de marine, que les découvreurs commencent à utiliser dans le dernier quart du XVIIIe siècle. « Il me semble que dans les voyages de long cours, écrit Bernardin, il serait intéressant de tenter quelques expériences pour parvenir à connaître les divers courants de l’Océan8 ». Jeter à la mer des bouteilles contenant un message qui indiquerait leur point de départ, puis essayer de les retrouver lorsqu’elles viendraient à s’échouer sur d’autres rivages lointains, est une expérimentation qui a fasciné Bernardin. Il rapporte en détail les circonstances de trois tentatives qui ont abouti, et en tire des conclusions positives : « Il n’est pas douteux que les routes parcourues par ces trois bouteilles ne déterminent, en grande partie, la vitesse et la direction des courants qui ont régné pendant qu’elles étaient à la mer9 ». Dans une telle perspective, le coco de mer apparaît comme un message naturel, nécessairement providentiel aux yeux de Bernardin, que les courants auraient porté d’un point à un autre. Il constitue une incitation explicite à reproduire l’exemple que la Providence indique précisément comme un mode de communication possible. Les courants pourraient alors permettre à des naufragés10 de faire connaître leur présence aux rivages habités, de même que le coco de mer, venu d’îles lointaines et désertes, a su rejoindre des îles peuplées qui en ont fait bon usage.
Par trop dissemblable, d’origine inconnue, donc troublant, étonnamment gros et lourd, le coco de mer a suscité l’admiration, l’envie, le doute. Quel palmier prodigieux pouvait-il nourrir des fruits d’une telle taille ? Le cocotier commun (que chacun prend spontanément comme référent) portant des grappes de plus de trente fruits parfois, il fallait donc imaginer un arbre au sens propre extra-ordinaire, et dont les noix avaient également la capacité d’extra-vaguer… Comme on ne les trouvait jamais que sur les rivages, ou dérivant en pleine mer, soit elles arrivaient de contrées lointaines et forcément fabuleuses, soit la mer elle-même recelait des forêts étranges… Cette dernière hypothèse a longtemps prévalu. Peut-être les Maldiviens sont-ils à l’origine d’une telle représentation car Pyrard de Laval rapporte qu’ils « tiennent que [le coco de mer] vient de quelques arbres qui sont en la mer11 ». L’explication en tout cas est reprise par les Occidentaux dès leur arrivée, et donnée comme une certitude par Jean Mocquet en 1610 : « On ne voit point l’arbre qui porte ce fruit, assure-t-il, croissant au fond de la mer, mais lorsque la mer est fort agitée, le fruit est porté du fond au-dessus, et le trouve-t-on sur le bord du rivage12 ». En somme, ce sont les tempêtes, et la violence des remous qu’elles occasionnent, qui détacheraient les cocos de leurs palmiers, dans des profondeurs insondables. João dos Santos avait eu connaissance, en Éthiopie, de quelques particularités qui semblent apporter une cohérence, et presque une forme de rationalité, à cette hypothèse fabuleuse : « les noix de coco des Maldives, écrit-il, […] naissent au fond de la mer, sur de très gros palmiers courts qui sont toujours recouverts d’eau, […]13 ». Pendant deux siècles, la même explication surprenante paraît avoir fait du cabotage le long de tous les rivages où les cocos venaient s’échouer, et en 1784, Bernardin écrit encore que, « il n’y a pas douze ans », les habitants de la côte Malabar « les croyaient originaires du fond de la mer, et les appelaient pour cette raison cocos marins14 ».
Si l’on essayait d’imaginer une terre comme lieu d’origine du coco, une île dominée par des sortilèges semblait l’hypothèse la plus recevable. Les Maldiviens montèrent ainsi nombre d’expéditions vers une île Pollouoys qu’ils ne parvenaient pas à atteindre, protégée par des flots si tempétueux que leurs navires ne pouvaient pas même rester à l’ancre. Ils renouvelaient leurs tentatives cependant, car ils croyaient cette île fertile et même avaient « opinion que [les] gros cocos médicinaux, qui sont si chers […] en viennent15 ».
La mer comprise comme espace d’une circulation maritime naturelle bien plus vaste qu’on ne l’avait d’abord supposée, la représentation des fonds marins envisagée comme recelant des richesses exploitables, toute une économie balbutiante mais bien réelle, se trouvent déjà en germe dans la manière dont le coco marin est perçu lorsqu’il touche les côtes de l’océan Indien au XVIIe siècle. La façon dont s’organise son exploitation, la rigoureuse gestion de sa commercialisation, en particulier aux Maldives où le roi s’en attribuait la propriété exclusive, l’ont constitué en « or bleu » avant la lettre.
Si « l’économie bleue » désigne les activités liées à l’océan et aux littoraux, qui deviennent des sources d’échange, d’enrichissement et de croissance, force est de constater que le coco de mer16 a été à l’origine d’une véritable expansion commerciale au XVIIe et au XVIIIe siècles, en particulier aux Maldives et sur la côte Malabar. Rare, inexplicable, inexpliqué, il a focalisé l’intérêt des populations qui le trouvaient sur le rivage, et il est devenu le symbole par excellence du produit de luxe. Dans sa relation du Voyage de Magellan en 1522, Antonio Pigafetta fait déjà du coco marin un présent destiné aux rois : deux cocos semblent avoir été dès cette époque offerts aux rois du royaume de Siam17. C’est également du roi que dépend le négoce des noix aux Maldives, comme le rapporte Carletti dans son Voyage autour du monde en 1606 : « Ces noix sont fort prisées par les populations des Maldives, observe-t-il, et plus encore par leur roi qui interdit qu’on les fasse sortir du pays. C’est pourquoi il en sort peu et l’on n’en voit jamais d’entières, mais de petits morceaux d’amande pris à la dérobée18 ». Car les Maldiviens devaient remettre la noix qu’ils trouvaient au roi, sous peine d’avoir le poing coupé, et lui seul décidait de son éventuelle commercialisation. Ainsi contrôlé, le commerce des cocos lui garantissait la fortune, et parallèlement maintenait très élevé le cours d’un produit rare, recherché même à des milliers de kilomètres des Maldives, en Indonésie, au Japon, en Chine. Comme Pyrard est demeuré dans l’archipel cinq années, il a pu observer les conséquences directes d’une telle mesure, qui aboutit finalement à surveiller et punir la contrebande des noix, voire à accuser à tort d’éventuels contrevenants : « Souvent […] les gens et officiers du roi travaillent de pauvres gens quand ils les soupçonnent en avoir trouvé ; et même quand on veut créer de l’ennui à un homme, on […] l’accuse de cela, afin qu’il en soit recherché […]19 ». Le monopole royal s’avère par conséquent une incitation à la délation, et dans le meilleur des cas, une contrainte forte exercée sur la population, immédiatement spoliée si elle trouve un coco marin20. Le hasard d’une découverte aussi prometteuse que dangereuse, ses conséquences immédiatement visibles si le découvreur garde pour lui le coco qu’il a ramassé en mer ou sur le rivage, sont repérables dans la manière de penser et de s’exprimer : « […] quand quelqu’un devient riche tout à coup et en peu de temps, témoigne Pyrard, on dit communément qu’il a trouvé un [coco de mer] ou de l’ambre, comme si c’était un trésor21 ».
C’en est un. Les cocos marins ont été investis dès l’origine de pouvoirs étranges, bien avant l’arrivée des Européens : « Les Indiens qui […] habitent [la côte Malabar] leur attribuaient des vertus merveilleuses22 », constate à plusieurs reprises Bernardin de Saint-Pierre. Aux Maldives, on en faisait des vases auxquels on prêtait la vertu de rendre inoffensives les boissons empoisonnées que l’on y versait. Le roi vendait ces vases très cher ou en faisait des présents, réputés de grand prix23. Lorsque les voyageurs européens témoignent à leur tour, ils soulignent à l’envi les vertus thérapeutiques dont le coco de mer était déjà crédité par les indigènes. L’amande est « un excellent remède contre le poison et les fièvres malignes » selon Carletti qui, à Goa en 1606, parvient à en acheter six onces à… « des Indiens des Maldives24 » ! Ce qui semble prouver que, malgré les risques de graves représailles, des îliens parvenaient à s’enfuir en Inde où ils commercialisaient pour leur propre compte la noix qu’ils avaient trouvée. Elle constitue également un « grand contrepoison25 » pour João dos Santos en 1609. « […] les Portugais […] tiennent que [le coco de mer] a une grande vertu pour la maladie des poumons, et pour les asthmatiques, et contre les venins26 », rapporte en 1610 Jean Mocquet qui navigue sur leurs vaisseaux. Aux propriétés localement reconnues du coco de mer, se sont donc ajoutées peu à peu des indications nouvelles. « C’est une chose fort médicinale et de grand prix27 », résume Pyrard en 1611.
Le prix a effectivement atteint des sommes particulièrement élevées. « [La noix] s’achète parfois jusqu’à trente et quarante ducats la pièce, rapporte Jean Mocquet, et autrefois elle se vendait davantage que maintenant, pour ne lui avoir trouvé toutes les vertus qu’on lui attribuait28. » Elle n’est donc pas toujours la panacée que l’on avait supposée, et la remarque sanctionne un début de déception. Mais la rareté des cocos de mer, leur origine inconnue, la folle rumeur qui les entourait, tout, de fait, contribuait à entretenir la légende. Les Indiens de la côte Malabar « les estimaient autant que l’ambre gris, et ils y mettaient un prix si considérable que plusieurs de ces fruits y ont été vendus jusqu’à mille écus la pièce29 », rapporte Bernardin. Le coco de mer portait d’ailleurs parfois le nom de « coco de Salomon », puisque les richesses du roi Salomon provenaient d’Ophir, une contrée également mystérieuse qu’on ne savait pas davantage situer. Un voyageur comme Carletti considère quant à lui qu’il a acquis un remède efficace en achetant des fragments d’amande à Goa, il en a fait l’expérience sur lui-même : « […] il m’en reste encore un peu dont j’ai expérimenté et apprécié les vertus, en les diluant après les avoir frottés contre une pierre avec un peu d’eau, comme il est d’usage pour toute chose, partout en Inde, au lieu de broyer30. » Dans les faits, c’est la découverte de l’île Praslin par Marion-Dufresne en 1768 qui a ruiné l’économie fondée sur le coco de mer : les prix chutent avec la brusque arrivée sur le marché indien de noix innombrables, alors qu’elles étaient réputées rarissimes : « […] les Français ayant découvert, il y a quelques années, l’île Mahé qui les produit, rapporte Bernardin, en ont porté une si grande quantité aux Indes, qu’ils leur ont ôté à la fois leur prix et leur réputation31. »
C’était sans compter sur les propriétés définitivement miraculeuses du coco de mer… Depuis longtemps, la forme suggestive de cette graine, qui évoque le bassin d’une femme, avait retenu l’attention. Selon le « principe de signature », qui établit une équivalence entre la forme et l’efficacité d’une plante, les contours étrangement féminins du coco ont laissé supposer qu’il était doté de vertus aphrodisiaques, pour lesquelles il a été recherché très tôt en Extrême Orient, et utilisé dans la médecine ayurvédique. Son appellation change alors, et, plutôt que sa provenance, qui a cessé de nourrir l’imaginaire, c’est sa forme que l’on a soulignée : le coco de mer est devenu le « coco-fesse », le « coco indécent ». À son arrivée à l’Île de France en 1768, l’attention du naturaliste Philibert Commerson s’est tout de suite portée sur un coco-fesse rapporté des Seychelles, et qu’il nomme « Lodoicea callipyge », en référence à Laodice, la plus jolie des filles de Priam, et parce que le qualificatif καλλίπυγος, « qui a de belles fesses », est traditionnellement attribué à Aphrodite32. Un rêve de sensualité se donne désormais libre cours à partir de similitudes que Bernardin exprime pudiquement en latin : « Ce fruit, dépouillé de sa bourre, mulieris corporis bifurcationem cum natura et pillis representat33 », et une relation évidente demeure, jusqu’à nos jours, entre coco-fesse et érotisme. On l’offre aux jeunes mariés aux Seychelles, et la noix continue d’être un cadeau de prix aux propriétés sans nombre. Vide, la coque se marchande autour de trois cents euros, mais à plus de quatre cents euros le kilo si la noix est pleine et la pulpe consommable.
Le coco de mer est donc resté un fruit de légende, une source de rêve et d’inspiration. Quelque chose de son ancienne aura transparaît de nos jours dans la manière dont la sculptrice Marie-Laure Viebel l’a magnifié. En utilisant la technique de la dorure à la détrempe, l’artiste semble faire revivre l’époque où le coco marin valait… de l’or, et, en faisant briller ensuite la noix, qu’elle appelle « graine de vie » et polit avec une pierre d’agathe, elle la met au sens propre « en lumière », réinvente la légende, et multiplie les nouvelles métamorphoses du fruit merveilleux. L’or est en soi symbole d’immortalité, il a à voir avec le soleil et les dieux. Devenu graine de lumière, le coco de mer se fait symbole de la vie, transcende les frontières de la nature, intègre le monde du sacré, et rappelle les lumineuses présences des icônes orthodoxes.