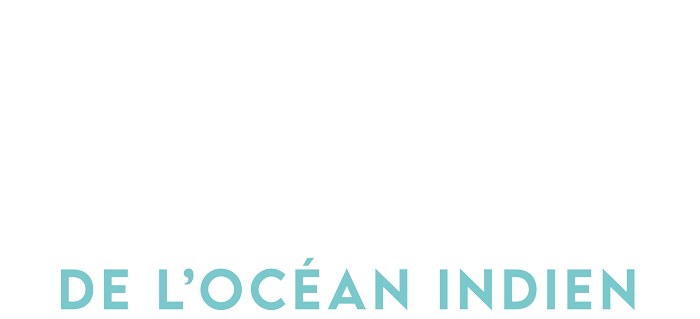Introduction
Le droit des étrangers en France1, sous sa forme moderne, s’est développé à la fin du XIXe siècle. Le législateur avait instauré, le 9 août 1893, un registre d’immatriculation des étrangers, avant la création d’une carte d’identité d’étranger, par le décret du 21 avril 19172. La carte d’identité d’étranger, sur laquelle figurait la mention « travailleur » pour les étrangers s’étant vu accorder le droit de travailler, constituait l’équivalent aujourd’hui de la carte de séjour.
Ces textes marquent le début de la reconnaissance des droits des étrangers, lesquels connaîtront un mouvement variable en fonction des régimes et gouvernements en place. Cependant, le droit moderne des étrangers trouve ses racines juridiques dans l’ordonnance du 2 novembre 19453, dont les changements les plus significatifs ont débuté dans les années quatre-vingt. La notion d’étranger est clairement définie dans l’ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 20044 actuellement en vigueur, laquelle a abrogé tout ou partie de plusieurs textes antérieurs.
La législation française donne une définition négative au mot « étranger », qui est d’une grande simplicité. L’étranger est par définition la personne ne disposant pas de la nationalité française5. À cela, l’on doit rajouter les personnes dont la nationalité n’est pas connue, tel est le cas notamment des apatrides ou des personnes qui ne donnent pas leur nationalité ; ce qui a une incidence sur les mesures d’éloignement applicables à leur encontre : celles-ci sont tout simplement bloquées.
Le critère de nationalité est indispensable dans la définition du mot étranger, si bien que la perte de nationalité française emporte la qualité d’étranger. La réciproque est vérifiable, en ce sens que l’acquisition par un étranger de la nationalité française le soustrait ipso facto du champ du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Autrement dit, même si l’étranger faisait l’objet d’une mesure d’éloignement, ou s’était vu opposer un refus de séjour, le seul fait d’avoir acquis la nationalité française rend illégal6 l’arrêté portant refus de séjour ou obligation de quitter le territoire français (OQTF). De même, il suffit que la preuve de la nationalité française du requérant soit établie en cours d’instance pour rendre sans objet le recours formé contre un refus de titre de séjour7.
La notion d’étranger se différencie de celle de citoyen, largement privilégiée dans le langage constitutionnel. Cette simplicité dans la définition du droit français des étrangers peut paraître troublante dans la mesure où les textes ainsi que la jurisprudence démontrent que la notion juridique d’étranger est loin d’être homogène. L’existence de différentes catégories d’étrangers, à l’instar des ressortissants des États membres de l’Union européenne et les membres de leurs familles, révèle que l’hétérogénéité touche également les règles juridiques applicables à ces catégories8. En matière de circulation et de séjour, les citoyens européens bénéficient d’un régime plus souple découlant de la libre circulation des personnes, lequel régime est différent de celui applicable aux ressortissants des États tiers. Les liens particuliers dont dispose l’étranger avec des nationaux français peuvent emporter des effets significatifs sur le régime juridique applicable en matière de la délivrance des titres de séjour ou d’exécution des mesures d’éloignement.
Le non-respect des règles régissant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers peut entraîner l’obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français. Les hypothèses/situations menant à la prise d’une telle décision, par le préfet, sont prévues à l’article L. 511-1 du CESEDA. Font l’objet d’une OQTF, les personnes entrées irrégulièrement sur le territoire français et ne disposant pas de titre de séjour, ou étant restées en France après l’expiration de leur visa. Il en va de même des personnes n’ayant pas pu bénéficier d’un renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour, ou d’un récépissé de demande de titre de séjour, ou les personnes s’étant vu retirer leur titre de séjour. Sont également concernées par une OQTF les personnes qui n’ont pas effectué une demande de renouvellement de leur titre de séjour temporaire et sont demeurées sur le territoire français, les demandeurs d’asile dont la demande de protection a été rejetée définitivement. Un étranger résidant sur le territoire français depuis moins de trois mois, représentant une menace pour l’ordre public, ou travaillant sans autorisation de travail peut être contraint à quitter le territoire.
De manière générale, les droits des étrangers sont subordonnés à un régime spécifique, qui ne saurait être aligné sur celui des nationaux9, lequel est repris dans les dispositions du CESEDA. De manière générale, tous les étrangers admis à séjourner en France sont, en principe, inclus dans le champ d’application du droit commun des étrangers, tel qu’issu du CESEDA. En d’autres termes, à moins que les conventions internationales n’en disposent autrement, le droit commun issu de ce code est applicable à l’ensemble des étrangers admis à séjourner en France.
Cependant, en dehors du droit de l’asile, qui connaît une application uniforme en France continentale et en outre-mer, la situation des outre-mer est différente, en raison de leur particularité. Il n’est pas étonnant que le législateur ait prévu des mesures particulières, compte tenu des spécificités de ces territoires, lesquelles se caractérisent par « des handicaps structurels indéniables contraignant leur développement économique »10. Plus concrètement, la situation particulière des outre-mer, apparaissant clairement à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), réside dans « leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement ». Dans le cadre du droit des étrangers, la situation particulière est caractérisée par une forte pression migratoire à laquelle certains territoires tels que Mayotte, la Guyane sont exposés.
Le constituant lui-même appréhende les collectivités territoriales situées outre-mer selon une approche beaucoup plus souple. Cette souplesse, caractérisant l’absence d’homogénéité dans ce qui est désormais convenu d’appeler le droit des outre-mer, résulte du régime juridique qui leur est accordé. Tandis que les collectivités d’outre-mer (COM) sont régies par le principe de spécialité, les départements et régions d’outre-mer, la Guyane, la Martinique et Mayotte sont en principe régis par l’identité législative. La spécialité législative, telle que prévue à l’article 74 de la Constitution, n’impose l’application des lois et règlements que si une mention expresse le prévoit. Quant à l’identité législative, prévue à l’article 73 de la Constitution, elle implique une application de plein droit des lois et règlements.
Cependant, le constituant a eu la sagesse de prévoir au profit des collectivités régies par l’article 73 des « adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières ». Ces collectivités territoriales se voient également habiliter à fixer elles-mêmes des règles spécifiques dans le domaine de la loi et du règlement11 applicables sur leurs territoires, exception faite toutefois de La Réunion, qui est exclue de ce dispositif, conformément aux souhaits des Réunionnais.
Ces éléments institutionnels et constitutionnels devraient permettre aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution de se voir appliquer pleinement les dispositions issues du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A contrario, les autres collectivités visées par l’article 74 de la Constitution ne devraient se voir appliquer ces règles que dans la mesure où une mention le prévoit.
Cette représentation dichotomique, en apparence simple, ne permet pourtant pas la justification aisée du maintien des mesures d’exception. Elle offre une classification statutaire dépassée, qui ne correspond plus à la réalité constitutionnelle des collectivités ultramarines.
Le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile révèle notamment que les mesures d’éloignement applicables aux étrangers dans certaines collectivités territoriales d’outre-mer, parfois au mépris de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH), s’écarte fondamentalement de celles du droit commun. En revanche, le contentieux de l’OQTF est applicable en Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le cas de la Polynésie française, de Wallis et Futuna et de la Nouvelle-Calédonie est différent.
Le principe pour ces territoires est l’application des dispositions dérogatoires (I), sans que le législateur ne fournisse l’effort de les rendre moins attentatoires à certains droits fondamentaux dont jouissent les étrangers. Cette circonstance rend opportune l’analyse de leur constitutionnalité et de leur conventionalité (II).
Les spécificités de l’éloignement des étrangers en outre‑mer
Le traitement des étrangers selon qu’ils se trouvent en France continentale ou en outre-mer est variable, voire inégalitaire12. Conformément à l’article L. 111‑2 du CESEDA, le droit applicable à Mayotte13, en Polynésie française14, en Nouvelle-Calédonie15, à Wallis et Futuna16 et aux TAAF17 (Terres australes et antarctiques française) d’un point de vue formel, est totalement dérogatoire du droit applicable en France continentale. Les dérogations sont plus saillantes, en ce qui concerne les mesures d’éloignement, autrement dit les obligations de quitter le territoire, dont il sera question dans le cadre de cette étude.
Cependant, le droit applicable aux outre-mer, s’agissant des étrangers, soulève une difficulté sérieuse lorsqu’on aborde la question sous l’angle contentieux. Plus précisément l’effet suspensif des obligations de quitter le territoire français dans certaines collectivités territoriales situées outre-mer constitue une véritable source de conflit. Certains territoires ultramarins, à l’instar de la Guyane, de Saint-Martin et de Mayotte bénéficient d’un régime spécifique défini à l’article L. 514‑1 du CESEDA permettant leur exclusion du principe d’un recours suspensif (A).
La question d’un recours effectif suspensif, lorsque l’étranger a fait l’objet d’une OQTF sur laquelle la présente étude se centrera, a déjà mobilisé plusieurs autorités juridictionnelles, que ce soit au niveau interne ou au niveau européen. S’inspirant de l’œuvre jurisprudentielle, le législateur a prévu des assouplissements souhaitables (B).
L’absence d’un recours suspensif contre les OQTF
Afin de mieux appréhender la particularité des outre-mer, en matière de recours effectif suspensif, il convient de rappeler le cadre général applicable, sans prétendre à l’exhaustivité, puisque ces questions sont largement connues. Le recours effectif suspensif consiste à permettre à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire, depuis la réforme du 7 mars 2016 ou d’une expulsion18, de pouvoir saisir le juge afin qu’il examine sa situation, avant l’exécution de la mesure d’éloignement. Ce faisant, il dispose d’un délai d’un mois, à compter de la notification de la décision, lorsqu’il s’agit d’une obligation de quitter le territoire français avec délai, et de quarante-huit heures lorsqu’il s’agit d’une OQTF sans délai ou lorsque l’étranger a fait l’objet d’une décision en rétention ou d’assignation à résidence.
En vertu des dispositions de l’article L. 512‑3 du CESEDA, l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office dès lors que le délai de départ volontaire accordé n’a pas expiré. Si la personne faisant l’objet d’une OQTF n’a obtenu aucun délai de quitter volontairement le territoire français, l’exécution de ladite décision ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures19 suivant sa notification administrative. De même, lorsque le juge a été saisi, le recours a un effet suspensif. Dès lors que le juge ne s’est pas prononcé, la personne en question demeure sur le territoire. Autrement dit, une obligation de quitter le territoire français demeure subordonnée à une procédure spécifique empêchant l’exécution d’une mesure d’éloignement jusqu’à l’intervention du juge, qui dispose d’un délai de trois mois pour statuer, conformément aux articles L. 512‑1, L. 512‑3 et L. 512‑4 du CESEDA.
Ces informations sont portées à la connaissance de l’étranger par la notification écrite de l’obligation de quitter le territoire français. La saisine du tribunal n’empêche pas pour autant le placement de l’étranger en rétention. En effet, il peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561‑2 du CESEDA. Cependant, dans cette hypothèse, il peut demander au juge administratif d’annuler ladite décision dans un délai de quarante-huit heures20 suivant sa notification. Ce principe connaît une dérogation en outre-mer, si bien que sa portée n’est pas à l’abri d’une dénaturation, ou à tout le moins d’un assouplissement.
En effet, le principe consistant à offrir à l’étranger la faculté de contester toute mesure d’éloignement lui ayant été signifiée connaît certaines limites en outre-mer. L’article L. 514‑1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007‑1631 du 20 novembre 200721, exclut la Guyane et Saint-Martin du champ d’application des dispositions de l’article L. 512‑1 du CESEDA, encadrant les règles de procédure administrative et contentieuse devant lesquelles l’autorité administrative doit s’incliner lorsqu’elle prend une décision obligeant l’étranger de quitter le territoire français. Cette interprétation a été confirmée par le Conseil d’État, dans un avis rendu en date du 25 juillet 200822 à la suite d’un jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 10 avril 2008. Il a en revanche précisé que les règles relatives au délai de recours, éventuellement prorogé par un recours administratif préalable et au délai d’application, trouvent à s’appliquer.
De manière générale, l’article L. 514‑1 du CESEDA prévoit un régime d’exception applicable aux collectivités territoriales situées outre-mer telles que la Guyane, la Guadeloupe, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. De la sorte, les dispositions des articles L. 512‑1, 512‑3 et 512‑4 du CESEDA, lesquelles prévoient que les mesures d’éloignement de droit commun des étrangers, ne sont pas applicables dans ces collectivités. Lesdits articles confèrent à l’étranger un droit à un recours effectif avant toute mesure d’éloignement. Dans ces collectivités, la décision par laquelle l’administration oblige l’étranger à quitter le territoire sans délai connaît une application immédiate23. Le Conseil d’État l’a rappelé dans son arrêt GISTI du 22 juillet 201524. Elle s’applique après l’expiration d’un mois, lorsque l’étranger s’est vu accorder un délai de départ volontaire.
La personne faisant l’objet d’une OQTF peut bel et bien s’en remettre au juge administratif en vue de son annulation. Cependant, l’action ainsi intentée n’empêche pas la décision d’être exécutée. Autrement dit, bien que les règles générales du contentieux administratif s’appliquent, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État25, le recours présenté devant le tribunal administratif à l’encontre d’une mesure d’éloignement n’est pas revêtu d’un caractère suspensif. Cette situation justifie que peu de recours sont intentés. S’agissant par exemple de Mayotte, l’analyse statistique démontre qu’en 2013, 93 % des mesures d’éloignement ont été exécutés (10 830 sur 11 433), alors qu’en France continentale, le taux est de 23 % selon les chiffres d’Eurostat. Toujours à la même période, sur 15 908 éloignements effectués, seuls 93 ont pu faire l’objet d’une requête en référés. La requête intervenait soit avant l’exécution de la mesure soit après en vue d’obtenir le retour de la personne dont la mesure d’éloignement était jugée illégale.
Cependant, ce principe connaît un assouplissement souhaitable permettant à l’étranger d’exercer son droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention EDH).
L’assouplissement du régime spécifique de recours non suspensif contre les OQTF
Il est constant que le recours exercé par un étranger dans les territoires soumis à un régime d’exception, tels que notamment Mayotte, la Guyane, à l’encontre d’une OQTF est dépourvu de tout effet suspensif. Cependant, trois types de mesures imposent une pondération de ce principe.
Premièrement, en vertu des dispositions du paragraphe 1er de l’article L. 514‑1 du CESEDA, l’exécution d’une obligation de quitter sans délai le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai d’un jour franc à compter de la notification de l’arrêté, lorsque l’autorité consulaire le demande. Le sursis dans la mise en exécution d’une mesure d’éloignement, demandé par l’autorité consulaire, offre un délai d’action d’un jour franc, alors que le droit commun, comme il a été dit, impose un délai de quarante heures au cours duquel l’intéressé doit introduire sa demande devant le juge.
Deuxièmement, la mise en exécution d’une obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative, prononce la suspension de l’exécution d’une OQTF dès lors que « l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En effet, le Conseil d’État a jugé, dans l’arrêt Takaram, que
la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d’éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative26.
De manière générale, les procédures d’urgence s’appliquent et peuvent faire échec à l’OQTF.
Troisièmement, la loi n° 2016‑274 du 7 mars 201627, tout en maintenant l’état du droit, prévoit qu’une mesure d’éloignement ne saurait faire l’objet d’une exécution d’office lorsque le tribunal administratif a été saisi par l’étranger d’une requête en référé-liberté28. Autrement dit, lorsque l’administration porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le juge des référés peut prendre, dans un délai de quarante-huit heures, « toute mesure nécessaire » à la sauvegarde de cette liberté. Dans pareille hypothèse, l’exécution de la mesure d’éloignement en cause se trouve suspendue jusqu’à ce que le juge informe les parties de la tenue ou non d’une audience publique. Si la demande est recevable, l’exécution de la mesure d’éloignement interviendra une fois qu’il aura statué. Le seul fait de saisir le juge des référés entraîne la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement. En empêchant l’exécution d’une OQTF sans que le juge, saisi d’un recours d’un étranger, ne se soit prononcé sur la légalité de la mesure contestée, le législateur instaure un dispositif conférant ainsi une garantie à un recours effectif aux étrangers. Le juge est donc mis à même de surseoir à une mesure d’éloignement, en fonction des éléments versés au dossier.
Le caractère suspensif d’une requête en référé-liberté constitue une avancée significative tenant compte de manière partielle de la position de la Cour EDH, dans son arrêt De Souza Ribeiro rendu le 13 décembre 2012 (voir infra II B). Cependant, ces dispositions s’appliquent uniquement dans le cas d’un référé-liberté. Les autres procédures d’urgence, prévues par le livre V du code de justice administrative, telles que notamment le référé-suspension, pouvant être invoquées à l’encontre d’une mesure d’éloignement ne sont pas incluses dans le champ d’application desdites dispositions. De plus, comme le note le Défenseur des droits29, dans le cadre du référé-liberté, le juge se borne à constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, avant de prendre les mesures qui s’imposent, lesquelles sont provisoires. Il ne peut prononcer l’annulation de la décision litigieuse.
Il n’est pas envisageable d’aligner la situation des outre-mer sur celle de la France continentale compte tenu de leurs spécificités. À cet égard, le gouvernement mettait en avant le risque « d’engorgement et de paralysie des juridictions et des capacités d’action de l’autorité administrative »30, en cas d’extension d’un recours suspensif de plein droit en outre-mer. Cette position semble discutable au regard de la jurisprudence précitée de la Cour EDH31, en ce qu’elle impose aux États d’« organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences » posées à l’article 13. Il n’en demeure pas moins qu’elle est défendable d’un point de vue conventionnel, en ce sens que le recours suspensif de plein droit n’est pas requis, pour autant que son absence n’entraîne pas des « conséquences potentiellement irréversibles » au sens de la jurisprudence Čonka32 et de l’article 3 de la Convention EDH. Les mesures d’exception applicables en outre-mer trouvent une justification conventionnelle, mais également constitutionnelle.
L’analyse de la constitutionnalité et de la conventionalité des mesures d’éloignement des étrangers en outre‑mer
Le régime d’exception dont bénéficient les collectivités ultramarines déroge au droit à un recours effectif, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme. Elles s’inscrivent, à certains égards, dans une dynamique de lutte contre l’immigration clandestine, et doivent permettre de faire face aux effets dus à la forte pression migratoire à laquelle certains territoires sont exposés33.
En effet, l’immigration illégale,
tout comme les réseaux criminels qui la favorisent, est encouragée par la topographie particulière de la Guyane, qui rend les frontières perméables et impossibles à contrôler efficacement. De plus, compte tenu du nombre important d’arrêtés de reconduite à la frontière pris par le préfet de Guyane, instituer un recours suspensif pourrait entraîner un engorgement accru des juridictions et entraîner des conséquences contraires à la bonne administration de la justice34.
Néanmoins, si la constitutionnalité des mesures d’exception instaurées en outre-mer a déjà reçu un accueil bienveillant de la part du Conseil constitutionnel, leur conventionalité demeure incertaine.
La constitutionnalité certaine des mesures d’exception
La question de la constitutionnalité des mesures d’exception reconnues à certaines collectivités situées en outre-mer a déjà été tranchée par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 93‑325 DC du 12 août 199335. La loi n° 93‑1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée d’accueil et de séjour des étrangers en France36 avait prévu un dispositif particulier pour ces territoires, qui permettait de faire face aux difficultés liées à l’immigration clandestine. Ce dispositif excluait ces collectivités du champ d’application des dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la commission de séjour des étrangers et au recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière, pendant une période de cinq ans.
Les dispositions litigieuses octroyaient un droit au recours qui n’était pas assorti d’un caractère suspensif. Or, selon les auteurs de la saisine, l’effectivité s’analyse comme étant la possibilité pour l’étranger de former un recours contre une mesure d’éloignement avant son exécution, lequel recours doit avoir un caractère suspensif. Le juge constitutionnel a validé les spécificités des droits des étrangers applicables dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il a reconnu la constitutionnalité des dispositions contestées au motif qu’il existait des garanties juridictionnelles de droit commun et qu’il était possible de demander le sursis à exécution. Le Conseil constitutionnel avait jugé que « les modalités particulières qu’elles prévoient pour une durée limitée peuvent être justifiées par l’état des flux migratoires dans certaines zones concernées et l’existence de contraintes administratives liées à l’éloignement ou à l’insularité des collectivités en cause »37.
Il a confirmé sa position dans la décision n° 2003‑467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure. En l’espèce, le législateur avait décidé en 2003 de pérenniser les mesures dérogatoires qui permettaient à la Guyane et à Saint-Martin, pendant une période de cinq ans, de ne pas soumettre pour avis à la commission du titre de séjour, prévue à l’article 12 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945, les refus de délivrance de titre de séjour à certains étrangers. Le recours dirigé contre une mesure d’éloignement ne pouvait revêtir le caractère suspensif. Les auteurs de la saisine estimaient qu’un tel régime méconnaissait les « droits et garanties constitutionnellement protégés, tels que les droits de la défense ». Ils considéraient également que ces mesures dérogatoires allaient au-delà des adaptations prévues par l’article 73 de la Constitution. Le juge constitutionnel, dans sa décision n° 2003‑467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, n’a pas sanctionné le régime dérogatoire pérennisé par le législateur. Bien au contraire, il a estimé que celui-ci a tenu compte de la situation particulière et des difficultés durables auxquelles la Guyane et l’île de Saint-Martin étaient confrontées en matière de circulation internationale des personnes. Il justifie sa position en précisant que le maintien de ce régime dérogatoire ne rompt pas « l’équilibre que le respect de la Constitution impose d’assurer entre les nécessités de l’ordre public et la sauvegarde des droits et libertés constitutionnellement garantis »38. Il ajoute que les requérants peuvent saisir le juge des référés administratifs. Les arrêtés de reconduite à la frontière, en principe, ne peuvent faire l’objet de la procédure du référé-suspension39, alors que dans les territoires visés par les dispositions de l’article L. 514‑1 du CESEDA, l’étranger peut mettre en œuvre cette procédure. Cette faculté permet d’atténuer l’absence du caractère suspensif, s’agissant d’un recours dirigé contre un arrêté portant reconduite à la frontière.
Le juge constitutionnel a rejeté tout argument tiré de la violation du principe d’égalité, en se fondant sur la situation particulière de ces territoires, laquelle situation est en rapport direct avec l’objectif que s’est fixé le législateur en matière de lutte contre l’immigration clandestine. Cela a permis aux adaptations ainsi apportées d’être regardées comme conformes à l’article 73 de la Constitution.
Il en va de même du cas de Mayotte. La situation de Mayotte a cela de particulier que sa population est caractérisée par une forte proportion de personnes de nationalité étrangère, dont la plupart sont en situation irrégulière. Le juge constitutionnel, dans la décision n° 2018‑770 DC du 6 septembre 201840, considère qu’une telle circonstance peut être regardée comme constituant des caractéristiques et contraintes particulières de nature à justifier l’adaptation par le législateur des règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, dans le but de lutter contre l’immigration irrégulière à Mayotte.
La conventionalité incertaine des mesures d’exception
La question de l’existence d’un recours effectif a été à l’origine de la célèbre affaire De Souza Ribeiro contre France, du 13 décembre 2012, dans laquelle la Cour EDH a tenté de mettre de la clarté. Dans cette affaire, M. Luan de Souza Ribeiro avait saisi la Cour EDH en date du 22 mai 2007, sur le fondement de l’article 34 de la Convention EDH. Le requérant avait invoqué la violation de l’article 8 de la Convention EDH pris isolément et combiné avec l’article 13. En effet, celui-ci avait fait l’objet d’une mesure administrative de reconduite à la frontière prise en date du 25 janvier 2007, à la suite d’un contrôle routier (au cours duquel il n’a pas pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français), sans qu’il ne lui fût offert la possibilité de contester la décision prise à son encontre avant qu’elle ne fût exécutée41. Il a été néanmoins reconduit au Brésil (à Belem). Du fait que la mesure d’éloignement a été exécutée, le juge de référé, par voie d’ordonnance, a déclaré sans objet la demande en référé suspension du requérant.
Dans un premier temps, une chambre de la cinquième section, dans un arrêt rendu le 30 juin 2011 avait conclu (quatre voix contre trois) à la non-violation de l’article 13 lu en combinaison avec l’article 8 de la Convention EDH. Le tribunal administratif de Cayenne s’était en effet prononcé sur la légalité de l’arrêté préfectoral, qu’il avait d’ailleurs sanctionné. Sur la base du jugement rendu le 18 octobre 2007 par le tribunal administratif reconnaissant l’illégalité de l’arrêté préfectoral, le requérant s’est vu délivrer un titre de séjour. Le tribunal s’étant prononcé après la reconduite à la frontière, la décision ne pouvait être revêtue de tout effet suspensif. En ce que le tribunal administratif de Cayenne avait jugé illégal l’arrêté portant reconduite à la frontière, la chambre a considéré que le requérant a pu exercer le droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention EDH. Dans cette circonstance, le juge de Strasbourg a estimé que « le requérant conservait donc un grief défendable »42.
Dans un second temps, à la demande du requérant, l’affaire a été renvoyée devant la Grande chambre, laquelle a rappelé une jurisprudence constante en la matière. Selon elle, « pour être effectif, le recours exigé par l’article 13 doit être disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’État défendeur »43.
Le juge de Strasbourg a précisé la portée du recours effectif. Selon la Cour EDH, lorsque la mesure d’éloignement expose l’intéressé à un risque réel de se voir infliger un traitement contraire à l’article 3 de la Convention EDH (tels que le risque de torture ou des mauvais traitements), l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 impose un contrôle attentif par une autorité nationale44, « un examen indépendant et rigoureux du grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à l’article 3 ainsi qu’une célérité particulière »45. Dans pareille hypothèse, le juge considère que l’effectivité emporte l’existence d’un recours de plein droit suspensif46. L’effectivité doit permettre d’empêcher, ainsi que le précise la Cour EDH dans l’arrêt Čonka47, que soient exécutées des mesures qui violeraient la Convention. Il convient de permettre aux autorités nationales d’examiner de telles mesures, dont les effets seraient potentiellement irréversibles, au regard de la Convention48.
En revanche lorsqu’il convient de contester un éloignement d’étrangers sur le fondement d’une atteinte alléguée à la vie privée et familiale, « l’effectivité ne requiert pas que les intéressés disposent d’un recours de plein droit suspensif »49. Cependant l’examen de la décision attaquée ne doit pas être superficiel. Or, compte tenu du délai dans lequel le requérant a été reconduit, soit une heure après avoir intenté une requête en référé suspension, la Cour EDH a jugé que l’examen n’a pas pu être menée de manière plus sérieuse, voire approfondie. « Par conséquent, dans les circonstances de la présente espèce, la Cour estime que la hâte avec laquelle la mesure de renvoi a été mise en œuvre a eu pour effet en pratique de rendre les recours existants inopérants et donc indisponibles »50. Elle a estimé que « la reconduite à la frontière du requérant a été effectuée selon une procédure mise en œuvre selon des modalités rapides, voire expéditives »51.
Dans cette affaire, la France a été condamnée pour violation de l’article 13. Cette condamnation est intervenue parce que la Cour n’a pas pu constater que le requérant a pu bénéficier d’un recours effectif, permettant une analyse approfondie de sa requête par une juridiction impartiale et indépendante. En tout état de cause, l’existence de mesure d’exception ne saurait avoir pour effet de « dénier au requérant la possibilité de disposer des garanties procédurales minimales adéquates visant à le protéger contre une décision d’éloignement arbitraire »52. Contrairement à une tendance doctrinale approximative, l’absence d’effet suspensif n’emporte pas absence de recours effectif. D’ailleurs une lecture combinée des dispositions des articles 8 et 13 de la Convention permet de constater que le caractère suspensif n’est pas exigé, pourvu que le recours effectif soit bien réel. Et en l’espèce, il s’agissait bien d’une mesure d’éloignement, aux « conséquences potentiellement irréversibles », prise sur la base d’une atteinte à la vie privée et familiale. Les conséquences que la décision de reconduite à la frontière fait peser sur la vie personnelle et familiale du requérant n’ont pas fait l’objet d’une appréciation suffisante. En effet, celui-ci, avant l’âge de treize ans, vivait en France avec ses parents, qui détenaient une carte de résident. Ses frères et ses sœurs étaient de nationalité française, et certains d’entre eux étaient nés sur le territoire français. Or, la Cour exige que lorsque l’expulsion est susceptible de porter atteinte au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale, il appartient à l’État de lui fournir de manière effective53 les moyens nécessaires lui permettant de contester la décision prise à son encontre.
Le recours effectif entendu selon les dispositions de l’article 13 de la Convention EDH n’impose aucunement un recours de plein droit suspensif. De ce fait, l’on peut considérer que la situation particulière de la Guyane n’a pas été complètement sanctionnée par le juge, qui a essentiellement insisté sur la nécessité, pour le requérant, d’une part, de se voir octroyer la possibilité effective de contester la mesure d’éloignement ou le refus de titre de séjour, et d’autre part, de pouvoir bénéficier d’un examen effectif de sa situation par une instance nationale. Il y a donc une validation du droit par la Cour, mais aussi une sanction des pratiques administratives. Cette position de la Cour EDH n’est pas étonnante, en ce qu’elle ne nie pas la situation particulière dans laquelle la Guyane se trouve, s’agissant de cette matière. L’État jouit d’un pouvoir d’appréciation qui n’est pas absolu, car il se heurte aux exigences découlant de l’article 13 de la Convention EDH.
Dans une affaire analogue, le tribunal de Mamoudzou, sous l’influence de la jurisprudence De Souza Ribeiro, a annulé un arrêté portant reconduite à la frontière au motif que le requérant de nationalité malgache n’avait pas pu exercer son droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention EDH. Le requérant avait invoqué le droit au respect de la vie familiale, étant père de trois enfants nés et scolarisés de manière ininterrompue à Mayotte, ayant donc vocation à demander la nationalité française. L’analyse chronologique des faits démontre qu’il a été reconduit le jour même où a été saisi le juge des référés, le 27 janvier 2013. Alors même que conformément aux dispositions de l’article 35 de l’ordonnance n° 2000‑373 du 26 avril 2000, alors applicable, le recours contre une mesure d’éloignement n’a aucun caractère suspensif, le tribunal administratif de Mamoudzou, dans son ordonnance du 28 janvier 201354, s’est borné à vérifier si le requérant avait bénéficié d’un recours effectif. Il a conclu à la violation des dispositions de l’article 13, mais également de l’article 8 garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Le tribunal de Mamoudzou, en sanctionnant non pas le caractère non suspensif, mais l’absence d’un recours effectif, applique fidèlement la position de la Cour EDH dans la décision précitée.
En vertu de l’article L. 514‑1 du CESEDA, le recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français connaît une application immédiate. Dans l’arrêt GISTI, rendu en date du 22 juillet 2015, le Conseil d’État a tenu à rappeler la portée de ce régime spécifique. Selon lui, si contrairement au régime prévu à l’article L. 512‑1 du CESEDA, celui prévu à l’article L. 514‑1 est bel et bien dépourvu de caractère suspensif, ce n’est que dans le respect des engagements internationaux de la France. La Convention EDH prévoit la suspension de toute mesure d’éloignement forcé lorsque l’étranger a saisi le juge des référés, « jusqu’à ce que ce dernier ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience ou, en cas de tenue d’une audience, jusqu’à ce qu’il ait statué »55. Or, l’extension de ce régime à Mayotte ne fait pas obstacle à ce que l’étranger faisant l’objet d’une OQTF ait recours aux procédures de référé, référé-suspension et référé-liberté. Le préfet de Mayotte s’était vu imposer de se soumettre à cette exigence, par une note du 3 avril 2013 du ministre de l’Intérieur. Le juge administratif a conclu que
dans ces conditions, l’ensemble des recours offerts aux étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement forcé à Mayotte garantit, contrairement à ce qui est soutenu, le droit d’exercer un recours effectif susceptible de permettre l’intervention du juge en temps utile, alors même que le recours dirigé contre cette mesure est par lui-même dépourvu de caractère suspensif.
Plus clairement, les recours offerts aux étrangers à Mayotte, faisant l’objet d’une OQTF ne violent aucunement le droit à un recours effectif tel qu’entendu à l’article 13 de la Convention EDH.
Bien que le régime prévu à l’article L. 514‑1 du CESEDA soit en lui-même compatible avec la Convention EDH, il n’est pas conventionnel au sens strict du terme. En effet, ce n’est que parce qu’il existe les procédures d’urgence que celui-ci reçoit le brevet de conventionalité. Les garanties que de telles procédures offrent ont pu être prises en considération dans la détermination du caractère effectif du recours, au sens de l’arrêt Klass et autres contre Allemagne56. Néanmoins, la disponibilité en droit comme en pratique du recours prévu à l’article 514‑1 n’est pas entièrement satisfaisante, car sa mise en œuvre est par nature entravée par le régime mis en place, qui favorise l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement.
Ainsi, la réforme du 7 mars 201657 n’a pas pour autant mis fin à cette inconventionnalité. Elle en a minoré les effets, en reprenant à l’identique la position adoptée par le Conseil d’État dans l’arrêt précité. Désormais, un paragraphe 3 a été ajouté à l’article 514‑1, rappelant la suspension d’une exécution d’office si l’étranger a introduit un recours en référé-liberté. L’effet suspensif prévu désormais à l’article 514‑1, paragraphe 3, concerne uniquement les référés-libertés. En effet, alors que dans l’affaire GISTI le Conseil d’État visait expressément les référé-suspension et référé-liberté, et les articles correspondants (article 521‑1 et 521‑2 du code de justice administrative), le législateur du 7 mars 2016 a fait le choix étonnant d’exclure le référé-suspension et de ne maintenir que le référé-liberté. D’ailleurs, les mots « référé-liberté » n’apparaissent pas de manière explicite, le juge s’est contenté de renvoyer à l’article 521‑2, qui en encadre l’exercice. Cette retenue ou du moins cette économie rédactionnelle démontre clairement qu’il n’a pas souhaité généraliser le caractère suspensif d’une OQTF faisant l’objet d’une exécution d’office à tout type de référé. Il faut impérativement qu’une atteinte grave et manifestement illégale soit portée à une liberté fondamentale par l’administration pour rentrer dans le nouveau dispositif prévu par le législateur.
En définitive, l’analyse de la constitutionnalité et de la conventionalité des mesures d’éloignement des étrangers en outre-mer révèle que le constituant admet des spécificités outre-mer, tandis que le droit de la CEDH est plus rétif à ces spécificités dans le champ de certains droits et libertés fondamentaux (comme le droit au recours effectif).
Conclusion
Les mesures d’exception applicables dans certaines collectivités territoriales d’outre-mer sont essentiellement légitimées par leur situation particulière, plus clairement par les difficultés importantes liées à la pression migratoire auxquelles elles doivent faire face. Dans un rapport particulièrement critique publié en mai 2016, le Défenseur des droits plaide pour la suppression du régime dérogatoire reconnu à ces entités infra-étatiques. Si l’on peut comprendre les préoccupations du Défenseur des droits, qui est bien dans son rôle, s’agissant des difficultés dues à la pratique effective de ce régime d’exception, l’on ne saurait en revanche inviter à sa suppression, pour deux raisons.
La première raison est d’ordre jurisprudentiel. En effet, la jurisprudence précitée de la Cour EDH et celle du juge administratif ne sont pas opposées à l’absence d’un recours suspensif, pour autant que l’étranger ait été mis à même d’exercer ses voies de recours conformément aux dispositions de l’article 13 de la Convention. Cependant, l’exécution immédiate d’une OQTF ne favorise pas entièrement le respect du principe posé à l’article 13 de la Convention. Afin de réduire le comportement abusif de l’administration, sans qu’il soit besoin de supprimer l’article L. 514‑1 du CESEDA, l’on peut exiger le respect d’un délai d’un jour franc à compter de la notification de la décision. Il s’agit d’une période dans laquelle la mesure d’éloignement ne peut être exécutée le temps de pouvoir saisir matériellement le juge administratif. Ce délai, bien que court, permettrait de maintenir un droit de recours juridictionnel contre les décisions d’éloignement d’étrangers en situation irrégulière, tout en favorisant une organisation moins rigide de l’administration.
La deuxième raison a un rapport direct avec le contexte particulier de ces entités infra-étatiques. Le juge constitutionnel n’hésite plus à s’attacher aux caractéristiques et contraintes particulières pour justifier la constitutionnalité des dérogations/adaptations accordées aux collectivités ultramarines, s’agissant du droit des étrangers en outre-mer. Les difficultés durables de ces collectivités justifient pleinement, selon nous, que l’on maintienne le régime dérogatoire en ce qu’elles présentent des caractéristiques et contraintes particulières au sens de l’article 73 de la Constitution. Les autorités institutionnelles plaidant en faveur de sa suppression sont souvent déconnectées de la réalité à laquelle l’outre-mer est confronté58. Le régime dérogatoire ne peut être appréhendé qu’à l’aune d’une contextualisation suffisante.
Dans les décisions n° 97‑389 DC du 22 avril 199759, n° 2003‑467 DC du 13 mars 200360, le juge constitutionnel a bien pris en compte la situation particulière et les difficultés posées par la présence importante d’immigrés clandestins dans ces collectivités bénéficiant du régime dérogatoire. Cette circonstance lui a permis à plusieurs reprises de valider les mesures prises par le législateur dans le but de renforcer les moyens de lutte contre l’immigration clandestine.
Sur ce fondement, le juge constitutionnel, dans la décision n° 2018‑770 DC du 6 septembre 201861, a validé la modification des règles d’acquisition de la nationalité française applicables à Mayotte. Il a admis que le droit de sol pouvait faire l’objet d’adaptation afin de tenir compte des « caractéristiques et contraintes particulières » de l’île de Mayotte.
On peut voir dans la position du juge constitutionnel une application de sa jurisprudence constante en matière de violation du principe d’égalité dégagée depuis la décision n° 87‑232 DC du 7 janvier 198862. Depuis cette décision il admet de manière constante, sur le fondement de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, que le « principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit »63.
L’absence de recours suspensif peut trouver son fondement constitutionnel dans l’article 73 de la Constitution, alinéa 1er, plus précisément dans la notion de « caractéristiques et contraintes particulières », qui constitue selon nous une sorte de « fourre-tout » où l’on insère tous les écarts existant entre la métropole et les territoires ultramarins régis par ledit article ou toutes les particularités ayant pour seul objet de tenir compte de la situation particulière de ces entités infra-étatiques. Il suffirait de l’aménager afin de répondre parfaitement aux exigences découlant de l’article 13 de la Convention européenne.