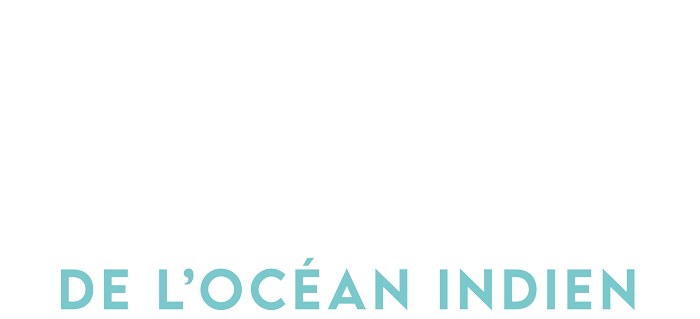Le cinéma sud-africain postapartheid a marqué une rupture franche avec celui associé à la période ségrégative car pour la première fois la majorité noire du pays se trouvait accéder un régime de visibilité sur les toiles. Nombre de sujets sociétaux, y compris les plus difficiles étaient de surcroît exposés et traités de manière critique. Ce cinéma engagé, qui débute en 1994 avec les premières élections libres, épouse le nouveau roman national avec l’avènement du parti African National Congress (ANC), lequel se dresse en vigie d’une nation adolescente démocratique, regardant droit dans les yeux la réalité d’un pays traumatisé bien que résolument optimisme. Par le traitement des sujets durs, ce « nouveau répertoire » (Tomaselli, 2006) épouse le récit d’une nation en reconstruction et en réconciliation faisant assaut de résilience. Empruntant aux codes du cinéma mainstream et notamment américain (Folio, 2012), il pose comme jalons un esthétisme revendiqué et des valeurs plus ou moins normées (happy ending, self man man…) au service de la nouvelle cause. Ce cocktail détonnant lui vaut l’accession à une notoriété nouvelle, perceptible par la participation à divers festivals internationaux, y compris parfois aux plus prestigieux (tels que les Oscars) et aux récompenses inhérentes. En cela, il participe au nouveau soft power national, où plane l’ombre tutélaire de Nelson Mandela et du renouveau mythique « arc-en-ciel ».
Dans cette contribution, nous souhaitons continuer à creuser le sillon du genre cinématographique sud-africain depuis les années 90-2000, en nous attardant sur la temporalité 2010-20, laquelle apparaît plus complexe. En effet, notre postulat est de dire qu’une nouvelle page, que l’on qualifiera de plus ardue et riche, s’est ouverte depuis peu, abordant de nouvelles réalités de cette société sud-africaine. Ces dernières s’attellent au traitement de problématiques inédites, parfois sulfureuses pour ne pas dire taboues. Hier, on exposait le VIH-sida, les inégalités et la criminalité ; aujourd’hui l’homosexualité masculine, les mœurs conservatrices traditionnelles et la xénophobie. Ces réalités font-elles l’objet d’un même traitement cinématographique au sein du cinéma sud-africain contemporain, tant sur un plan formel que sur le fond ? Bénéficient-elles d’un même appui et d’un même engouement de la société civile (ou du moins d’une partie d’entre elle) ? Des différences semblent de mises entre les deux périodes susnommées. Le traitement devient résolument épuré, tendant vers le film d’auteur. In situ, l’accueil est aussi plus froid. Or, ces films accèdent à une reconnaissance et engrangent des prix à l’international. Ils semblent participer au passage à une nation plus mature. Une de nos hypothèses est de dire que les problématiques abordées après 1994 exposaient la responsabilité directe du régime d’apartheid ce qui concourrait à leur pleine acceptation ; les films récents questionnent plus librement la société actuelle et ses tiraillements, et en voie de conséquence dérangent davantage. Une autre hypothèse est de dire que si ces films défraient la chronique au plan local, ils trouvent parallèlement un écho positif et attendu, tantôt à l’échelle internationale, tantôt sur la scène africaine.
La première partie reviendra sur les fondamentaux du cinéma postapartheid, s’appuyant sur quelques exemples notoires (Tsotsi, Yesterday…). À travers deux œuvres nouvelles (Les Initiés et Man on the ground), les deuxième et troisième parties expliciteront les facettes nouvelles et cerneront d’autres maux nationaux, au travers de leur résonnance à plusieurs niveaux d’échelles. Notre méthodologie s’appuie sur le visionnage et l’analyse critique de ces œuvres, appuyés par une analyse de corpus reposant sur des sources académiques (d’obédience géographiques), des critiques de spécialistes du cinéma et sur des sources grises (presse, notes de blogs, commentaires du public…). Le tout recoupe un travail de terrain (ou « veille d’actualité ») débuté de longue date sur le terrain sud-africain et qui tend à observer et à étudier finement la société sud-africaine sous ses auspices géographique, historique, politique ou encore sociologique.
Cinéma postapartheid et roman national
Le cinéma sud-africain est entré dans une ère de renouveau après 1994, à en juger par la participation de quantité de ses œuvres aux festivals internationaux. Plus globalement, il a suscité l’intérêt, les années suivantes, des distributeurs occidentaux. Le pays a remporté les distinctions un peu partout où ses films ont concouru à travers le monde. Parmi eux, citons Zulu love letter de R. Suleman (2004), Drum de Z. Maseko (2004), mais aussi Mon Nom est Tsotsi de G. Hood (2005), U-Carmen eKhayelitsha de M. Dornford-May (2005) ou encore Yesterday de D. Roodt (2004). Le cinéma sud-africain a ainsi pris une belle envergure, et ce au terme du long épisode que fut l’apartheid (ou politique de développement séparé – 1948/1994). Auparavant, le cinéma local embrassait surtout une narration de propagande traditionaliste, très réductrice car tournée vers la population blanche, notamment Afrikaner (Lelièvre, 2011). Celui-ci était rééquilibré, en partie, par un cinéma d’opposition clandestin voire souvent délocalisé (Lebdaï, 2015).
Mon Nom est Tsotsi (2005) a signé l’émergence du renouveau de ce cinéma sud-africain postapartheid, dans la mesure il a remporté l’Oscar du meilleur film étranger à Hollywood. Au demeurant, ce cinéma critique se centre résolument sur des sujets sociaux, avec des acteurs locaux jouant dans leur propre langue (dans le cas de Tstotsi : l’argot des townships). Si Tsotsi a remporté un Oscar en 2006, avant lui, les précurseurs s’appelaient Yesterday et U-Carmen eKhayelitsha (Gauthier, 2021). Le premier narre l’histoire d’une paysanne séropositive ; il s’agit du premier film tourné en langue zouloue, par ailleurs premier long-métrage sud-africain nominé en 2005 aux Oscars (catégorie du meilleur film étranger). Le second est une adaptation de l’opéra de Bizet, chantée en xhosa au sein d’un township du Cap, ours d’Or à la Berlinale 2005.
Sur un plan thématique, il faut noter la quantité assez importante de films s’attachant à disséquer la nouvelle nation sud-africaine (Dovey, 2009). À cet égard, ce sont bien les exclus ou « refoulés » d’une ère révolue qui accèdent aux lumières des projecteurs. En somme ceux qui, jusqu’à un passé récent, n’avaient guère été́ filmés sans présupposés idéologiques, ou étaient simplement exclus de quelque représentation cinématographique que ce soit. En clair, les populations de couleur et majoritairement la communauté́ noire. De surcroît, les sujets abordés sont souvent empreints de gravité. Aussi s’érigent-ils en tant que métaphores des défis, voire des démons combattus et non disparus du pays : pauvreté́, chômage, inégalités, exclusion, criminalité́, VIH-Sida…
Ces problématiques exposées sont liées à la période antérieure car ils apparaissent comme le legs d’un développement socio-économique dual, discriminant et profondément inégalitaire, attaché à l’apartheid. Le film Tsotsi montre par exemple la vie des quartiers d’apartheid (townships et bidonvilles), les citoyens de seconde zone à travers les enfants des rues et la délinquance des zones précaires (Houssay-Holzschuch, 2006). Le film Yesterday décrit lui le sous-équipement des aires coutumières que le régime d’apartheid a tenté d’ériger en de nouveaux pays africains (les « bantoustans » : ici le KwaZulu), l’éloignement et le sentiment d’abandon des populations rurales, ce qui a une incidence sur le traitement et la prise en charge des maladies graves. En même temps, ils donnent à voir certains aspects originaux : la nouvelle bourgeoisie noire dans Tsotsi ; l’ostracisme villageois face au VIH-Sida dans Yesterday. Il faut noter que le film Tsotsi a induit un financement public notable du cinéma local. En effet, pour la première fois, il a attiré un public noir, celui de la néo-bourgeoisie postapartheid1.
Nul doute que trente ans après la fin du régime ségrégatif, les discours introspectifs – cathartiques pourrait-on même dire –, et le regard critique issu du cinéma sud-africain contemporain ont pu s’abreuver des larges consultations de la Commission « Vérité́ et Réconciliation » (Dovey, 2009), présidée par le Prix Nobel de la paix Desmond Tutu. Ce cinéma s’emploie donc à faire montre de créativité́. Il met en exergue une situation sociale préoccupante sur bien des plans, s’attelant à représenter les exclus d’hier, tout en usant des codes cinématographiques en vigueur. In fine, il en émane une certaine originalité́ de « contenu », laquelle va finir par s’hybrider aux normes et artifices cinématographiques les plus connus, regardant du côté du cinéma commercial.
Force est en effet de constater que les films récents, ceux-là̀ même qui glanent les récompenses au sein des festivals internationaux, témoignent d’un savoir-faire sur la forme, c’est-à-dire sur un registre technique et narratif, voire même idéologique. Faut-il rappeler que l’industrie cinématographique sud-africaine est depuis ses origines influencée par le genre hollywoodien ? Cette influence persiste dans les mutations récentes. Un point d’honneur est par exemple accordé au traitement stylistique, y compris quand les sujets sont âpres. Les longs métrages manient allègrement les bons sentiments et le politiquement correct (qui à bien des égards s’accordent avec le discours institutionnel dominant). Enfin, ils rendent compte d’une analyse binaire, tantôt simpliste du contexte et des personnages… Un exemple est donné par le film Tsotsi, adapté d’un roman de Athol Fulgard, publié en 1980 mais dont l’action est située dans les années 50. L’adaptation cinématographique voit sa fin modifiée pour davantage tendre vers une issue rédemptrice et optimiste. À ce titre, on peut sans doute soumettre l’idée d’une certaine « codification » de ce cinéma postapartheid, sorte de cahier des charges qu’il est aisé de rapprocher au phénomène de globalisation économique et de mondialisation culturelle pour un pays souhaitant ré-accéder au concert des nations. Les critiques à l’endroit de Yesterday comme de Tsotsi ont ainsi pu arguer d’un traitement un peu adouci des problèmes locaux (la brutalité des voyous dans les townships ; les ravages du sida dans les campagnes…) et du ton mélodramatique adopté.
Au premier abord, ce sont les aspects du cinéma américain, énoncés par R. Dubois (2008) qui sautent aux yeux. Ils s’agrègent autour d’un panel de positionnements ou « valeurs », qui se lisent en partie dans ce « cinéma nouveau » sud-africain. Le pays de Nelson Mandela entre en résonance avec celui de l’oncle Sam sur quelques principes, quand bien même son histoire, sa géographie, son système politique, sa culture conservent des spécificités propres (Folio, 2012). Au nombre de ceux-ci, on citera l’optimisme, l’happy ending en guise de retour à la normale ou la célébration de l’individualisme (le self made man). Cela est également visible par le biais de l’usage de mécanismes filmiques notoires : mentionnons l’esthétisation, la photographie travaillée, le rythme soutenu, le jeu de caméra ou le grand soin accordé à la bande son locale (le Kwaïto tout particulièrement, issu de l’afro pop). Un traitement qui se retrouve, pareillement, dans les séries Netflix contemporaines, estampillées Made in South Africa.
Tout cela pourrait être certes considéré́ comme la résultante d’un certain détachement sud-africain envers les conceptions venant de pays non anglophones. Il convient de le nuancer. En premier lieu, il n’est jamais vain de rappeler la réalité du lien linguistique et socioculturel entre l’Afrique du Sud et les autres pays anglo-saxons. En second lieu, la visée est plus prosaïquement marchande et de ce fait… pragmatique. Elle est en fait le garant d’une culture mainstream ou du « courant dominant », où s’imprime une mondialisation de contenu dans le cadre du 7e art impulsée, il est vrai, par le cinéma américain (Martel, 2010). Notons que de nombreuses œuvres du cinéma contemporain, y compris dans les « genres » émergeants, font appel aux artifices notoires et à des emprunts, dès lors que la recette se veut efficace et payante. Cette circulation de savoir-faire restitue évidemment et très souvent fidèlement les spécificités locales, qu’elles soient culturelles, historiques, politiques et territoriales. On citera à ce niveau le cinéma coréen (Hallyuwood), nigérian (Nollywood) sans oublier bien sûr celui indien (Bollywood) parmi les genres les plus influents. Rappelons également que l’Afrique du Sud s’est faite une place parmi ces nations sur un plan cinématographique, de par ses plateaux de tournages, le professionnalisme de son personnel, les faibles coûts de production et la diversité de ses paysages (Donadieu, 2014). Au reste, ceux-ci voient nombre d’œuvres internationales être tournées localement (des films « blockbusters » comme Blood Diamond en 2006, Hotel Rwanda en 2004, Invictus en 2009, Black Panther en 2018 ; des séries comme Black Sails ou encore Homeland ; mais aussi quantité de spots publicitaires…). On a d’ailleurs fini par caractériser le « genre » sud-africain Callywood, au sens où il est avant tout basé dans la région du Cap (St-Jacques, 2014).
Des normes cinématographiques semblent donc explicitement présentes au sein des longs-métrages postapartheid. On peut les relier au fait que ces films s’adressent à un public et à des experts internationaux. La quête de notoriété́ mondiale se destine à ré-ancrer l’Afrique du Sud dans la communauté internationale (Le Poullennec, 2014). C’est à ce titre qu’ils s’inscrivent dans les canons du genre. En dépit de cette réalité́, ces films contribuent parallèlement à une meilleure compréhension du pays, à une adhésion la plus large au niveau interne, ce qui renforce leur intérêt mais aussi leur ambivalence.
En résumé, le cinéma postapartheid tient à ce que nous pouvons intituler une « nation adolescente ». L’objectif affiché est de ré-accéder au rang de pays phare à l’échelle mondiale. Le cinéma d’après l’apartheid se nourrit se cette période difficile et plus précisément des effets néfastes de la page d’histoire discriminante, pour à la fois se regarder dans un miroir et donner à voir au monde une image teintée de franchise et d’honnêteté ; ce qui localement prend des atours purificatoires. En cela il tient d’une stratégie d’influence qui se veut « libératrice », avec pour vecteur l’attractivité et la culture (définissant donc le soft power, ou outil de puissance douce, fonctionnant avant tout sur la séduction). Il nourrit également un véritable récit national : celui d’un pays en reconstruction et érigeant la tolérance et la réconciliation en vertus cardinales. Il donne à voir les tourments (sida, inégalité, criminalité…), mais aussi et surtout les processus de résilience et de rédemption à leur encontre. La jeune nation démocratique sud-africaine devient une nation inspirante, avec une aura « mandelaesque ». Ce roman national, manipule habilement, d’un point de vue cinématographique, les codes du cinéma commercial et trouve sa voie parmi les genres les plus influents du monde.
Projetons-nous à présent quelques années plus tard en nous penchant sur deux œuvres sorties plus récemment, donnant à voir une réalité a priori identique mais finalement discordante sur bien des points. Nous sommes conscients qu’elles n’ont pas force de généralité absolue mais notre choix repose sur un double critère : d’abord, la sensibilité aigüe que ces films génèrent et la prise de risque assumée par le réalisateur et toute l’équipe de tournage. Ensuite, un double effet en cisaille pourrait-on dire, de plébiscite international mêlé à un relatif malaise interne. Ce dernier n’expose-t-il pas les ambiguïtés et contradictions d’une société sud-africaine en phase de murissement ?
Les Initiés : double tabou national et plébiscite à l’international
Le film Les initiés (Inxeba ou The Wound), sorti en 2017, se déroule dans un camp d’initiation Xhosa pour adolescents. Les Xhosas sont la deuxième ethnie d’Afrique du Sud (après les Zoulous) présents particulièrement dans la région est-sud-est de l’Afrique du Sud (du fait de la présence d’anciens bantoustans à cet endroit). Le point de départ de l’œuvre est le suivant : des garçons se font circoncire, enduire d’argile blanche puis endurent plusieurs jours de mise à l’épreuve, en totale autonomie. Ce rite traditionnel est destiné à les faire devenir des hommes et à accéder ensuite à de nouveaux privilèges et responsabilités. En cela, le rituel (appelé « Ukwaluka ») se veut une initiation de passage à l’âge adulte. En sortant du camp avec le statut d’homme, ils doivent garder le secret absolu sur l’ensemble de la coutume. Cette toile de fond a pour cadre l’histoire plus spécifique de deux personnages, instructeurs et veillant au bon déroulement des opérations. Ils entretiennent en cachette une relation intime, dont il ne sera rien occulté à l’écran de leur passion brutale, charnelle (bien que toxique). Cette relation sera dévoilée par un membre apprenant, s’élevant lui contre le tabou de l’homosexualité masculine dans le pays, a fortiori dans ces zones à forte tradition.
À l’origine de cette histoire se trouve un roman, A Man Who is Not a Man (2009), qui est le premier de l’auteur Thando Mgqolozana, par ailleurs co-scénariste du film. Dans une mise en scène caméra à l’épaule, au plus près des acteurs et dans un souci de réalisme, le film prend à bras le corps deux tabous de la société arc-en-ciel : la dureté des rites traditionnels et l’homosexualité́ (Rémy, 2018), un chemin qu’a aussi emprunté le film Moffie (2021) s’agissant de ce dernier thème. Pour ce faire, le réalisateur s’est appuyé sur des témoignages personnels d’initiés et le retour d’expériences des acteurs (quasiment tous non-professionnels et appartenant à la communauté xhosa) en laissant une part d’improvisation importante. La caméra a ainsi souvent continué à tourner sans interruption durant les réparties (entretien du réalisateur avec V. Garnier, 2017). Le film s’est en outre doté de co-scénaristes xhosas et de consultants durant le tournage.
Le réalisateur de Les Initiés s’appelle John Trengove. Il n’appartient pas à la communauté xhosa ce qui a eu une incidence tangible sur la réception de l’œuvre chez une partie des Sud-Africains. De son avis : « Les Initiés est né de mon envie de m’attaquer aux stéréotypes trop souvent associés à la masculinité́ noire au cinéma, en Afrique comme ailleurs » (Renou-Nativel, 2017). Aussi les avis ont-ils fini par devenir très tranchés à l’égard du long métrage, et du fait de son statut de Blanc et du fait que de parler de l’Ukwaluka est interdit dans le pays (alors même que celui-ci dévoile ici l’ensemble de la cérémonie de manière directe). Précisons que Nelson Mandela, lui-même, avait commencé à évoquer l’Ukwaluka (et pour être plus précis la douleur ressentie à ses 16 ans par la circoncision sans anesthésiant) et à briser le tabou dans son autobiographie, Un long chemin vers la liberté́, sortie en 1994.
Au final, le film casse nombre de préjugés. Car nonobstant le fait qu’il aborde des sujets brulants, le traitement qu’il en fait se départit de tout manichéisme. De fait, il pousse à se défaire des préjugés, ne tombant pas dans la facilité d’une relation passionnée envers tout ce qui pourrait lui faire entrave. La libération du carcan social demeure ici quasiment impossible ; le fait de révéler l’homosexualité masculine pour mieux l’assumer finit par placer les personnages dans une situation de plus grande insécurité encore ; enfin, les relations entre les deux hommes, au profil socio-économique fort différent, est loin d’être saine (ascendance/soumission, échange d’argent etc.). Le film constate et n’affirme rien (Pastorino, 2017). Il ne donne pas une vision uniforme. Aucune démonstration simpliste ne se dégage : le spectateur oscille entre l’insoumission douloureuse, payée à prix cher, et la violence sourde du maintien des traditions.
Une autre des caractéristiques du film est de subtilement révéler les antagonismes qui persistent dans la société́ sud-africaine, et ce pas uniquement sur une base raciale – Noirs et Blancs – très connue. On relève les différentiels entre le milieu rural et le monde urbain (selon la zone de provenance des personnages) et entre catégorie populaire et aisée. Tout cela renvoie l’Afrique du Sud à ses (néo)divisons prégnantes, lesquelles se creusent même, et qui sont le négatif du discours inclusif sur la nation arc-en-ciel.
Un ultime trait de particularité du long métrage est qu’il se déroule essentiellement à l’extérieur. Pour autant, à aucun moment, on n’arrive précisément à situer la localisation : il s’en dégage une impression de huis-clos externe. Le film se centre sur les personnages, sur les corps et sur les dialogues. Nul traitement esthétique du décor n’a été réalisé. L’équipe du film s’est d’ailleurs entendue sur une règle infrangible : « pas de National Geographic ! » (entretien du réalisateur avec V. Garnier, 2017). Cela rompt par conséquent avec un certain cinéma sur l’Afrique/du Sud qui magnifie les décors, pour souvent contrebalancer le traitement de sujets durs (à l’instar du cinéma hollywoodien sur l’Afrique… mais aussi du cinéma postapartheid sud-africain, comme vu infra).
En Afrique du Sud, après la sortie du film, des tensions et une animosité se sont exprimées à son endroit. Nombre d’acteurs ont reçu des menaces de mort. Le film a été déprogrammé de certaines salles par crainte de débordements. Dans le fond, Les Initiés va au-delà de la question des Xhosas et de la réalité des communautés traditionnelles en Afrique du Sud. Il met en exergue le paradoxe d’une société́ patriarcale où l’homosexualité́ est toujours tue, souvent montrée du doigt voire combattue (Uzal, 2017). Il faut noter que c’est aussi le cas de beaucoup de pays Africains, certains d’entre eux (Ouganda, Tanzanie, Mauritanie, Nigéria…), ayant une législation criminalisant l’homosexualité. Or le film met l’accent sur le fait que celle-ci est bien réelle et qu’elle est plus ou moins consciemment tolérée et entretenue, du fait de la promiscuité́ même qu’induisent certains rites.
Pour rappel, l’Afrique du Sud dispose d’une Constitution très progressiste sur la question, et le mariage gay est autorisé depuis 2006. Mais les homosexuels subissent toujours des violences et brimades. L’homosexualité́, tout en étant tolérée dans les écrits demeure moralement condamnable (Pajon, 2017). Pourtant, ce qui est intéressant à relever est que le film a provoqué un tollé et des appels aux boycotts non à cause des scènes de sexe entre deux hommes (et d’une potentielle affirmation identitaire) mais parce qu’il « briserait » le caractère sacré d’un pan de la culture xhosa (Ntsabo, 2018). La position est assurément plus aisée car elle permet de s’abriter derrière la culture pour dénoncer ce qui relève de l’intime et du tabou.
Les représentants de la communauté́ xhosa se sont ainsi élevés contre l’œuvre en demandant sa déprogrammation. À leur sens, évoquer le rite que les non-initiés ne sont pas censés connaitre risquait d’avoir comme effet sur eux (ou sur leurs proches) de ne pas/plus vouloir le suivre et dès lors mettre en péril la pérennité de la tradition même2. En outre, afin de faire pression sur les autorités et faisant écho au mouvement de déboulonnage de statues controversées Rhodes must fall (débuté en Afrique du Sud en 2015), un étudiant de l’Université́ du Witwatersrand à Johannesburg, Kamvalethu Spelman, a lancé le mouvement The Wound must fall, littéralement : Il faut faire tomber le film Inxeba : The Wound (Censure & Cinéma, 2017). Certes, le film a aussi eu un soutien de la part de la jeune génération xhosa souhaitant lever le voile sur l’initiation et les dangers qu’elle perpétue et plus largement de la communauté LGBT+. En termes de distribution, il faut noter que c’est la maison Urucu Média qui a accepté de le distribuer, prenant à ce niveau certains risques. En réalité, ce distributeur s’est positionné sur ce créneau pour justement se singulariser (c’est-à-dire faire découvrir des voix discordantes dans le cinéma local et le projeter à l’international). À cette fin, ont été recherchés des financements non conventionnels, en particulier par le biais de coproductions internationales (entretien avec le réalisateur in Africa Vivre).
Après sa sortie, Les Initiés a rencontré un réel succès dans les festivals à l’étranger. Au total, il a été primé d’une quinzaine de récompenses diverses. Présenté́ aux festivals de Sundance (Etats-Unis) et de Berlin (Allemagne), il a été́ primé au London Film Festival (Royaume-Uni) et au Festival de Carthage (Tunisie). Il a même failli être sélectionné aux Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger. En Afrique du Sud, le film est sorti initialement en salles le 2 février 2018 en étant interdit aux moins de 16 ans (16LS), le plus souvent dans les chaines de « Cinéma Nouveau » qui donnent plutôt à voir des films d’auteur ou tenant de la contre-culture en Afrique du Sud. Face à la vague de contestation, plusieurs cinémas, à Port Elizabeth, au Cap ou encore à Johannesburg, ont dû annuler la projection pour des raisons d’appels à la violence. En appel, le 17 février 2018, le Film and Publication Board (FPB) a finalement décidé́ d’interdire Inxeba : The Wound aux moins de 18 ans (X18) pour raison de scènes de sexe, du langage, de la violence et des préjugés véhiculés par le film. Après plusieurs semaines de polémiques, Les Initiés a donc pu de nouveau être diffusé dans les cinémas sud-africains (depuis le 6 mars). Cette décision fut dénoncée par le producteur et le distributeur du long métrage car il est désormais projeté́ dans un réseau de salles réservées aux adultes. Le président de l’association Right2Know, Dale McKinley, y a par exemple décelé un acte homophobe qui porte, selon lui, atteinte aux libertés (Censure & Cinéma, 2017).
En résumé, le film Les initiés a le courage de regarder de front deux tabous de la société sud-africaine : l’homosexualité masculine au sein d’une société très patriarcale et les rites traditionnels, longtemps sacrés, dans une nation qui se veut à la pointe du développement. Au demeurant, ceux-ci ne se rattachent guère au roman national que tente de construire le pouvoir politique et ont pu être vus comment dérangeants auprès d’une partie de la société civile. En attestent les crispations qui ont accompagné sa sortie, alors même que l’œuvre a récolté de nombreux prix sur le plan international dans divers festivals. Le discours sur l’homosexualité, départi de manichéisme, a fini par entrer en résonance avec le courant progressiste mondial, sans oublier les appuis locaux de la part de la communauté LGBT+. La polémique a participé à la notoriété du film ; ce dernier a tout de même fini par être quelque peu invisibilisé, jusqu’à ne plus être diffusé que dans certaines salles locales.
Man on the ground : xénophobie sud-africaine et engagement africain
Le film Man on Ground (2011) narre l’histoire de deux demi-frères, Ade et Femi, qui ont quitté le Nigeria. Leur parcours les sépare. Ade est banquier à Londres ; il est l’archétype d’une immigration réussie. Quant à Femi, il a émigré en Afrique du Sud car dissident politique au pays Yoruba ; il vit dans un ghetto de la zone péricentrale de Johannesburg où il survit de manière informelle. De passage dans la métropole, Ade cherche à retrouver son frère afin de lui remettre un paquet venant de sa mère. Il découvre à ce moment que ce dernier a disparu depuis une semaine. Sur la base d’informations parcellaires, il se met à sa recherche et commence à appréhender l’âpre quotidien de Femi et les difficultés auxquelles il a à faire face in situ. Les personnages secondaires (sa femme et son patron) ne savent pas où il se trouve et se montrent même réticents à répondre à ses interrogations. Au même moment – l’histoire se passe en 2008 lors des premières attaques xénophobes dans le pays –, une émeute éclate mettant aux prises les Sud-Africains noirs et les migrants africains. Restant la nuit entière, par mesure de sécurité, avec le patron de Femi, Timothi, sur son lieu de travail, Ade commence à saisir ce qui a pu arriver à son frère.
L’auteur et réalisateur de Man on Ground est Akin Omotoso, un Sud-Africain d’origine nigériane (son père fut lui-même migrant en Afrique du Sud). Un évènement tragique est à son origine : de l’avis de Fabian Lojede, l’un des principaux acteurs, « l’idée du film est née de […] l’image d’Ernesto Nhamuavhe, le Mozambicain brûlé́ vif au cours des émeutes xénophobes de 2008. Et la première fois que j’ai vu cette photo, j’ai été́ profondément choqué » (Devriendt, 2013). Par conséquent, la toile de fond de l’œuvre devient l’un des épisodes dramatiques qui se déroulent dans une Afrique du Sud postapartheid en proie, à intervalles réguliers, à ces flambées de violences. Rien qu’en 2008, soixante-deux personnes ont été́ tuées dans les émeutes et lynchages, principalement à Johannesburg sur les hautes terres centrales et dans la métropole littorale de Durban (eThekwini). De violents heurts ont aussi éclaté́ en 2013, 2015 et encore en 2019.
Plusieurs caractéristiques intéressantes sont mises en exergue par le film. D’abord, sur la forme, le style se veut minimaliste. Il rappelle de la sorte la production Les Initiés traitée précédemment. On dénote l’usage de couleurs sombres en relation avec des scènes se déroulant la nuit dans un halo de brouillard, tantôt dans des zones industrielles et ferroviaires ou des rues anonymes, tantôt en intérieur dans des bureaux froids et sans âme. L’œuvre est centrée sur les dialogues entre les personnages. Le film pourrait se rattacher à deux types de cinéma. Officiellement, il se proclame à la fois sud-africain et nigérian. Par l’origine de son réalisateur, il regarde autant du côté du Cinéma de Nollywood que du Cinéma postapartheid. Cependant, à l’inverse de ces deux derniers genres ayant en commun de donner à voir les problèmes sociaux et sociétaux, aucun usage de couleurs éclatantes n’est ici visible. Au contraire, une sobriété dans le traitement de la photographie est de mise. Le film pourrait se dérouler dans n’importe quel cadre urbain pour le moins austère (Ugochukwu, 2016). Tout cela accentue la de-personnification et la solitude des protagonistes, partageant tous ce sentiment d’être étrangers dans cette Afrique du Sud tant convoitée. Les gros plans sont privilégiés ; quelques ralentis sont présents à des moments précis avec des retours en arrière ; enfin des voix hors champs décryptent les pensées. Cela concourt a un film très cérébral et fonctionnant à la manière d’engrenages retissant un fil chronologique tragique.
Sur le fond, Man on Ground, se centre sur un sujet extrêmement sensible, pour ne pas dire tabou en Afrique du Sud : la xénophobie africaine – quand bien même la pertinence de ce terme peut être discutée. Car il s’agit plutôt d’une xénophobie de certains Sud-Africains vis-à-vis des migrants africains. Le terme « xénophobie africaine » prête à confusion car ce ne sont pas les « Africains » qui sont xénophobes ; ils sont victimes de la xénophobie. Il s’agit donc d’un pamphlet destiné à combattre frontalement cette réalité. Le film a ainsi reçu l’appui de l’OIM - International Organization for Migration (OIM - ONU Migration, 2013). Par le biais d’une itinérance cinématographique, il fut projeté du 5 au 19 avril 2013 dans quatre provinces d’Afrique du Sud dans le cadre de la campagne d’information Tell Them We Are From Here (« Dites-leur que nous sommes d’ici »)3. Sur le continent, les émeutes xénophobes sud-africaines choquent littéralement. Elles sont d’autant plus incomprises, que le pays a bénéficié du soutien des autres pays du continent durant sa lutte contre le régime d’apartheid. Le traitement qui est fait aux ressortissants est donc perçu comme une véritable meurtrissure et une haute trahison, le Nigéria ne faisant pas exception.
La dernière caractéristique intéressante du film, toujours sur le fond, est de mettre en lumière une autre composante des migrations économiques dans le monde, la plus importante mais pas forcément la plus traitée médiatiquement : les migrations Sud-Sud. On l’a dit, à la fois le style comme la mise en scène du film témoignent du profond isolement des immigrants, de l’animosité à laquelle ils ont à faire face sur le terrain, cumulée à une situation d’absence de soutien, sans nouvelles des familles/proches et détachés de leurs racines. Ce sentiment de désespoir donne ici à voir une trajectoire différente de celle qu’a suivi le frère de Femi (Ugochukwu, 2016). Ade a pour sa part réussi à se faire une place en Angleterre alors que l’avenir de Femi demeure un rêve qui ne s’est jamais concrétisé. La réflexion sur l’immigration Sud-Sud est lapidaire, sans concession. Sans doute pourrait-elle être vue comme trop stéréotypée (à l’observation critique de l’immigration Sud-Nord…), mais cela a le mérite de rappeler cette réalité.
Rappelons qu’en Afrique, presque la moitié des migrants restent sur le continent. Les chiffres attestent que 28% d’entre eux émigrent vers l’Europe, 14% vers l’Asie et 0,9% vers l’Amérique du Nord. À cela, il faut ajouter qu’un tiers des migrants africains sont hautement qualifiés (Jinnah, 2016). Selon, Nséké (2012), on assiste à une diversification des pays prisés par les migrations économiques, du fait de l’avènement de quelques États relativement forts et stables sur le continent, économiquement et politiquement. Soit de nouveaux pôles d’immigration continentaux (Mboungou, 2012). Par exemple, La Côte d’Ivoire exerce à présent un haut potentiel d’attraction. L’Afrique du Sud reste tout de même celui qui accueille le plus d’immigrés, refugiés compris, en lien avec sa réussite économique, son statut de puissance émergente – il appartient aux BRICS –, et sans doute l’aura qu’il tire de sa longue lutte antiapartheid et des héros qui l’ont portés. De nos jours, ce serait entre 3 et 5% de la population du pays qui serait comptabilisée comme immigrée (Denys, Holzinger, Pravettoni, 2019). Les étrangers de la zone Afrique australe résident plutôt dans les cabanes des périphéries des villes, alors que les appartements ghettoïsés proches des centres abritent beaucoup d’Africains des contrées septentrionales. Les migrants nigérians seraient eux un peu plus de 30 000 selon les données officielles (Statistics South Africa’s 2016 Community Survey).
Le pays a historiquement été intéressé par les flux migratoires. Un bassin régional existe depuis longtemps associé aux besoins de main-d’œuvre dans le secteur minier et, dans une moindre mesure, agricole. Ce tropisme a caractérisé tout le 20e siècle (Folio, 2008), induisant la mise sous influence des États voisins. Dans un contexte postapartheid ouvert et démocratique, le pays est apparu comme un point de fixation, une nation moderne et performante (Véron, 2006), Cela a alimenté une migration plus fluide. Mais face aux difficultés internes et à une opinion civile réticente, l’Afrique du Sud a modifié sa législation en matière d’immigration en 2002, rendant l’entrée de travailleurs peu qualifiés moins aisée. Cela s’est effectué dans un contexte de montées des inégalités économiques, de chômage élevé, de services publics défaillants et de contigüité ce qui a alimenté le cycle de suspicion puis de violences. Une enquête d’opinion conduite en 2008 par l’institut World Values Survey a ainsi démontré que la nation arc-en-ciel compte parmi pays les plus xénophobes du monde (Pitron, 2012).
Les migrations sont perçues sous l’angle de l’intégrité territoriale, de la souveraineté́ nationale, de l’idée de la « barrière » sur fond d’enjeux socio-économiques. C’est là où se situe une certaine hypocrisie sud-africaine. Localement, les chefs d’entreprises sont très demandeurs d’une main-d’œuvre formée, peu coûteuse et peu exigeante. Le pouvoir politique et judiciaire condamne lui l’immigration économique illégale en rendant la vie des migrants compliquée (avec de nombreuses arguties administratives), ce qui les maintient dans une position de vulnérabilité. Il s’en sert aussi comme boucs émissaires faciles de sa propre incurie. Face à cela, les populations des quartiers précaires, frustrées de ne pas voir les fruits du changement démocratique avec la diligence escomptée, ont fini par se retourner contre ces personnes venues prendre « leurs » emplois dans un des pays les plus inégalitaires au monde. On les suspecte de profiter des investissements ou des services longtemps attendus (Tati, 2008). Des organisations anti-migrantes se sont constituées en opération « Dudula » (« expulser » en zulu). Le sentiment anti-immigrant se nourrit parallèlement des torts qui leur sont attribués (délinquance, sida…) induisant la rhétorique xénophobe. La communauté nigériane, pour sa part, est suspectée de participer aux trafics de drogues et à la vente de produits de contrefaçons. Mozambicains, Malawites, Zimbabwéens et Africains septentrionaux notamment francophones sont ainsi devenus la cible parfaite face aux manquements gouvernementaux, chez une population noire interne toujours confinée en majorité dans les townships urbains, les bidonvilles et les ex-bantoustans ruraux.
Le gouvernement sud-africain et les autorités en charge de l’application des lois réfutent le terme de violence xénophobe, non en phase avec le roman national. Ils prétendent que ces violences sont de nature exclusivement criminelle. Pourtant, selon l’ONG panafricaine African Diaspora Forum (2019), elles seraient institutionnalisées. Ayant débuté en 2008, poursuivies sous les présidences de T. Mbeki, J. Zuma et C. Ramaphosa, elles seraient un moyen pour la classe politique de détourner le regard et de se reconnecter avec les citoyens (Ribadeau Dumas, 2019). Sans doute le terme de xénophobie n’est-il pas tout à fait adapté, le pays restant par ailleurs très ouvert (investissements, tourisme). Le terme d’« afrophobie » (terme employé par l’historien camerounais Achille Mbembe et repris dans un article de Courrier International en 2015) pose lui aussi un problème sémantique car les ressortissants Africains aisés ou de la classe moyenne venus faire du tourisme de shopping dans le pays ne sont pas aux prises avec le problème ; celui-ci concerne véritablement la classe laborieuse (cf. travaux de C. Fournet-Guérin, 2019 sur la working class africaine à Maputo) venue ici chercher de meilleures conditions de vie.
Pour en revenir à Man on the Ground, il fut lancé au festival du film de Toronto au Canada en 2011. L’éventail conséquent de sélections officielles à Toronto, Lagos et Dubaï en 2011, à Berlin et à Durban en 2012, ainsi que les nombreux prix obtenus valident un certain retentissement autour de lui (Ugochukwu, 2016). Parmi les prix amassés, on peut énumérer un joli palmarès : Meilleur film au festival du film de Johannesburg ; meilleure équipe d’acteurs au festival du film de charité́ (Monaco, 2012) ; meilleur film sud-africain au 10e festival du film tricontinental (2012) ; meilleur film pour son réalisateur, sa cinématographie, son édition et sa qualité́ de son au Africa Magic Viewers’ Choice Awards (groupement de chaînes de TV payantes sur le continent, Lagos, 2013). Le film fut aussi récompensé au Jozi Film Festival et aux African Movie Academy Awards. On perçoit donc un engouement dans les festivals, notamment ceux des pays émergeants et surtout sur la scène africaine, ce qui n’est finalement pas très étonnant au regard de l’émoi que ces évènements provoquent sur le continent.
En résumé le film Man on the Ground est sorti assez loin des codes habituels. Il émarge plutôt aux circuits underground. Film à la fois sud-africain et nigérian (pour le sujet traité, les acteurs et la bi nationalité du réalisateur), il ne ressemble ni vraiment au genre Nollywood, ni au cinéma postapartheid qui alignent tout deux une forme et un esthétisme appuyés au traitement de sujets de société. Ici le genre se veut délibérément épuré pour avant tout montrer, crûment, une réalité qui heurte particulièrement sur le continent. Le film s’est lancé dans une itinérance dans le pays pour parler d’un problème réel, non abordé frontalement par le gouvernement en place et brisant l’image de l’héritage romanesque de la lutte contre l’apartheid endossé par N. Mandela ou D. Tutu. Il en résulte un long métrage surtout plébiscité par de nombreux prix sur le continent africain tout en restant (encore) assez peu connu dans les pays du Nord.
Conclusion
L’Afrique du Sud est parvenu dans le cercle restreint des nations dites « inspirantes » en particulier après 1994. Parmi les ingrédients de son soft power, on trouve son industrie cinématographique, Callywood, qui se définit à la fois par le lieu de tournage de productions internationales et à la fois en tant que productrice d’œuvres internes novatrices et stimulantes (dans les genres cinématographique et sériel). Certes, sur un registre formel, le cinéma sud-africain postapartheid peut paraître convenu. Les codes cinématographiques, enchâssés dans une mondialisation culturelle d’atmosphère adossée à un héritage anglo-saxon, demeurent robustes. Simultanément et sur le fond cette fois, ces œuvres fixent droit dans les yeux les maux du pays, sans doute pour mieux les exorciser. À ce niveau, on peut évoquer un cinéma courageux et cathartique. Il trouve sa traduction dans les valeurs que la nation arc-en-ciel porte en elle et qu’elle entend diffuser en interne et simultanément projeter au monde. En somme, le roman national s’attache à « travailler » le passé pour mieux le conjurer, reconstruire le présent et préparer l’avenir (Folio, 2012). Les marqueurs de ce genre sud-africain sont à ce moment son histoire tumultueuse, les problèmes sociaux et sociétaux hérités, la réconciliation et la reconstruction nationale (Tomaselli, 2006). L’aboutissement en est un cinéma créatif, hybride par bien des aspects, faisant son originalité́.
Ce cinéma se complexifie depuis quelques années. Cette dynamique accompagne la fin du « miracle sud-africain ». Le pays se banalise quelque peu dans le concert des nations et est, dans le même temps, tiraillé par de nouvelles problématiques endogènes. Les films abordés dans les dernières parties ont en commun de montrer une autre image de la nation sud-africaine. Celle non plus en proie à ses démons historiques directement rattachés à la politique d’apartheid et appuyés par la classe politique, mais ceux nouveaux, à la temporalité plus récente, distordant quelque peu l’image que le pays aime à se donner à voir à l’international. En cela, ils tiennent davantage d’un soft power indirect, lié à une nation qui mûrit (bien que laborieusement) ; en somme, non-plus une nation adolescente mais un pays accédant à l’âge adulte. Ils ne se rattachent plus sans doute également au courant postapartheid, mais à une société résolument hybride, nantie de toutes ses complexités et de ses contradictions.