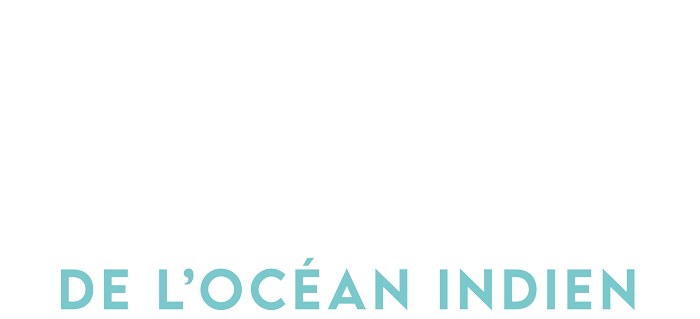Introduction
Du pacte vert pour l’Europe, au plan de Relance1 ainsi que le plan Transitions 2050 en France2, la littérature grise des politiques publiques est traversée par le concept de transition pour évoquer la transformation de leur territoire3. L’engouement pour le concept de transition est récent. D’abord mobilisé dans le champ de l’économie dans les années 1930 autour des enjeux de démographie, la notion de transition se cristallise, à partir des années 1970, autour de la « crise énergétique », par une remise en question du capitalisme industriel fossile. Ce discours se trouve alors porté aux États-Unis et en Europe par des chercheurs alarmistes. Certains d’entre eux sont mandatés par des institutions internationales et suivis par des citoyens organisés en mouvements revendicatifs. Le concept de transition se trouvera alors mobilisé dans la communication institutionnelle des pouvoirs publics pour évoquer, dans de nombreux rapports et plans, la « transition énergétique » en corrélation avec le concept de développement durable.
La transition devient « un mot valise » que certains chercheurs préféreront concevoir comme « objet d’étude »4 plus qu’un concept, de par les jeux d’acteurs qui la définissent. Ainsi la rhétorique autour de la transition renvoie essentiellement à « la crise », « l’approche systémique » « la résilience » « la démocratie participative », « la transition juste » au service d’une épistémologie du changement. Cependant quelle que soit la forme expressive ou suggestive, la définition de la transition sous le prisme écologique s’inscrit dans un rapport de force entre les sociétés du Nord et du Sud. La notion de « transition juste » est reprise par certains courants comme celui des épistémologies du Sud, pour aborder la question des particularités culturelles des pays du Sud comme point d’ancrage pour les changements comportementaux vis-à-vis de l’environnement. La « transition juste » est ici évoquée pour parler d’une transition équitable, inclusive et socialement protectrice comme alternative à « l’extractivisme excluant » du modèle capitaliste. Le courant des épistémologies du Sud développé par Boaventura de Sousa Santos5 encourage une réflexion sur la production de la connaissance à partir des pays dominés par les épistémologies occidentales.
Ainsi, par un regard situé dans le Sud, nous proposons d’aborder les problématiques de transition sociétale par le prisme de la médiation culturelle des territoires de l’Indiaocéanie comprenant les régions au sud-ouest de l’océan Indien (Madagascar, l’archipel des Comores, des Mascareignes et des Seychelles). Ici le Sud n’est pas simplement considéré comme une entité géographique mais comme le suggère Soussi Sid Ahmed, Sadik Youssef6, comme espace symbolique de réflexion autour de dominations culturelles, économiques, géopolitiques7 au sein de sociétés post-coloniales comme celles de l’Indiaocéanie. Nous verrons comment les enjeux de diplomatie scientifique par les sciences de la durabilité dans le Sud abordent la problématique « des transitions justes » en mettant au cœur l’approche culturelle des territoires, pour discuter des changements globaux.
La place de la recherche dans les études sur les transitions sociétales
L’analyse des phénomènes de transitions sociétales8 comme processus de transformation des sociétés reste complexe de par la polysémie de la notion de transition mobilisée dans des contextes multiples par des acteurs divers. Ainsi, comme l’indique Léa Boissonade9
Qu’elle soit écologique, énergétique, sociale, solidaire, économique, démocratique, numérique ou encore managériale, la transition se caractérise par une transformation profonde des systèmes. Une pluralité d’acteurs se revendique du concept de transition : la recherche s’attelle à en identifier les ressorts, les institutions souhaitent en dessiner les orientations et la société civile s’engage et l’aiguillonne à travers des expérimentations innovantes.
La notion est reprise à la fois chez les chercheurs, les politiques, les mouvements sociaux et les entreprises à la fin du XXe siècle pour évoquer essentiellement le passage à de nouveaux modèles économiques et sociétaux dans un contexte d’urgences et de crises écologiques. Ainsi, les premiers travaux scientifiques sur la transition en sciences humaines et sociales désignent le passage d’un état d’équilibre à un autre supposé en sciences de l’économie. Ils sont rattachés aux recherches menées par Adolphe Landry10. Pour analyser la dépopulation française dans les années 1930, l’économiste parle de la « théorie de la transition démographique », qui pose le concept de transition comme un processus expliquant les transformations d’une société à la recherche d’un « régime nouveau », dans un contexte d’instabilité économique.
Dans les années 1990, les recherches sur les transitions vont s’orienter autour de deux champs, qui vont préfigurer les études telles que nous les connaissons aujourd’hui, à savoir : les recherches sur l’innovation et les recherches environnementales des sciences de la durabilité11. Ces travaux essentiellement européens viennent répondre aux problématiques des crises environnementales comme le changement climatique ou la raréfaction des ressources. Elles se sont structurées autour de la création, en 2009, du réseau international d’universitaires sur les transitions durables Sustainable Transitions Research Network (STRN)12 et, en 2011, de sa revue Environmental Innovation and Societal Transitions. Ces recherches interdisciplinaires sont liées au paradigme du développement durable. Elles mobilisent le concept de transition pour décrire des mutations profondes sur le long terme (40 à 50 ans), vers de nouveaux modèles de sociétés grâce aux innovations technologiques présentées comme des « innovations de ruptures »13. Dès lors, ces études vont s’engager dans une démarche de prescriptions pour les politiques gouvernementales pour la gestion de transitions de systèmes géographiquement délimités (les quartiers, les villes) à travers l’analyse de systèmes sociotechniques (la mobilité, l’énergie, l’agriculture). Ainsi, dans les discours politiques, les termes d’« innovation pour la durabilité », de « transition » et d’« innovation systémique », sont apparus, amenant progressivement une institutionnalisation, par les acteurs des politiques publiques, du « concept de transition ». La transition est déclinée dans divers plans, documents des politiques publiques autour des problématiques écologiques et énergétiques. Ces derniers viendront alimenter les revendications des mouvements de citoyens altermondialistes des pays du Sud dans les années 1980 contre la globalisation du capitalisme14. La transition est alors mobilisée pour penser par exemple des modèles de Villes en transition impulsés par Rob Hopkins en 200615 où le changement est « relocalisé » à l’échelle des quartiers, des villes, des régions par des actions menées par des citoyens selon une vision systémique. La réflexion à plus petite échelle conduit les acteurs économiques à proposer de nouveaux modèles économiques comme l’économie de la fonctionnalité, l’économie circulaire, l’économie sociale et solidaire pour penser les transitions sociétales.
Ainsi, l’implication des divers acteurs comme les scientifiques, les politiques à l’échelle internationale, européenne, locale, les citoyens à travers les mouvements altermondialistes ou de Villes en Transition, les entrepreneurs, a amené à penser des espaces de concertation comme La Fabrique des transitions16 . Ces derniers proposent d’aborder l’urgence des transitions sociales par la mise en place de recherches interventionnelles.
Dans ce sens, une étude menée de 2019 à 2022, intitulée Isopolis17, nous a permis de mener une réflexion sur la manière dont certains acteurs ont pensé la transformation du territoire de La Réunion vers un modèle sociétal résilient de son passé colonial dans un contexte d’adversités croissantes18 entre les groupes sociaux et vis-à-vis des politiques. Ce modèle été basé sur la co-construction d’une dynamique territoriale systémique pour ne plus penser en silo le développement économique, social et culturel). Dans ce cadre, la mise en place d’un laboratoire territorial intitulé ISOLAB a réuni quatre acteurs de la gouvernance territoriale : l’action publique, le monde économique, la société civile et le monde académique de la recherche. L’enjeu était de penser un modèle d’analyse de la société réunionnaise à partir du modèle de la stratégie de conduite de changement basée sur la recherche interventionnelle. Cette dernière s’inscrit dans la lignée de la recherche-action dont l’enjeu est de développer des recherches avec et pour des acteurs. Par la recherche interventionnelle, il s’agit, comme l’expliquent Stassart, Marc Mormont et Daniel Jamar, de produire de la connaissance au service des acteurs et « de définir un système permettant à la fois de connaître et d’agir, c’est-à-dire mettre en œuvre une action collective »19. Cette posture est d’autant plus complexe à maintenir pour le chercheur à l’action. En effet, ils sont amenés constamment à définir les frontières de son champ d’intervention auprès « des acteurs de l’action » et de développer un système de connaissances des réactions de ces derniers.
Il existe donc au cœur des projets de transition tout un protocole de recherche basé sur la mise en place « d’un processus, d’une histoire continue faite de déplacement et de glissement » que Stassart, Mormont et Jamar20 définissent en trois phases. La première phase comporte un diagnostic partiel, moment où les chercheurs vont identifier les recherches possibles, les questionnements et les problématiques que le sujet pose. La deuxième phase est la construction d’un partenariat. C’est le passage à l’action collective où il s’agit pour le chercheur de poser une démarche d’organisation et de recherche. La troisième phase est celle du bilan mettant en avant la façon dont la recherche-interventionnelle accompagne les questions que pose la transition. La construction progressive du dispositif de recherche suppose une série de traduction au sens de Michel Callon21 autour de la discussion de l’identité des acteurs voire même « de la négociation autour de leur identité ». Cette dernière s’inscrit dans « une controverse ou désaccords […] qui portent sur des enjeux scientifiques ou techniques ou sur la constitution de la société »22. L’action collective nécessaire à la transition est rendue possible dans la mesure où la question de recherche tient compte des différents points de vue des acteurs et devient ainsi un enjeu pour tous sans se perdre dans le débat scientifique entre la recherche fondamentale, la recherche-action en sciences humaines et sociales.
Selon Elisabeth Gardère23 ce paradigme hybride entre recherche et action positionne le chercheur dans une posture de négociation entre une distance critique et les résultats attendus. Ces derniers sont ancrés dans l’action des acteurs de la co-construction du projet d’étude où la question de « malentendu »24 devient un point central d’accroche entre les acteurs impliqués dans les projets de transitions, à savoir : le politique, la société civile, l’acteur économique et la recherche. L’un de ces « malendus » s’appuie sur le regard que certains acteurs de la société civile portent sur la posture de chercheur apportant la « vision d’une société du Nord déconnectée du terrain réunionnais »25. Ce regard repose sans cesse cette question du rapport Nord/Sud pour penser les transitions.
Posture épistémologique : Penser les questions de transition à partir du Sud
Ainsi, les différents discours sur les crises et solutions de transition qui se succèdent depuis les années 1970 trouvent écho dans une vision de rapport de force entre Nord et Sud. Comme l’explique Ewa Bogalska-Martin26
La particularité de cette « crise » réside aussi dans le fait qu’elle met en évidence une certaine conception de l’organisation du monde, féconde en situations productrices de déséquilibres qui peuvent êtres appréhendés comme phénomènes de crise, soit structurels, soit conjoncturels. Il s’agit du grand projet sociopolitique de « la modernité », qui doit être vu, à la fois comme capitaliste, libéral et marchand. Il s’agit du modèle d’organisation de la société que nous, les occidentaux, avons imposé au monde entier sous le nom de « modernité », « développement », « efficacité », « rationalité ».
Ainsi, dans cette perspective, les crises successives sont abordées au travers d’une rhétorique d’opposition Nord-Sud autour des questions de mondialisation du capitalisme. Pour Dominique Plihon27, les mouvements de citoyens tels que celui des altermondialistes ont basé leur manière « de penser et agir global » autour de la critique de la mondialisation néolibérale. Elle constitue « un contre-pouvoir » autour des thématiques du tiers-mondisme, de l’anti-colonialisme, de la question du genre et de l’écologie, essentiellement à l’encontre de l’hégémonie de la mondialisation financière28. Comme l’indique Dominique Plihon, il s’agit donc pour les altermondialistes de lutter contre « la marchandisation de la planète ». Cette dernière crée un rapport de déséquilibre d’ordre social et économique entre les pays du Nord et les pays du Sud dans un contexte de domination culturelle. C’est ce qui a été reproché à ses début aux mouvements de la transitologie. Apparu dans les années 1980, le courant de la transitologie s’est développé pour accompagner le changement de régime politique de pays d’Amérique Latine et d’Afrique dans un contexte de pouvoir autoritaire, ainsi que les pays de l’Europe centrale et de l’Est dont le régime politique et économique s’effondrait. Ainsi, comme l’indique Grosescu Raluca29, la première vague de penseurs en transitologie considérait que la consolidation d’une démocratie devait passer par les valeurs de l’Occident et ses modèles capitalistes de modernisation. Par conséquence, les spécificités économiques et culturelles des pays accompagnés30 n’étaient pas pris en compte. Cette vision du développement « d’une démocratie de marché » de la transitologie dans les années 1980, a constitué pendant des années, une « idéologie pour les acteurs de la coopération internationale et un cadre pour les politiques de réformes structurelles mises en œuvre par les bailleurs de fonds »31. Pour Mélanie Champoux et Adolfo Agundez-Rodriguez32, le modèle occidental s’est construit sur des dichotomies entre sujet/objet, entre science et culture, entre réflexion et action, entre nature et culture. Cette vision basée « sur l’hégémonie de la rationalité moderne occidentale » serait l’une des causes du changement climatique. Selon plusieurs auteures et auteurs, pour sortir de la crise climatique, l’humanité a besoin d’une « transformation civilisationnelle »33. Pour ceci, Mélanie Champoux et Adolfo Agundez-Rodriguez font référence à « la justice sociale, environnementale et écosociale » selon la vision développée par le courant des épistémologies du Sud. Le terme de justice renvoyant ici à l’équité, l’inclusion de l’ensemble des composantes d’une société au sein des transformations d’une société.
Développé dans les années 2000, par Boaventura de Sousa Santos, le courant des épistémologies du Sud s’est développé autour de la théorie critique d’une vision eurocentrée du monde que l’auteur juge « épuisée » face aux différentes situations de crise qui réclameraient une remise en question des connaissances occidentales
La compréhension du monde dépasse largement la connaissance occidentale du monde. Cela veut dire, de manière concomitante, que la transformation progressive du monde peut emprunter des chemins qui n’ont pas été prévus par la pensé critique occidentale (y compris le marxisme)34.
Dans ce sens, Boaventura de Sousa Santos revendique de nouvelles relations entre différents types de savoirs à l’encontre de l’injustice sociale que les savoirs cartésiens occidentaux, selon lui, induisent. Elles viendraient résoudre la crise climatique devenant aussi une crise socioécologique. Il revendique une écologie du savoir basée sur les traditions des sociétés du Sud, s’appuyant sur la traduction interculturelle reconnaissant le vivant, le cognitif et l’émotif en opposition à « l’hégémonie de la rationalité moderne occidentale »35. Le rapport Nord-Sud discuté autour « d’une évidence que la science occidentale est au service du capitalisme » lui sera reproché par certains chercheurs comme Éric Dacheux36. Cependant cette question de justice sociale et environnementale impliquant des discours sur les inégalités entre le Nord et Le Sud est aussi discuté par des courants moins controversés.
Ainsi, dans les années 2000, la communauté de recherche sur « la justice environnementale » s’est développée dans le cadre de l’alliance de recherche mondiale Earth System Governance Project. Suite à la déclaration d’Amsterdam sur le changement global en juillet 2001, les communautés scientifiques des quatre programmes internationaux de recherche sur le changement global reconnaissent « qu’à la menace d’un changement climatique important s’ajoute une inquiétude aggravée quant aux modifications sans cesse croissantes par l’homme d’autres aspects de l’environnement global et à leur implication pour le bien-être de l’humanité »37. Dans ce cadre, Earth System Governance Project apparaît en 2009 pour développer des projets de recherche en sciences humaines et sociales en réponse au changement global provoqué par le dérèglement climatique. Ainsi, comme l’expliquent Elisabeth Dirth, Frank Biermann et Agni Kalfagianni (2020 : 1)38, cette communauté va essentiellement porter des projets autour d’études sur la marginalisation des communautés les plus pauvres qu’ils considèrent comme les premières victimes de la détérioration de l’environnement en mobilisant le concept de « justice environnementale ». Ces derniers renvoient à la fois à la dimension « d’égalité des chances », de « principe de différences » qui doivent être assurés à l’intérieur de l’État-Nation par les institutions39.
Quelles que soient les acceptions utilisées, la « justice sociale », la « justice environnementale » évoquent, face aux défis environnementaux et systémiques mondiaux, l’évolution vers une « transition plus juste ». Pour Harald Winker40 « une théorie des transitions justes doit expliquer comment passer d’une voie de développement à forte intensité de carbone à une voie de développement à faible émission de carbone, tout en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte ».
Ainsi, ce rapport entre le Nord et le Sud discuté dans les études sur la transition nous amène à concevoir ces observations sous l’angle des jeux acteurs, pouvant s’inscrire dans des jeux de diplomatie que la science, dans certains contextes, peut accompagner.
L’Indiaocéanie comme espace d’enjeux de diplomatie scientifique pour aborder les questions de transitions sociétales
Dans le cadre du colloque Universités et transitions qui s’est tenu à l’université de La Réunion en 202241, la question des transitions sociétales dans l’Indiaocéanie a été abordée sous le prisme de la diplomatie scientifique. Selon Pierre-Bruno Ruffini42 « la diplomatie scientifique désigne en première approche le champ particulier des relations internationales où s’entrecroisent les intérêts de la science et ceux de la politique étrangère ». Selon l’auteur, il y a trois dimensions de la diplomatie scientifique. La première est « la diplomatie pour la science » basée sur des accords de coopération scientifique et technologique entre les gouvernements. C’est le cas par exemple du positionnement de l’Europe dans la zone océan Indien par les signatures de convention de financement comme le fonds Interreg, de conventions de recherche entre les universités, les organismes de recherche, les ambassades pour la mobilité des chercheurs ou des étudiants. La seconde dimension de la diplomatie scientifique est la « science pour la diplomatie » où les relations scientifiques peuvent prêter main-forte à la diplomatie lorsque que les tensions politiques entre pays ne permettent pas à la diplomatie traditionnelle de s’exprimer. C’est le cas par exemple de certaines recherches menées sur la reconnaissance des oubliés au cœur des conflits des Chagos43. Enfin, la troisième dimension, la « science par la diplomatie », renvoie à certains dossiers de politique étrangère qui requièrent les éclairages de la science, ceux notamment qui découlent de l’application des conventions internationales portant sur des questions d’environnement, de santé ou de sécurité. C’est le cas par exemple de certains projets d’organisme de recherche comme l’IRD ou le CNRS. Comme l’explique Pierre-Bruno Ruffini (2019), les objectifs de la diplomatie scientifique sont d’abord d’attirer « les cerveaux » dans le but d’une économie de la connaissance. Il souligne que « les pays, ou au moins, les plus puissants d’entre eux, sont en situation de concurrence directe pour peser sur le partage mondial de cette matière grise ». La diplomatie scientifique s’inscrit aussi dans les stratégies de coopération internationale ; « elle est un facteur de modération des tensions internationales, de normalisation des relations interétatiques, de renforcement de solidarités existantes »44. Enfin, cette dernière devient aussi un levier d’influence par le soft power.
Ainsi pour Emmanuelle Garnier, présidente des relations internationales et européennes (CORIE) de France universités :
La stratégie internationale des universités se fonde sur la réalité de la mondialisation actuelle qui implique un positionnement géopolitique, des actions (locales, nationales, internationales), valeurs et principes universitaires dans nos échanges avec le monde, principe de l’universalité des savoirs, nécessité de l’hétérogénéité et non pas une homogénéisation. L’international représente un potentiel de ressources propres à travers les appels à projet internationaux présent dans les stratégies d’image de nos universités, de compétitivité qui peuvent entrer en tension avec la question des valeurs45.
Pour Laurent Amar, adjoint à l’ambassadeur délégué de la coopération régionale dans l’océan Indien46,
Il ne s’agit pas d’instrumentaliser les universités mais c’est aussi de se rendre compte que les universités sont des acteurs dans la coopération (…) la position géographique de La Réunion est exceptionnelle, à la croisée de deux zones qui vont faire l’avenir du monde, l’Afrique et l’Indo pacifique (…) On n’a pas le choix, la France doit s’engager dans cette bataille de l’influence.
Pour Guillaume Gellé, président de France Universités, le rôle des universités françaises dans la zone Océan Indien est d’inciter à la création d’outils spécifiques avec l’aide d’organismes tels que l’AUF, pour préparer aux enjeux de développement économique des territoires en formant à des métiers que l’on ne connaît pas encore comme ceux liés à la transition numérique ou à la transition énergétique. Il dira qu’avec
L’équilibre mondial qui se joue dans cette zone du canal du Mozambique, Indo-pacifique, le rôle des universités est d’essayer de réfléchir à des solutions. 1 euro dans une université génère 4 euros d’impact économique. Comment aider les différents états à se développer en matière de recherche, d’innovation, de formation ? »47.
La diplomatie scientifique en lien avec la question de la transition sociétale aborde l’intérêt de la recherche dans l’océan Indien surtout sous les angles du changement climatique, de la biodiversité, de l’écosystème marin, de l’observatoire, des changements globaux, des pollutions, avec des acteurs comme le CNRS, l’IRD, l’IFREMER, l’Université de la Réunion, l’École d’architecture, les TAAF. Les questions de durabilité des ressources sont étudiées (IFREMER, CIRAD, IRD). Les questions autour du soft power en matière d’éducation, culture et science, développement du multilinguisme avec l’évolution de la politique de la Francophonie sont aussi abordées au même titre que la Santé et les risques infectueux (IRD, CNRS, INSERM). La transition sociétale, au sens d’Edgar Morin, aborde la métamorphose de d’une société à l’échelle systémique (économie, culture, éducation, rapport au vivant)48.
Ainsi, la question des transitions est peu abordée sous l’angle des particularités culturelles et pourtant ces dernières sont au cœur même des débats sur L’Indiaocéanie.
L’analyse des transitions sociétales dans l’Indiaocéanie par le prisme de la médiation culturelle
L’analyse des transitions sociétales appliquée aux territoires de l’Indiaocéanie est abordée dans la feuille de route de la Stratégie de spécialisation intelligente pour un développement social & soutenable (S5) pour les fonds européens 2022-2027 dans la rubrique « Pour des sociétés post-coloniales, multiculturelles et insulaires, inclusives »49. Il y est noté que « L’ambition est de transformer les défis de l’insularité en opportunités pour concevoir et déployer des solutions basées sur la connaissance pour une société résiliente ».
La mise en œuvre d’une feuille partagée sur les sociétés inclusives offre ainsi l’opportunité – de fédérer et de valoriser les expertises dans un cadre commun encourageant les approches pluridisciplinaire – de renforcer les connexions, en développant des partenariats avec des réseaux de recherche et d’innovation européens et internationaux – de répondre aux défis du territoire par des solutions exportables également vers d’autres territoires de la zone océan Indien, de métropole, de l’Union Européenne et du reste du monde qui présentent ou pourraient présenter dans les années à venir des caractéristiques comparables50.
En ce sens, l’insularité située dans l’océan Indien nous amène à questionner à nouveau l’Indiaocéanie définie par Jean-Michel Jauze comme « un concept en tant que construction en devenir, forgée dans le substrat d’un héritage culturel commun, s’alimentant d’une solide volonté de le promouvoir en tant qu’identifiant reconnu et partagé, sur la scène internationale »51. Ce « commun culturel » intégrant les îles du Sud-Ouest de l’océan Indien « demande à être rediscuté au regard de la stratégie diplomatique indo-pacifique, entre autres, au sein d’une perception d’une Indiaocéanie élargie aux influences culturelles de l’Afrique, de l’Inde, de l’Asie, de l’Australie, du Yémen, de l’Europe »52.
Il nous semble ici que les questions de transitions sociétales dans l’Indianocéanie, en tenant compte des « héritages culturels communs », peuvent être observées en considérant non pas uniquement la question de la spatialité pour définir « ce territoire du commun » mais en l’abordant, selon Brun Raoul53, comme espace sensible à travers le concept de territorialité. Celui-ci permet de rendre compte de la fonction de médiation du territoire entre discours médiatiques et pratiques territorialisées54. Le territoire peut être observé, selon Julia Bonacorssi, « comme ensemble emboîté de perspectives culturelles […] les habitants redessinent constamment par certains de leurs actes les bords de leur territoire de vie »55. Ainsi, dans diverses recherches que nous avons menées depuis 2011, nos études ont porté sur l’analyse de la dimension communicationnelle du territoire. Dans ce sens, l’approche par la médiation culturelle a été développée, dans des recherches menées sur la patrimonialisation culturelle (Parego56), sur la résilience culturelle (Isopolis57), sur la ville durable (Popsu58), sur les récits de territoires (Culture et territoire59). Cette dernière va consister à analyser le territoire selon les logiques médiatiques de l’exposition, au sens de Jean Davallon60, comme un espace symbolique dont la dimension communicationnelle donne à observer les dynamiques de construction sociale autour d’une mémoire collective
Il n’est point de mémoire collective qui ne se déroule dans un cadre spatial. Or l’espace est une réalité qui dure : nos impressions se chassent l’une l’autre, rien ne demeure, dans nos esprits, et l’on ne comprendrait pas que nous ne puissions ressaisir le passé s’il ne se conservait pas en effet par le milieu naturel qui nous entoure […] C’est sur l’espace, notre espace, celui que nous occupons, ou nous repassons souvent, auquel nous avons toujours accès, et qu’en tout cas notre imagination ou notre pensée est à chaque moment capable de reconstruire, qu’il faut tourner notre attention, c’est là que notre pensée doit se fixer pour que reparaisse telle ou telle catégorie de souvenirs61.
Ainsi l’observation de la territorialité de l’Indiaocéanie à travers les représentations « d’une mémoire collective » propose de questionner les problématiques des transitions sociétales sous l’angle de la mise en récit de leurs patrimoines culturels. Celle-ci peut fonctionner comme référentiel pour penser l’aménagement de l’urbanisme. Elle arrive comme une réponse à la problématique des transitions socio-écologiques abordée dans le projet POPSU L’Étang Salé, sur l’Île de La Réunion : Les atouts d’une petite ville ultramarine tropicale face aux défis de la durabilité Alon bati nout viv ensemb. L’étude vient interroger la notion de ville durable par la recherche-action. Elle donne à la fois la parole aux élus, aux techniciens de l’urbanisme et aux citoyens autour de l’élaboration de diagnostic de territoire. L’exposition devient un outil de concertation où s’exprime la valeur du patrimoine culturel bâti et naturel comme socle de réflexion autour de la transition vers la ville durable. Construire en gardant le cachet et l’identité de l’Étang-Salé est une revendication des habitants.
Conclusion
Ainsi, l’approche par la médiation culturelle des territoires que nous proposons vient questionner les transitions sociétales sous un autre prisme que celui de l’écologie. Elle relance le débat sur la posture de certains courants comme celui de l’épistémologie du Sud autour du rapport entre les sociétés du Nord et du Sud sous couvert de conflits culturels pouvant être repris par certains mouvements revendicatifs. Par les études que nous menons, nous venons ici aborder un point d’achoppement, que la diplomatie scientifique peut proposer au sein de l’Indiaocéanie. C’est le cas par exemple des conflits autour du patrimoine culturel. Comme l’explique Maria Gravari-Barbas et Vincent Veschambre62, la notion de patrimoine est bien souvent décrite à travers le consensus du partage des biens communs, comme l’héritage d’une collectivité, comme instrument de lien social. Pourtant le concept de patrimoine culturel n’a cessé depuis sa reconnaissance au XIXe siècle d’être pris en tension entre des luttes idéologiques autour de revendications identitaires et territoriales. Pour Beghain Patrice (1998)63 le patrimoine culturel a été révélateur de luttes idéologiques avant d’être défini aujourd’hui dans un cadre plus consensuel « du vivre ensemble », « faire ensemble », « lien social », « démocratisation culturelle ». Cependant pour l’auteur la notion de patrimoine culturel est utilisée comme un « vecteur identitaire » et mobilisée pour parler de « cultures régionales ». Le patrimoine est considéré comme un enjeu de développement économique et de légitimation politique. Sa destruction dans certains conflits armés vient toucher les fondements profonds de la mémoire collective64. Dans cette perspective les acceptations patrimoniales s’opposent les unes aux autres voire même se juxtaposent mais elles soulèvent aussi le lien entre le patrimoine et la notion du territoire. On pourrait même dire que le discours patrimonial reflète les enjeux de transition de territoire et voire les conflits qui les sous-tendent. On peut alors saisir, dans ce sens, ce qui peut se jouer au sein de la diplomatie scientifique dans l’Indiaocéanie, lorsque les conflits autour du patrimoine culturel peuvent venir entraver la transition sociétale dans un contexte Indo-pacifique.