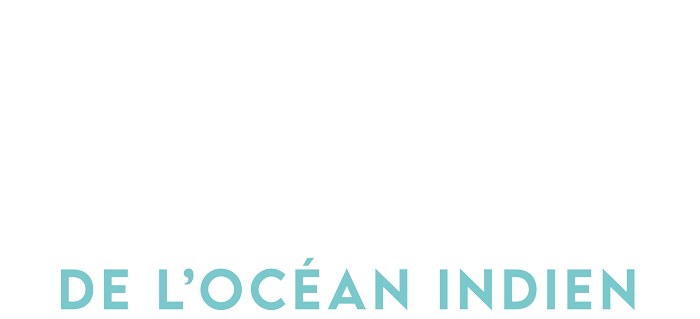Introduction
Les réflexions qui suivent concernent la posture épistémologique en linguistique, avec une application aux langues créoles de l’océan Indien (réunionnais, mauricien, seychellois).
La linguistique est depuis longtemps partagée entre différentes tendances, notamment une tendance mentaliste et une tendance empiriste, la première étant rattachée au rationalisme et mettant en exergue la dimension cognitive du langage, alors que la seconde accorde une plus grande importance à l’observation des données et à la constitution d’un corpus constituant l’unique base à partir de laquelle la description de l’objet d’étude – en l’occurrence une langue ou une variété de langue – est envisagée.
Dans cette optique, il convient de préciser certains points. Tout d’abord, la créolistique est une partie de la linguistique. Second point, les créoles sont des langues comme les autres ; dans ce qui suit, je les prends comme un exemple de terrain où l’on retrouve les oppositions épistémologiques signalées.
La présente étude se situe dans la mouvance cognitiviste et je vais essayer d’expliquer en quoi c’est une nécessité. Pour cela, il importe de comprendre ce qu’on entend par langage, langue, discours et parole. Nous verrons que si l’on accepte l’idée que le but ultime d’une théorie est d’atteindre une valeur explicative, et non pas simplement descriptive, alors il faut aussi accepter que la linguistique, dans laquelle est incluse la créolistique, soit une science argumentative, ce qui la rattache au rationalisme.
L’article comprend deux grandes parties. La première est l’exposé des réflexions épistémologiques générales et la seconde est une application de ces réflexions à une étude de cas centrée sur la genèse des pronoms personnels dans les créoles du sud-ouest de l’océan Indien, ainsi que sur une propriété syntaxique propre au créole réunionnais.
Réflexions épistémologiques
Contre l’empirisme
Afin d’éviter tout malentendu, il importe de préciser que la linguistique, comme pratiquement toute science, comporte nécessairement une base empirique dans la mesure où il faut bien observer des données. Toutefois, ce qui compte est le degré d’importance accordée d’une part à cette observation, d’autre part – et surtout – à la construction d’hypothèses sur la base d’argumentations. En effet, toute activité scientifique implique une interaction incessante entre observation et construction d’hypothèses.
À cet égard, ce qu’on entend habituellement par empirisme est en fait l’excès d’empirisme incitant à négliger la nécessaire part de réflexion, de rationalité et d’argumentation ouvrant la voie à des hypothèses.
André Martinet, l’un des phares de la linguistique du XXe siècle, compte sans aucun doute parmi les représentants les plus éminents de l’empirisme. Il s’est opposé au recours à l’hypothèse, craignant qu’elle soit « nécessairement […] d’ordre psychologique »1. Martinet concède toutefois que la déduction2 est nécessaire : « si nous voulons couvrir l’ensemble des faits linguistiques, nous ne pouvons pas procéder par induction. Il nous faut, à un moment donné, procéder par déduction, à partir de certaines bases »3. Martinet prône finalement une méthode « empirico-déductive »4.
Sans doute pensait-il que l’application d’une méthode rigoureuse obéissant à des principes stricts ne pouvait que conduire au bon résultat5. Croire que l’on parvient à la bonne analyse de manière automatique par l’application d’une méthode fondée uniquement sur l’observation de prétendues « données » mène en principe tout droit au dogmatisme.
Certes, les empiristes comme Martinet donnent l’impression d’argumenter. En réalité, ils appliquent des procédures telles que la commutation et la recherche de paires minimales en phonologie6, à quoi s’ajoutent des principes, comme l’analyse syntaxique fondée sur la notion d’énoncé minimum7, le rejet du mot comme unité opératoire8, etc. Ainsi, Martinet écrit que « l’opération commutative […] nous permet d’aborder les faits linguistiques sans le recours à l’hypothèse […] »9.
Pour le rationalisme
Pour un rationaliste, lorsqu’on observe une série de données concordantes, ce qui est important n’est pas tant le constat d’une récurrence que la raison de celle-ci, autrement dit l’explication10 que l’on propose. À cet égard, les doctrines épistémologiques de Gaston Bachelard et de Karl Popper sont très proches de ce que je préconise en linguistique.
Pour Bachelard11, « l’expérience première ne peut en aucun cas être un appui sûr »12 et la recherche nécessite « la mise en forme rationnelle de l’expérience »13. Il ajoute que « la science réalise ses objets, sans jamais les trouver tout faits »14 : « tout est construction, déduction, […], tout est démonstration »15. Cela s’applique idéalement dans le cas de la langue qui, étant de nature mentale, est forcément une construction nécessitant une argumentation déductive.
Selon l’hypothético-déductivisme de Popper16, la science, dont l’objectif est de trouver une explication aux faits, démarre avec une problématique et non avec des observations, qui sont d’ailleurs orientées par des présupposés théoriques. La logique inductive est rejetée car il est impossible de vérifier une proposition universelle en faisant référence à une série d’observations.
Popper préconise une méthode « falsificationniste » : un seul contre-exemple suffit à réfuter une hypothèse, alors que les exemples allant dans le sens de cette hypothèse permettent au mieux de la corroborer. La réfutabilité est le critère de démarcation permettant de reconnaître que l’on a affaire à une réflexion scientifique. Les observations sont indispensables, mais elles ont pour fonction de tester les hypothèses, et non de les vérifier.
Mentalisme, cognitivisme, générativisme
J’ai indiqué en introduction que je me situais dans une mouvance cognitiviste. Le modèle que je défends ne se rattache de manière globale à aucun cadre théorique présenté tel quel par d’autres. Il vaut donc mieux parler d’affinités avec, par exemple, les travaux de Jackendoff17 ou les réflexions de Pinker18.
Concernant la linguistique générative, il est clair qu’il faut reconnaître les apports considérables de la « révolution » chomskyenne. Noam Chomsky a défendu depuis longtemps l’idée d’une faculté de langage innée19 et la nécessité d’un cadre théorique explicite et formalisé, ce qui a représenté un progrès considérable.
Pour les chomskyens, l’innéisme implique une grammaire universelle, même s’il est difficile de donner à celle-ci un contenu précis. Cette idée de grammaire universelle a toujours été au cœur du générativisme « orthodoxe », mais la question de sa nature exacte reste ouverte et en discuter ici nous mènerait trop loin. Sa conception de la grammaire universelle a été simplifiée par Chomsky au fil des années20, jusqu’à la réduire à l’hypothèse d’une opération syntaxique unique et récursive dite de fusion (angl. merge) d’unités linguistiques donnant des unités de rang supérieur21.
D’une manière générale, une adhésion sans recul critique n’est pas souhaitable. Le générativisme, dans ses variantes successives, pèche à mon sens par un degré d’abstraction trop élevé. Ainsi, par exemple, dans son analyse de la phrase simple Bandidu ka ta sta ta briga (‘les voyous ne se battent pas’) en créole cap-verdien, Marlyse Baptista propose un diagramme comportant pas moins de quinze niveaux22, ce qui sème le doute sur la plausibilité psycholinguistique du modèle.
Langage, langue, discours, parole
Aux antipodes de ce qui précède, il existe une tendance en sciences sociales à considérer la langue comme un phénomène culturel que l’enfant devrait « apprendre ». À cela, je préfère l’idée que nous avons des prédispositions biologiques favorisant le développement de la compétence linguistique. Le jeune enfant n’est pas exposé à des règles qu’on lui fournirait : il est confronté à des données à partir desquelles il infère des principes qui lui permettent ensuite de construire ses propres énoncés. En observant inconsciemment la parole des autres lors de ses premiers échanges sociaux, l’enfant bâtit sa langue23.
Si l’on considère les conditions dans lesquelles la créolisation s’est produite lors de la colonisation des îles de l’océan Indien dans le cadre du système esclavagiste, on peut supposer que l’appropriation du français des colons par les populations déportées a ressemblé à un tel processus.
Le langage articulé est la propriété distinctive de l’espèce humaine. Il existe bien entendu une dépendance à l’égard de l’environnement, mais elle est subordonnée à une relation intime entre le comportement linguistique et la spécificité biologique de l’espèce. Pour s’approprier une langue, il faut un cerveau humain et un potentiel biologique adapté24.
L’appropriation de la langue première ou des langues premières ne saurait être un apprentissage, puisqu’aucun enseignement systématique du langage n’a lieu à ce stade ; cela vaut aussi lors de la créolisation. Il s’agit non pas d’apprentissage, même autonome, mais de fabrication de la langue.
La nature des données et le processus d’appropriation
Les sons de la parole fluctuent. Il n’existe pas d’invariant permettant de reconnaître immédiatement la réalisation de tel ou tel phonème. Les réalisations des phonèmes ne sont jamais deux fois les mêmes et l’interprétation d’un son comme appartenant à tel ou tel phonème dépend du contexte. En plus, les sons ne sont pas simplement alignés les uns après les autres et chacun affecte celui qui est contigu. Ils se chevauchent dans la parole, ce qui se résume par le terme de coarticulation. Chaque phonème est une construction réalisée à partir de l’analyse inconsciente des données acoustiques.
Tout cela baigne évidemment dans l’abstraction. Celle-ci est dans la nature profonde de la communication linguistique, car les données auxquelles est confronté le futur locuteur – dans le cas qui nous occupe, le futur créolophone – doivent passer par le filtre de son interprétation. Ces données ne sont en effet rien d’autre que des ondes acoustiques, associées à une situation d’énonciation et à une réalité extralinguistique. Si les données sont des ondes, cela signifie que le sens n’est pas dans les données en question.
L’absence d’invariants et la coarticulation nécessitent un processus d’interprétation des sons et de construction des phonèmes, sans parler bien entendu de l’interprétation sémantique, via l’analyse syntaxique, la syntaxe étant probablement au cœur de tout le processus.
En outre, les données acoustiques relèvent de la parole, et non de la langue, qui est inobservable25, puisqu’elle est de nature purement mentale. C’est pourquoi cette maxime de Bachelard s’applique particulièrement bien à la science du langage : « Rien n’est donné. Tout est construit »26.
La faculté de langage
La conception que je propose des unités, du phonème27 à la phrase, est celle de « briques » mentales. Le futur locuteur, confronté aux données telles que je viens de les décrire dans les grandes lignes, construit ce qui va devenir sa propre langue.
La faculté de langage innée est vue ici comme une prédisposition à une telle construction, à dériver des unités abstraites à partir d’ondes acoustiques lors du processus d’interprétation, et à produire les ondes acoustiques adéquates lors du processus inverse. Au cœur de tout cela se niche la relation entre le son et le sens, qui sont deux réalités fondamentalement hétérogènes.
Ces remarques valent bien entendu pour l’appropriation de la langue et le processus de créolisation qui a eu lieu à partir du XVIIe siècle dans les territoires colonisés, tels que l’île de La Réunion (ou Bourbon), l’île Maurice (ou île de France) ou l’archipel des Seychelles, dans le sud-ouest de l’océan Indien. En effet, ce qui vaut pour le jeune enfant vaut aussi pour l’esclave déporté se livrant à l’appropriation du français des maîtres, car il s’agit dans les deux cas d’une acquisition non guidée. Avec la créolisation, on se trouve en quelque sorte dans une situation intermédiaire entre l’appropriation naturelle de la langue première par le jeune enfant et l’apprentissage souvent artificiel dans une situation scolaire, mais nettement plus proche de l’appropriation de la langue première.
En résumé, en ce qui concerne les créoles, l’appropriation de la langue des maîtres, processus qui va donner lieu à la créolisation, est d’autant plus une construction28 de la part de celui qui tente de l’acquérir, que la langue en question ne lui est tout simplement pas accessible : en effet, ce qui lui est présenté, ce sont des données discursives, sous forme d’ondes acoustiques, comme déjà indiqué, et aucunement la langue, qui est une réalité purement mentale, par nature inobservable.
C’est à partir de l’observation de la partie que l’on joue que l’on construit les règles du jeu et que l’on fabrique ses propres pièces, que j’ai appelées « briques » mentales. Cette fabrication est un travail mental inconscient effectué à partir de l’observation de données constituant le discours d’autrui.
Naturalisme et fonctions fondamentales du langage
La conception défendue ici se situe dans une optique foncièrement naturaliste : en ce sens, la langue est un fait de nature et la linguistique est une partie de la biologie. Bien entendu, les contenus des discours demeurent des faits de culture, mais si l’on accepte l’idée que l’humain est un être de langage par nature, alors la faculté de langage et les échanges linguistiques sont des faits de nature ; en d’autres termes, la culture ne s’oppose pas à la nature humaine, elle en fait partie.
Dans cet esprit, on peut poser deux fonctions fondamentales du langage : une fonction de représentation, qui est purement interne, c’est-à-dire mentale, et une fonction de communication29, qui correspond à l’interlocution et qui est à la fois interne et externe. La faculté générale et universelle de langage, propre à l’espèce, permet à tout humain de s’approprier une ou plusieurs langues premières de manière « naturelle », la langue étant alors synonyme de compétence du sujet parlant, autrement dit la capacité mentale de produire du discours.
Quant à la parole, elle peut être définie comme l’acte de discours oral. Rappelons à ce propos que les langues sont fondamentalement de nature vocale, et que l’écriture est un phénomène second, à la fois du point de vue phylogénétique (histoire de l’espèce) et du point de vue ontogénétique (développement de l’individu).
Critique de la théorie de la sociogenèse
Ce qui vient d’être dit est radicalement opposé à la théorie sociopragmatique de la sociogenèse développée par Michael Tomasello30, pour qui la maîtrise du langage s’explique par la transmission sociale ou culturelle. Les langues seraient des conventions ou des rituels sociaux, des institutions sociales et des artefacts symboliques.
Selon Tomasello, les enfants acquièrent les constructions linguistiques par un processus de sociogenèse, ce qui occulte complètement la dimension cognitive de la compétence linguistique31. Ce type d’approche privilégie le rôle de l’imitation qui suffirait à expliquer le processus d’acquisition. Tomasello admet toutefois que l’enfant n’entend que des énoncés « concrets » et qu’il lui incombe de créer des structures grammaticales complexes. Il reconnaît les capacités d’abstraction de celui qui construit sa future langue32, mais n’explique guère ce processus de construction.
Contrairement à ce que suggère Tomasello, une langue n’est pas simplement un produit culturel que l’on « apprend », au sens classique de ce terme. En outre, Tomasello commet une erreur en imaginant que les enfants réfléchissent à leur utilisation des constructions linguistiques abstraites. En effet, l’appropriation naturelle de la langue première se fait d’une manière essentiellement inconsciente, sans apprentissage formel ni réflexion.
Qu’est-ce qu’un créole ?
Il est nécessaire à ce stade d’aborder brièvement la question des théories de la créolisation. Je propose ci-après un simple aperçu de trois « paradigmes » nettement distincts.
La théorie de la « relexification » défendue par Claire Lefebvre à propos de l’haïtien33 ne semble pas tenable. Selon cette théorie substratiste, les créoles emprunteraient leur lexique à la langue du colonisateur, dite « lexificatrice », mais leur grammaire serait « africaine ». Cette thèse ne repose sur aucune base historique et sociale, et n’a en tout cas assurément aucune validité sur le terrain indianoéanique, les traces de substrat y étant très faibles34.
Dans le cadre de ce qu’il appelle un « bioprogramme », Derek Bickerton35 postule des traits typologiques supposément distinctifs des langues créoles. Selon cet auteur, un créole advient lorsque des enfants activent leur bioprogramme inné pour complexifier et transformer un pidgin – parler prétendument rudimentaire auquel ils sont confrontés – en véritable langue, dite créole, ce qui implique que tout créole serait issu d’un pidgin devenu langue première.
La théorie du bioprogramme est invalidée par les faits sur le terrain indianocéanique et ailleurs36. En outre, si le bioprogramme avait une réalité quelconque, on se demande pourquoi les traits typologiques qu’il est censé induire ne se retrouveraient que dans les créoles.
Il serait vain à mon avis de chercher des traits typologiques structurels propres aux langues créoles, dans la mesure où ce sont des langues comme les autres. Il est clair qu’il existe des tendances à l’œuvre dans la genèse des créoles, notamment la préférence pour le type analytique, c’est-à-dire l’expression des notions grammaticales à l’aide des mots séparés, plutôt qu’au moyen de la flexion37. Mais il faut se garder de prendre de simples tendances pour des propriétés universelles.
Il me semble que la définition des langues créoles ne peut pas être structurale et qu’elle est nécessairement d’ordre historique38. À cet égard, celle de Robert Chaudenson39 est satisfaisante :
Les créoles sont des langues, nées de la colonisation européenne des XVIIe et XVIIIe siècles, dans des sociétés pour la plupart insulaires, où l’arrivée massive d’esclaves […] a modifié le mode de transmission de la langue européenne. La créolisation résulte de l’appropriation par les nouveaux esclaves de variétés périphériques de l’idiome du colonisateur […]. Les créoles ne se caractérisent […] pas par des traits structurels spécifiques qu’ils seraient les seuls à présenter et qu’ils présenteraient tous. […] Les modes sociohistoriques et sociolinguistiques de la créolisation sont […] très particuliers et constituent la réelle spécificité des créoles […].
Chaudenson distingue deux phases dans le processus de créolisation40. La première est celle de la société d’habitation. La cible, par contact direct avec les maîtres, est un français très éloigné du français standard ou équivalent. Les variétés de langue française à l’origine des créoles étaient en effet des formes de français régional. La seconde phase est celle de la société de plantation, durant laquelle on voit augmenter le nombre d’esclaves. Ceux-ci, sans contact direct avec les Blancs, ont cette fois pour cible non le français de ces derniers, mais le produit de l’acquisition réalisée lors de la première phase, qui sert à son tour de modèle aux nouveaux venus.
On peut penser qu’il y a eu créole lorsque l’écart entre la langue cible initiale des colons et le nouveau parler pratiqué sur le terrain colonisé est devenu assez important pour qu’il soit légitime de déclarer que ce parler est sorti de « la galaxie francophone »41.
Dimension cognitive et argumentation
La définition de Chaudenson ne fait pas référence à la dimension cognitive de la créolisation, mais celle-ci est parfaitement compatible avec son approche sociohistorique. Cette dimension suppose que la notion d’hypothèse soit au cœur de la méthode. En effet, ce qui est observable, que ce soit par le linguiste ou par le sujet essayant de s’approprier la langue – de la construire –, ce n’est jamais la langue elle-même : c’est du discours oral.
Encore faut-il préciser que c’est loin d’être l’intégralité du discours : en effet, seule la composante phonétique est observable – le sens ne l’est pas –, les règles de syntaxe et de sémantique devant être inférées une fois le décodage phonétique effectué, sachant que même ce décodage est complexe et abstrait, puisque la parole est un flux sonore continu qu’il appartient à l’auditeur-interprète d’analyser, de segmenter, etc. On conçoit ainsi que le circuit de la parole est extrêmement complexe.
En résumé, de même que le futur locuteur, lors du processus d’appropriation de la langue, en l’occurrence le futur créole qu’il va créer par là-même, analyse, interprète, formule des hypothèses largement inconscientes, de même le linguiste émet aussi des hypothèses, conscientes cette fois, et pour ce faire doit argumenter. Cela est dû au fait que la langue, qui est de nature mentale, ne peut être localisée que dans le cerveau, et qu’elle est par conséquent inaccessible. On ne peut inférer quoi que ce soit sur une langue qu’en observant le discours, c’est-à-dire l’acte de communication.
Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi les partisans de l’inductivisme et les adversaires du recours à l’hypothèse se fourvoient. Leur erreur vient du fait qu’ils confondent langue et discours, autrement dit, les règles du jeu (la langue) avec la partie que l’on joue (le discours), et qu’en général les éléments qu’ils prennent pour des « données » n’ont en réalité rien à voir avec les vraies données auxquelles sont confrontés les futurs locuteurs, qu’il s’agisse de l’appropriation d’une langue première ou d’une langue seconde dans le cas du processus menant à la créolisation : en effet, l’empiriste partisan de la méthode inductive part d’éléments qui sont passés par le filtre d’une analyse primaire et déjà interprétés, ce qui a bien peu à voir avec le flux sonore continu que doit percevoir et analyser le sujet confronté à de véritables données au sens entendu ici. On l’aura compris, c’est une conception naïve des « données » qui justifie l’inductivisme ou l’empirisme de certains.
Application aux créoles de l’océan Indien
Les pronoms personnels : du français aux créoles
Je vais à présent passer à une application destinée à démontrer le bien-fondé des vues exposées ci-dessus. Nous commencerons par examiner comment se sont construits les systèmes des pronoms personnels42 des créoles de l’océan Indien, à partir du système français43.
Ce que la tradition grammaticale appelle pronoms personnels recouvre en fait deux réalités linguistiques nettement différentes en français : des pronoms conjoints comme je, tu, il, le, la, etc., et des pronoms disjoints comme moi, toi, lui, etc.44
Les seconds peuvent constituer un énoncé à eux seuls, par exemple moi, toi, lui, elle, eux, comme réponse à la question qui a fait cela ? Au contraire, les premiers sont dits clitiques45, c’est-à-dire en l’occurrence attachés au verbe, ce que masque la graphie : je parle, tu parles, il parle, etc. (l’attachement au verbe se voit à l’écrit dans parle-t-il ?, par exemple). Les pronoms disjoints peuvent suivre une préposition : après moi, après toi…, ce que ne peuvent faire les pronoms conjoints.
Les clitiques ( = conjoints) comme je, tu, etc., n’étant pratiquement jamais accentués (au sens phonétique), pâtissent d’une faible saillance dans le décodage de la parole, contrairement aux pronoms disjoints. En outre, alors que ces derniers ont chacun une forme unique (moi, toi…), les clitiques ont des formes distinctes selon leur fonction syntaxique (cf. il/le/lui, etc.)46, ce qui complique le système.
En raison de leur plus forte saillance – et donc de leur perceptibilité supérieure –, ainsi que de leur moindre complexité morphologique, c’est tout naturellement des formes disjointes du français que sont issus les pronoms personnels des créoles. Voici ce que cela donne en réunionnais : moi > mwin ; toi > twé (peu usité) ; vous ( = une seule personne) > (v)ou ; lui > li (masculin ou féminin) ; elle > èl ; nous > nou ; vous autres > vous aut’ > zot ; eux autres > eux aut’ > zot (la forme eux aut’ est encore attestée au Québec).
En mauricien, on obtient les formes mo/mwa, to/twa (ou bien ou, plus formel), li (masculin ou féminin), nou, zot, zot. Le seychellois est très proche, avec mon/mwan, ou, i/li (masculin ou féminin), nou, zot, zot. À certaines personnes, on remarque que le mauricien et le seychellois distinguent une forme faible et une forme forte, par exemple mo(n) (faible) ~ mwa (forte), en fonction de la position dans la phrase : cf. mauricien mo konn twa (‘je te connais’), to konn mwa (‘tu me connais’).
La leçon à tirer de cette évolution est que des principes étaient à l’œuvre lors de la genèse des créoles, par exemple, le fait de favoriser les unités saillantes, qui étaient nettement plus audibles, et les unités les plus simples ne connaissant pas de variation. L’application de ces principes condamnait à l’avance les clitiques pour ne retenir que les pronoms disjoints moi, toi, lui, elle, etc. Il importe de noter que ces principes ne sont pas « fournis » par les données, et qu’on ne peut les formuler qu’à l’issue d’une argumentation menant à une explication.
Une innovation en réunionnais : le marqueur prédicatif
Si les clitiques français ont tous disparu dans les créoles, on relève une exception apparente qui est le préverbe i, issu du français i(l). Le i a survécu en réunionnais47 non comme pronom, mais comme marqueur prédicatif, que l’on peut définir comme un élément de soudure entre le sujet et le prédicat48, à condition que ce prédicat comporte un verbe à forme tensée49. Par exemple, dans zot i manz kari volay (‘ils mangent du cari de volaille’), le préverbe i signale que commence le prédicat (i manz kari volay) et que ce prédicat s’applique au sujet (zot)50.
Les règles d’emploi du i en créole réunionnais sont en fait très complexes. Par exemple, il n’apparaît pas avant la forme va d’expression du futur, ni avant les formes des verbes awar (‘avoir’) et èt (‘être’) commençant par un l- ou un n- : zot na in zoli loto (‘ils ont une belle voiture’), kosa zot la manzé ? (‘qu’ont-ils mangé ?’), zot lé malad (‘ils sont malades’)51.
Je postule que le n- ou le l- des formes en question est un préfixe52 jouant le même rôle de marqueur prédicatif que le i, ce qui exclut ce dernier. Quant à l’absence de i avant va, cela peut s’expliquer par le fait que cet auxiliaire, n’existant que sous la forme de présent, est tensé par nature et cumule le rôle d’auxiliaire et de marqueur prédicatif.
Un principe prosodique en syntaxe
Les contre-exemples apparents s’expliquent par la nécessité d’avoir deux syllabes (i lé) incluant le préverbe (i) quand la forme monosyllabique lé n’est pas suivie d’un syntagme sous sa dépendance directe53, ce qui fait que l’on a ousa zot i lé ? (‘où sont-ils ?’), avec i, mais ousa zot lété ? (‘où étaient-ils ?’), sans i, étant donné que lété est déjà dissyllabique, et aussi zot lé zot kaz (‘ils sont chez eux’), sans i non plus, mais cette fois parce que lé est suivi d’un syntagme sous sa dépendance directe (zot kaz).
Dans des énoncés comme ousa zot i lé ?, le i joue un rôle prosodique, et non de marqueur prédicatif. On aura aussi par exemple ousa mi lé ? (‘où suis-je ?’), mi étant la contraction de mwin#i ; si ousa suit le verbe – en étant sous sa dépendance directe –, le sujet prendra la forme mwin, comme il est de règle : mwin lé ousa, la ? (‘je suis où, là ?’).
Comparons : ousa zot i lé kan mi apèl azot ? (‘où sont-ils quand je les appelle ?’), kansa zot lé kontan ? (‘quand sont-ils contents ?’) ; dans le premier exemple, la subordonnée de temps n’est pas sous la dépendance directe de lé, ce qui implique l’emploi de i, alors que dans le second, l’adjectif kontan dépend directement de lé, ce qui exclut le préverbe54.
Pour ce qui nous concerne ici, l’essentiel est que ces hypothèses explicatives ne sont pas fournies par la simple observation des données, mais résultent d’une réflexion argumentée sur la base de principes qu’il convient d’établir, et que les locuteurs postulent inconsciemment.
Analyses concurrentes
L’analyse purement syntaxique du i réunionnais que je propose ci-dessus est partagée par peu de créolistes, et sans que ce soit autant développé55. La version la plus proche est celle de Susanne Michaelis56, qui est une simple esquisse par rapport à ce que je propose. Chris Corne avait bien qualifié le i de marqueur de verbe fini (angl. finite)57, pour ensuite le déclarer – à tort – marqueur de présent58. Pierre Cellier fait de i un « indice verbal » sans valeur sémantique, mais la notion de marqueur prédicatif lui semble étrangère59.
Je suis évidemment en désaccord avec les créolistes qui avancent des critères sémantiques, étant donné que l’emploi de i est indifférent au temps et l’aspect, entre autres. Ainsi Robert Chaudenson voit dans le i un « morphème de présent »60, alors qu’on le trouve à tous les temps : zot i manzra pa ! (‘ils ne mangeront pas !’), zot i manzé (‘ils ne mangeaient pas’)61, zot i manzré kari volay (‘ils mangeraient du cari de volaille’), etc.
Selon Gillette Staudacher-Valliamée, le i « indique l’entrée en procès »62, expression floue à connotation sémantique qu’elle ne définit pas et qui ne nous avance guère.
Enfin, Ginette Ramassamy pose « l’existence de i en structure profonde de tout énoncé à prédicat processif » et une règle ad hoc d’effacement « lorsque sa présence n’est pas nécessaire »63, ce qui n’a évidemment aucune valeur explicative.
Explication du changement
On peut se demander pourquoi le pronom français i(l) a connu en réunionnais ce destin décrit plus haut et a échappé à la disparition totale.
Le clitique i(l), qui représente la 3e personne du singulier, masculin, en fonction sujet, est le moins marqué de la série entière, ce qui revient à dire qu’il est le moins complexe cognitivement64. En effet, la 3e personne est non marquée du point de vue énonciatif, puisque son référent n’est impliqué ni comme locuteur, ni comme allocutaire ; le singulier est non marqué par rapport au pluriel ; enfin, le masculin est non marqué par rapport au féminin. Une observation élémentaire révèle en effet que dans les langues, on forme plutôt le féminin à partir du masculin, et le pluriel à partir du singulier, et non l’inverse65.
Il résulte de ces remarques générales que l’on comprend pourquoi le i (< fr. il), totalement non marqué, est le seul pronom personnel clitique à s’être maintenu en créole réunionnais.
Il se pose néanmoins une autre question : pourquoi le i a-t-il changé de statut lors du processus de créolisation ? On peut avancer l’hypothèse suivante : dans des énoncés français comme i dit pas ça (en prononciation courante), le clitique i est non pas le sujet, mais le représentant préverbal du sujet, la structure abstraite pouvant être représentée comme suit : [[Ø][i dit pas ça]]. Dans cette représentation, le symbole Ø ( = « zéro ») dénote la place vide réservée au sujet, le clitique i étant en réalité accolé au verbe au sein du prédicat. Dans ce cadre, le i est une reprise préverbale du sujet « zéro » à l’intérieur du prédicat.
Une autre formulation est possible en français oral courant, par exemple mon frère i dit pas ça, le syntagme mon frère détaché à gauche étant non pas le sujet, mais le thème de la phrase, analysable comme suit : [[mon frère][[ Ø][i dit pas ça]]].
Je propose l’hypothèse suivante : lors de la créolisation, le thème détaché a été réinterprété comme étant le sujet, tandis que le i, de pronom clitique et reprise préverbale du sujet « zéro » qu’il était, a été réinterprété comme un marqueur prédicatif, tel que celui-ci a été défini supra. La structure créole est alors la suivante : [[mon frèr][i di pa sa]]. Étant donné les principes exposés, il était impensable que le i préserve le statut qu’il avait en français.
Lors de cette réinterprétation des données françaises du début de la créolisation, le i a été généralisé à toutes les personnes : cf. zot i di pa sa (‘ils ne disent pas ça’), mais aussi, par exemple, mi di pa sa (‘je ne dis pas ça’)66. Dans certains cas, le i s’efface pour des raisons phonologiques, par exemple après le pronom li (li#i ⇒ li)67.
La méthode argumentative en créolistique : « je pense, donc je suis »
La célèbre formule « je pense, donc je suis » se trouve dans le Discours de la méthode de Descartes (1637). Ce n’est bien entendu pas la dimension métaphysique de cet énoncé qui nous intéresse ici, mais la possibilité de le traduire en créole réunionnais et d’examiner la structure syntaxique de la traduction, afin d’illustrer la nécessité de la méthode argumentative en linguistique.
On peut proposer par exemple mi mazine, alor mi lé, le i étant employé non seulement dans mi mazine, mais aussi dans mi lé, sachant que mi est la contraction de mwin#i.
Cet énoncé est intéressant à divers égards. Tout d’abord, à ma connaissance, aucun créolophone n’a souvent l’occasion de proférer ce genre de phrase – et aucun francophone non plus d’ailleurs, en dehors des études philosophiques68.
Ensuite, je note que même les locuteurs interrogés qui emploient, conformément à l’usage « standard », la forme mwin du pronom personnel de 1re personne du singulier avant les formes lé (présent) et lété (imparfait) du verbe èt (‘être’), ont recours cette fois – sans aucune exception – à la forme mi avant lé. Il faut savoir en effet que dans la variété de créole pertinente pour notre réflexion, on a mi manz (‘je mange’), mi dor (‘je dors’), mi bwar (‘je bois’), etc., mais mwin lé malad (‘je suis malade’), mwin lé kontan (‘je suis content’), etc. Or aucun locuteur interrogé ne dit mi mazine, alor *mwin lé pour « je pense, donc je suis ».
Cela signifie qu’il y a unanimité du jugement de grammaticalité, alors même qu’aucun membre de la communauté linguistique n’a jamais prononcé ni entendu la phrase mi mazine, alor mi lé. La seule explication possible est que les locuteurs appliquent intuitivement des règles mentales qu’ils ont inférées à partir de l’observation inconsciente des emplois de i dans leur petite enfance pour produire une phrase totalement inédite.
Or ces règles ont été énoncées plus haut : c’est pour la même raison que l’on entend ousa zot i lé ? (‘où sont-ils ?’), ousa mi lé ? (‘où suis-je ?’), mais aussi mi mazine, alor mi lé (‘je pense, donc je suis’). Dans cette traduction de la formule cartésienne, la forme verbale lé n’est en effet suivie d’aucun syntagme sous sa dépendance directe, puisqu’elle est en emploi absolu, ce qui requiert le i prosodique69.
C’est finalement pour les mêmes raisons que l’on a mi (et non mwin) avant lé dans ousa mi lé ? et dans mi mazine, alor mi lé, même si ce dernier énoncé n’a jamais été entendu ni émis auparavant. Les chances de trouver un tel énoncé dans un corpus sont pratiquement nulles, ce qui met sérieusement en défaut l’inductivisme.
Conclusion
Deux leçons principales sont à retenir. La première est que les locuteurs construisent mentalement et inconsciemment des règles très complexes dans leur enfance à partir de l’observation des données qui leur sont présentées et qui consistent en un flux continu d’ondes acoustiques qu’il leur faut segmenter et analyser, phonologiquement, syntaxiquement, et sémantiquement. Il est clair qu’une langue ne saurait être acquise par simple imitation.
La seconde est que, pour les linguistes, le simple examen des données dans le cadre d’une méthode empirico-inductive ne peut en aucun cas nous mettre sur la voie : pour parvenir à nos fins, il est indispensable de procéder à une argumentation, afin d’être en mesure de proposer une hypothèse ayant une valeur explicative.
Certes, on peut se passer d’argumentation et d’hypothèses, en se contentant de donner des règles d’emploi sans valeur explicative. Ce qu’on entend habituellement par empirisme ou inductivisme consiste en fait à négliger la nécessaire part de réflexion, de rationalité et d’argumentation ouvrant la voie à des hypothèses.
Quand on applique la méthode empirico-inductive, la recherche se limite à la description en s’arrêtant à la porte de l’explication et l’on perd la principale vertu de la science, qui est de rendre compte d’un fonctionnement profond.
Il ressort de tout cela que le rationalisme critique s’impose, ainsi qu’une démarche hypothético-déductive. À ma connaissance, les hypothèses que j’ai proposées ci-dessus pour la valeur syntaxique du i en créole réunionnais n’ont pour le moment été invalidées par aucune observation. Tant qu’elles n’auront pas été « falsifiées », on pourra les considérer comme « corroborées ».