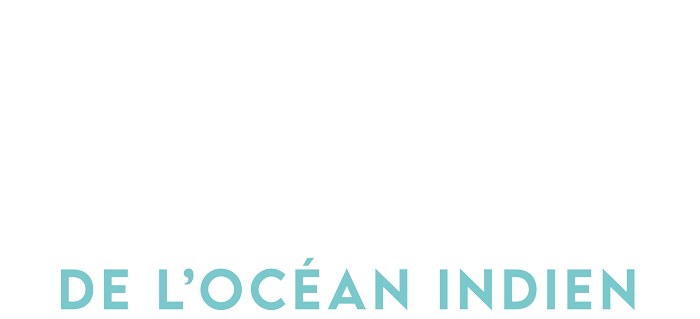Introduction
Qu’est-ce qu’être créole ? Dans une enquête, la sociologue Laurence Tibère a demandé à des individus de « citer trois critères qui font dire de quelqu’un qu’il est créole »1. Elle observe que :
Les réponses confirment tout d’abord le statut positif de la langue, citée en premier par 44 % des 500 enquêtés. S’agissant de l’alimentation et des composantes du système alimentaire créole, elle arrive en seconde position dans les réponses (15 %) et le cumul des premières, secondes et troisièmes citations spontanées, fait apparaître qu’elle est mobilisée comme critère de créolité par la moitié des individus interrogés.2
L’importance que prend l’alimentation dans cette enquête peut s’expliquer par le fait que :
L’alimentation est également un support de l’identité des groupes sociaux. Tous les éléments relevant des savoirs, des usages, des croyances et des représentations liés à l’alimentation, parce qu’ils sont constitutifs de la culture, peuvent être un support d’une identité collective.3
Dans cet article, c’est la mise en récit, la représentation, des « savoirs, des usages, des croyances » liés à l’alimentation qui seront étudiés à travers quatre textes littéraires : Quatre-épices, un roman écrit par Philippe Forget qui se déroule à Maurice ; deux textes réunionnais qui sont le récit de voyage Vavangue de Jean Albany et le roman Marséline Doub-Kër de Daniel Honoré, narré en créole réunionnais ; et enfin Le Thinnai, un roman pondichérien écrit par Ari Gautier.
Parmi les points en commun qu’ont ces textes, trois retiendront notre attention ici. En premier lieu, les quatre textes décrivent des pratiques et des consommations alimentaires. Ces dernières mettent en lumière des rapports de domination, où les langues parlées (français ou créole) déterminent le placement hiérarchique des personnages. C’est là notre second point commun : les quatre textes proposent différentes langues, dont le français et les créoles mauricien, réunionnais et pondichérien (ce dernier dont l’existence, nous le verrons, est discutée). La présence de ces langues créoles s’explique par notre troisième point qui est le passé colonial des territoires où se déroulent les narrations, en particulier les colonisations françaises qui ont enclenché des processus de créolisation.
Carpanin Marimoutou et Françoise Vergès définissent les « créolisations india-océaniques » comme n’étant :
jamais terminées, toujours retravaillées. Négociations, nécessité de la perte, du renoncement président à sa dynamique. Sans perte, pas de créolisation. Sans inégalité, pas de créolisation car celle-ci demande, requiert un espace de négociation où tensions, conflits se résolvent mais ne se dissolvent pas.4
Bien que les textes étudiés proposent des processus de créolisation et des représentations de pratiques alimentaires, il est important de rappeler qu’ils n’ont pas vocation à être fidèles aux réalités auxquelles ils se réfèrent. « La mise en scène de la cuisine produit à son tour une cuisine du texte, et l’auteur, porte-parole d’un univers, devient à son tour cuisinier, et de l’histoire, et du récit »5. Ce que dit Carpanin Marimoutou dans cette citation est essentiel pour comprendre la démarche entreprise dans cet article, qui est sociocritique : les textes qui seront étudiés sont en effet une « cuisine » de l’histoire et des sociétés.
Dans un court article de synthèse, Denis Saint-Jacques décrit les différentes approches sociologiques utilisées par la critique littéraire6 et défend l’idée que la littérature est par essence un « échange social »7. Cet échange est celui qui s’opère nécessairement entre le texte et le lecteur, puisque « le texte littéraire ne peut exister sans lecture, qu’il est lecture »8. Sans nous attarder sur les différentes méthodes qu’évoque le chercheur, nous ne présenterons que celle que nous utiliserons et que nous avons déjà nommée : la sociocritique. Popularisée par Claude Duchet au début des années soixante-dix, cette approche consiste à envisager les textes comme des discours produits et déterminés par les sociétés desquelles ils sont issus9. « Si le réel demeure hors de portée, il est toujours déjà dit sous la forme d’une masse d’informations brutes, de toponymes et de dates incontournables qui signalent une société de référence »10. Sans considérer le texte littéraire comme un « document historique ou sociologique immédiatement lisible comme un exemple ou comme une preuve »11, la sociocritique s’intéresse à la « socialité du texte », c’est-à-dire « l’inscription indirecte du social et de l’histoire dans le texte »12. Une des spécificités de la sociocritique est l’intérêt porté aux microlectures, qui montrent « comment la portée critique d’un texte se joue dans les détails de son écriture »13.
Pour comprendre les manières dont l’alimentation et les langues apparaissent dans les textes choisis comme des supports « de l’identité des groupes sociaux »14, nous emprunterons à la sociologie la notion de socialisation :
La socialisation désigne les mécanismes de transmission de la culture ainsi que la manière dont les individus reçoivent cette transmission et intériorisent les valeurs, les normes et les rôles qui régissent le fonctionnement de la vie sociale.15
Les pratiques alimentaires et linguistiques seront étudiées comme des marqueurs de socialisation et envisagées comme des « critères de créolité »16 ou de « francité »17. Parmi les différentes personnes pouvant jouer un rôle dans ces socialisations, celles qui font figure d’autorité (parents, employeurs) seront au cœur de l’étude. Il s’agira dès lors d’observer la manière dont ces figures d’autorité déterminent, influencent ou se distinguent des pratiques alimentaires et linguistiques des autres personnages. Notre hypothèse est que ces distinctions sont inhérentes à des rapports de dominations hérités des passés coloniaux, qui se transmettent de parents à enfants.
En nous appuyant sur des microlectures de nos textes, nous verrons en quoi les cuisines y apparaissent comme des outils de transmission à double emploi, qui permettent aux Créoles de se socialiser en tant que tels, tout en révélant et réveillant des rapports de dominations inhérents aux périodes coloniales et post-coloniales.
Nous expliquerons tout d’abord comment les cuisines participent à la socialisation des personnages en tant que Créoles et à la reproduction sociale qu’elle engendre ou non. Ensuite, nous analyserons les processus de créolisation qui apparaissent dans nos textes et nous nous intéresserons aux différentes socialisations créoles que ceux-ci impliquent. Enfin, nous mettrons en lumière le rôle de la cuisine créole dans les mécanismes de distinction sociale et la manière dont elle révèle des rapports post-coloniaux entre les personnages.
La (non) socialisation créole par la cuisine
MDK débute de manière abrupte par une phrase nominale, qui a pour fonction de situer l’action : « Shantelou, laba an Franse, pa tro loin lo gran kapital, Pari18 »19. Tout l’enjeu de ce premier chapitre réside dans cette première phrase du roman : la tension entre le lieu de l’action (Chanteloup) et La Réunion, où le narrateur se situe lorsqu’il désigne Shantelou comme un ailleurs (« laba »). C’est autour du thème de l’alimentation, qui occupe une place non négligeable dans le chapitre (dans notre édition, sur sept pages trois y sont consacrées), que va se construire une opposition entre la France métropolitaine et La Réunion. Ce chapitre consiste principalement en une conversation entre Marko et sa sœur, Mariana. Pendant cette conversation, Marko déguste un plat énigmatique préparé par sa sœur. L’énigme tient en l’origine mystérieuse de l’aliment principal du plat servi : des « bred Lastron »20, un aliment a priori introuvable en France métropolitaine, où se déroule ce chapitre. Ce dernier se clôt avec la révélation de la supercherie : à défaut de « bred lastron », la sœur de Marko a cuisiné des pissenlits :
[Marko] – Di amoin ! Té lastron mëm sa ? Lastron La Rénion ? Lastron Kanbour ?
[Mariana, sa sœur] – Non ! Ou na rézon. Té pa lastron, té pisanli. Moin la prépar ali konm lastron sanm toute lo zépiss ki fo.
– A, la sër ! Donk parlfèt, mon boush èk mon kër la pa traï amoin. In Rénioné i rokoné produi son péï !
E pourtant lo kuizinièr lavé bien roussi lo kari. Mé lé vré daoir : produi kréol sé produi kréol, bèkali !21 22
En contournant le manque des matières premières nécessaires à la préparation de son plat, Mariana permet à son frère d’affirmer son appartenance à La Réunion. En effet, selon Marko, la ressemblance entre le « pisanli » et les « bred lastron » ne suffit pas à leurrer son goût. Pour lui comme pour le narrateur : « produi kréol sé produi kréol, bèkali ! »23. Éloigné géographiquement de son île natale, Marko mesure son ancrage dans une culture créole par ses capacités à reconnaître au goût et à l’odeur des produits de La Réunion, ici indissociables des « produi kréol ».
Désireux de retourner à La Réunion, il s’enorgueillit que ses sens ne le trahissent pas, car le texte présente ceux-ci comme un passeport symbolique nécessaire au retour sur l’île. C’est en effet ce qui apparaît lorsqu’il invite sa sœur à faire goûter l’ersatz de « bred lastron » aux enfants de cette dernière, ce qu’elle refuse car ceux-ci contiennent du piment :
Epï marmay [les enfants de Mariana] va voir koman produi La Rénion sa lé gouté ! […] Solman lo dë ti garson lé pa abitïé ansanm piman, va brïl zot palé. Odrémië lo momon i fé frite dë sosiss pou zot.
[Marko] – Bin, marmay i konétar pa zot péï dan sé kondision : i fo amonte azote ëm piman. Konmsa lërk zot va rotourné…
[Mariana] – Kèl rotourné ? Ou koné tro bien nou la poin okin léspoir artourné in zour ! Ansanm salèr Marin-là, kèl voiyaz nou kab péyé ?24 25
Si Marko exprime ici son souhait de rentrer sur son île natale, Mariana est quant à elle catégorique : il n’y a pas de retour possible. Elle pointe la situation financière de son mari (Marin) pour appuyer son propos. Pourtant, dans le quatrième chapitre, un billet de cinq cents francs, que Marin tend à Marko26, montre une certaine aisance financière de la famille. C’est donc volontairement que Mariana s’oppose à ces voyages gustatif et physique, en n’offrant pas à ses enfants de « passeport culinaire ».
En leur refusant les pratiques langagières et alimentaires créoles, elle leur refuse de fait une socialisation créole. Car si Marko et Mariana peuvent être qualifiés de Créoles, en remplissant les deux « critères de créolité »27 cités en introduction, ce n’est pas le cas des deux enfants. En effet, ceux-ci ne consomment pas de nourriture créole, et n’en parlent pas la langue : « – Maman ! Rémy, il veut pas que je… – Non, maman ! C’est René ! »28
La non transmission de ces pratiques par Mariana montre que celle-ci a entamé un processus de métissage de ses propres pratiques alimentaires. Ces transformations sont aussi perceptibles par ses pratiques langagières, puisqu’elle n’a pas transmis à ses enfants sa langue maternelle. Le personnage féminin s’approprie les matières premières de France, et accepte de ce fait un goût et une langue qui ne seraient plus uniquement créoles, mais adaptés à son nouveau lieu de vie. Ce faisant, elle se refuse à elle aussi toute possibilité de retour à La Réunion et choisit un goût géographiquement situé en France hexagonale.
Mariana ressemble en cela au personnage du père du narrateur dans LT, qui inculque à ses enfants une telle préférence pour un goût « français » que des plats présentés comme tels29 sont aussi les repas préférés des deux enfants : « le civet de lapin qui était mon plat favori » ; le « poulet rôti qui était le plat préféré de mon frère »30. À l’instar de Mariana, l’homme apprend à ses enfants le français, tout en leur refusant l’accès à une langue présentée par le texte comme du créole pondichérien31 (« Mais mon père s’était véhémentement opposé à ce que Lourdes nous parlât en créole »32). Néanmoins une différence notable existe entre le père du narrateur dans LT et Mariana : dans LT, les personnages vivent à Pondichéry, soit en dehors du territoire hexagonal. Contrairement à Mariana, la volonté du père du narrateur de LT d’inculquer à ses enfants les langues et goûts alimentaires français ne peut donc pas être associée à une quelconque tentative d’intégrer ces derniers au territoire dans lequel ils vivent. Par ailleurs, le français est présenté par le texte comme une langue peu parlée (« Les seules personnes avec qui je conversais en français dans ce quartier étaient mon père, mon frère et le Père Tremond […] et Lourdes jusqu’à un certain degré »33), à la différence du tamoul qui est parlé par le reste de la famille du narrateur, ainsi que par ses voisins : « Déjà que nous jonglions entre le français que nous parlions avec mon père et le tamoul que nous utilisions avec mon oncle, ma tante et les voisins ; à cela était venu s’ajouter le créole de Lourdes »34. En utilisant le verbe « jonglions », le narrateur exprime la difficulté que représentent pour son frère et lui la pratique et la compréhension de plusieurs langues. Ce faisant, il indique au lecteur que ce plurilinguisme leur est imposé par leur père, et ce alors que cette langue n’est pas pratiquée par leur entourage.
Pour comprendre ce choix, il faut noter que le père du narrateur entretient avec la France un lien complexe. Administrativement Français depuis deux générations, il est le premier de sa famille à avoir foulé le sol métropolitain35. Il a été soldat pour les « Troupes coloniales » et vit d’une retraite militaire36. Le personnage déclare cependant n’avoir « jamais eu la verve patriotique » et refuse à ce titre de placer un drapeau français au-dessus de son domicile37. Il fait une vive critique du patriotisme mais accorde pourtant une grande importance à l’usage et à la transmission de la langue et de la cuisine françaises, tout en dépréciant le (Bas) créole38 de Lourdes. L’homme a un comportement ambigu face à son appartenance administrative à la France et place ses enfants dans le même flou culturel, qui apparaît nettement dans le passage qui suit :
Oui je suis Français. Mais je suis Indien en même temps. C’est ici que je suis né, mes ancêtres sont d’ici. [...] Ma famille est française depuis deux générations et je fus le premier à partir en métropole. Jusqu’ici nous n’avions que le statut de Français sur les documents ; mais nous étions profondément Indiens. Enfin, nous le sommes toujours. Comment pouvez-vous vous sentir Français, sans avoir jamais mis les pieds dans ce pays. Mes parents viennent d’un milieu modeste et n’ont pas eu accès ni à la langue ni à la culture française. [...] Notre allégeance à la France se trouvait enfermée dans une vieille malle en ferraille dans l’espoir qu’un jour, un des descendants l’ouvrirait et utiliserait ce morceau de papier.39
Dans cet extrait, nous pouvons observer que, d’après le père du narrateur, sa famille n’est réellement devenue française qu’à partir du moment où il a foulé le sol métropolitain. S’il utilise en effet le présent de l’indicatif pour affirmer son identité française (« je suis Français »), cette dernière dépend de la période où il a vécu en France. Tout comme Mariana, son séjour en métropole a influé sur sa pratique de la langue et de la « culture française ». Si le personnage se considère toujours comme un Indien, il exprime involontairement sa préférence pour une culture française, avant de se corriger (« nous étions profondément Indiens. Enfin, nous le sommes toujours »40).
Cet extrait montre l’importance de la transmission culturelle aux yeux du père du narrateur : alors qu’il parle à un inconnu francophone, il ressent la nécessité de présenter sa famille comme « française depuis deux générations »41, et avoue le souhait de cette dernière que leurs descendants restent Français, et trouvent une utilité à « ce morceau de papier »42 qui prouve leur appartenance à la France. Comme Mariana dans MDK, la transmission de la langue et d’une cuisine française (ou du moins non créole, dans le cas de Mariana) participe à intégrer leurs enfants respectifs dans un espace « français » symbolique. Néanmoins, dans les deux cas, les personnages gardent un lien avec leur culture d’origine. D’une part ils en parlent la langue avec les membres de leur fratrie respective (créole réunionnais pour Mariana et tamoul pour le père dans LT43), et d’autre part, Mariana continue de cuisiner des plats créoles44, et le père du narrateur de LT continue de manger des plats pondichériens45.
Dans Q-É, le personnage de Cédar consomme lui aussi des plats issus du territoire sur lequel il vit, c’est-à-dire Maurice. Tandis que l’homme déambule dans son quartier, le roman propose aux lecteurs une immersion sensorielle dans la vie des Mauriciens :
Cédar […] partit flâner dans son quartier. […]
Il aimait ces dernières heures du jour, quand le silence déploie l’air pour le luxe des odeurs. Les repas du soir étaient sur le feu. Jérémie, le voisin, [...] regardait en direction d’une femme charnue qui s’exerçait devant la roche à curry, cette épaisse table de basalte dompté sur laquelle le rouleau, également de pierre, broie les épices et les assaisonnements […] [Cédar retrouvait] les scènes familiales gravées dans la mémoire des générations qui se succédaient dans le quartier. Des voix enfantines scandaient la ritournelle qu’il avait répétée quarante ans plus tôt avec ses camarades de jeux […].
Sur les réchauds, posés sur les perrons pour un meilleur tirage, les marmites en fonte noircie fument du riz qui bout. Les feux de charbon rougeoient ou, rétifs, s’éventent et enfument les femmes qui renâclent ; leurs yeux brûlent et elles pestent contre le marchand de charbon ambulant qui leur en a promis merveille. […]
Cédar déambulait. C’était vendredi et la marée était de mise aux menus des dîners créoles. Les poissonniers colporteurs n’avaient pas arrêté, de tout le jour, de rassurer la piété en proposant une chair dispensée. “Homards ! Crap !” avaient-ils annoncé […]. “Guette çà coma frais : fèke sorti dans dilo !”
Les molécules odorantes de la cuisine créole envahissaient l’air comme autant de messages.46
À l’exception du goût, tous les sens sont mobilisés, de la vue à l’odorat, en passant par l’ouïe, mais aussi le toucher, par la fumée qui brûle les yeux des cuisinières. Les pratiques alimentaires créoles du quartier sont tangibles, elles inondent les sens de celles et ceux qui le traversent ou y vivent. Le goût n’est pas représenté dans cet extrait, et pourtant tous les sens sont tournés vers les aliments et la cuisine, des marchands de poissons aux plats qui mijotent. À l’inverse des exemples de MDK, la cuisine créole de Q-É est ancrée dans l’espace qui est le sien. En détaillant les ustensiles utilisés (« roche à curry », « marmite en fonte noircie ») et la nature du feu qui cuit les aliments (« charbon »), le narrateur signale ce qui participe à faire la spécificité de la cuisine créole. Ces détails montrent aussi l’attachement des Créoles du roman aux produits locaux comme le charbon, dont le meilleur serait issu des « racines de filaos »47, ou encore les produits marins vendus sur place puis consommés lors des repas (« la marée était de mise aux menus des dîners créoles »).
La description de ces scènes de vie « gravées dans la mémoire des générations » place Cédar dans une double posture. D’une part, il est l’observateur, dont la déambulation permet la progression de la description. D’autre part, il est un acteur passé et présent de ces scènes familiales. La « ritournelle qu’il avait répétée quarante ans plus tôt » et les saluts qu’il distribue montrent en effet son appartenance à la communauté créole, et aux actions qui se déroulent dans « son quartier »48. En « retrouvant les scènes familiales »49, sa mémoire personnelle et la mémoire du quartier se superposent. Le verbe « retrouver », ici utilisé au participe présent, suggère en effet la familiarité du personnage avec le quartier, tout en permettant au narrateur d’évoquer une mémoire collective, où l’alimentation a une place de choix. Selon les autrices de Sociologie de l’alimentation :
Les nourritures du passé sont […] un fondement de l’identité de tel ou tel groupe social […] dans le souci d’affirmation d’une continuité historique, d’une histoire et d’une appartenance communes.50
Dans le quartier créole de Q-É, les pratiques alimentaires et « nourritures du passé » donnent l’impression d’une transmission automatique d’une socialisation créole, de génération en génération. Dans MDK, l’éloignement géographique entre Mariana et La Réunion lui permet de refuser à ses enfants une socialisation créole. De la même manière, le père du narrateur dans LT transmet à ses enfants la langue française, qui est par conséquent la langue de narration du roman. À l’inverse, le quartier de Q-É et ses produits locaux ancrent les pratiques créoles dans un espace où une socialisation créole mauricienne se perpétue.
Créolité et processus de créolisation
Dans LT, la nourriture ne se cantonne pas au lieu où elle est produite. L’odeur qui en émane rend en effet possible un détour dans l’espace et le temps, en mettant en exergue une « continuité historique » non rectiligne :
L’odeur de son Molly avait le pouvoir de traverser mers et océans pour aller s’ajouter aux saveurs des sept autres Moles d’Oaxaca. Savait-elle que cette sauce importée par les Portugais était d’origine aztèque ? Les Portugais empruntèrent aux Espagnols le mot Molly, une sauce que les habitants de cette région du sud Mexique cuisinaient. Les colons modifièrent la sauce en remplaçant la viande par du poisson, de l’huile d’olive et des herbes européennes. En arrivant sur la côte de Malabar, les Portugais transmirent cette recette aux Malayâlis qui à leur tour la transformèrent en ajoutant du lait de coco, poivre, safran des Indes, gingembre et feuilles de curry. Lourdes [la domestique et cuisinière de la famille du narrateur] qui avait un sens inné pour la bonne cuisine avait fait sa propre variante. Aux ingrédients existants, elle ajoutait de la cardamone, de la cannelle et du fenouil.51
Cet extrait propose et explicite un processus de créolisation. D’une part, par les transformations qu’a subies la recette, du fait de ses déplacements. Et d’autre part par le rôle qu’ont joué les colons dans ces déplacements. La seule mention des colons suggère l’existence de « problèmes de dominations et subalternité » [traduction personnelle]52, desquels peut se mettre en place une créolisation. Dans le texte, celle-ci n’est « jamais terminée, toujours retravaillée »53, puisque modifiée par Lourdes. En parallèle, dans les extraits cités de MDK et Q-É, le processus semble arrêté, abouti. En témoigne, dans MDK, l’amalgame entre produits de La Réunion (« produi son péï ») et « produi kréol »54. Dans Q-É la nourriture créole est elle aussi figée et se perpétue de manière, semble-t-il, inchangée dans le quartier créole. Le passé colonial y est occulté et donne l’impression d’une communauté créole qui a toujours été indépendante de l’Histoire du pays. Dans ces deux romans, l’invisibilisation des processus de créolisation montre que, dans les textes, ceux-ci sont terminés, ne laissant place qu’à des pratiques, des produits et des cuisines déjà créoles.
Dans MDK et Q-É, l’existence d’une culture créole semble aller de soi : c’est ce que suggère l’absence de description formelle de ce que sont des cultures ou individus créoles. Les narrateurs des deux romans considèrent donc que leurs narrataires55 sont en capacité d’identifier par eux-mêmes ce qui est entendu lorsqu’il est question de et du (C)créoles. Tel n’est pas le cas pour le narrateur de LT, qui fait l’exposé et la description de deux catégories de Créoles pondichériens :
Pondichéry a deux communautés créoles distinctes : les Hauts Créoles et les Bas Créoles dont Lourdes faisait partie. Descendants des colons et parlant parfaitement français, les premiers méprisaient les seconds pour leur filiation portugaise, anglaise, danoise, écossaise et hollandaise […]. Vivant comme des parias parmi les parias, [les Bas Créoles] subissaient un double racisme. Ignorés par les Indiens et méprisés par les blancs et les Hauts Créoles, ceux-ci vivaient dans une indifférence totale. Même si physiquement ils étaient visibles, culturellement ils étaient invisibles.56
Pour pallier l’invisibilité culturelle signalée par le narrateur, l’identité des Bas Créoles n’est pas simplement montrée, mais aussi démontrée. Lorsque le narrateur retrace l’historique de la sauce « Molly » que prépare Lourdes, il rend visible cette culture et cherche à démontrer aux lecteurs que ce mets a fait l’objet d’un processus de créolisation. En évoquant un plat sujet à ces processus, et préparé par une cuisinière créole, le narrateur explicite le caractère créole de la recette. Remarquons que, contrairement à l’utilisation de pissenlit à la place de « bred lastron » dans MDK, l’ajout d’épices que se permet Lourdes n’est pas décrié mais salué (« Lourdes qui avait un sens inné pour la bonne cuisine »57). À la différence des deux autres romans, la créolité dans LT est donc toujours en cours de construction et continue de vivre par le personnage de Lourdes et sa cuisine.
Or, en témoigne la démonstration des processus de créolisation de la sauce Molly, la reconnaissance de l’identité créole de Lourdes pose problème. Si sa cuisine créole est bien reçue par les personnages, ce n’est pas le cas de sa langue :
Les seules personnes avec qui je conversais en français dans ce quartier étaient mon père, mon frère et le Père Tremond [...] et Lourdes jusqu’à un certain degré. Avec Lourdes c’était différent. Mon père lui avait formellement interdit de nous parler en français, enfin en créole. C’est le langage qu’elle parlait. Il préférait qu’elle communiquât plutôt en tamoul que de nous parler en créole. Il avait peur que son langage pervertît notre français. Car le créole pondichérien est un français corrompu avec des mots tamouls auquel on ajoute quelques mots portugais ; le tout parlé à la manière tamoule.58
De la même manière que le narrateur tente de démontrer ce qu’est la cuisine créole, celui-ci nous offre une description de la langue créole pondichérienne. Pourtant, dans un article intitulé « Être créole à Pondichéry »59, Logambal Souprayen-Cavery enquête sur la communauté créole de Pondichéry pour en identifier la langue, sans parvenir à mettre « en évidence l’existence d’une langue créole »60. La chercheuse explique l’absence d’une langue créole pondichérienne par « une créolisation linguistique [qui] a été “(in)aboutie”, en raison de l’absence d’éléments nécessaires à la mise en œuvre du processus »61. Le créole, mal perçu par le père du narrateur, pose ainsi un problème au lecteur qui a connaissance du statut de non-langue du créole de Lourdes. Comme il le fait avec la cuisine, le narrateur cherche donc à démontrer et rendre visible ce qui est, selon lui, du créole. Pour ce faire, il en précise les contours par un jeu de contrastes :
Déjà que nous jonglions entre le français que nous parlions avec mon père et le tamoul que nous utilisions avec mon oncle, ma tante et les voisins ; à cela était venu s’ajouter le créole de Lourdes. D’une façon, cela aurait été la langue idéale. Ce mélange de français et de tamoul aurait pu être notre lingua franca de la famille. Mais mon père s’était véhémentement opposé à ce que Lourdes nous parlât en créole. […] Lourdes ne comprenait pas pourquoi papa lui interdisait de parler cette langue ; car pour elle c’était du français.62
Lourdes n’a pas conscience de s’exprimer en créole. Ce n’est qu’en comparaison avec les langues tamoule et française, que parlent le narrateur et son frère, que la pratique linguistique de Lourdes est identifiable comme créole. Cela fait écho à la recherche de Logambal Souprayen-Cavery, qui écrit que sur « le plan des pratiques linguistiques, les enquêtés “Créoles” se sont tous empressés de dire qu’ils n’utilisent pas de langue créole »63. À l’instar du personnage de Lourdes, les enquêtés sont surpris d’apprendre qu’ils utilisent des mots créoles. L’empressement avec lequel ils affirment qu’ils ne parlent pas créole témoigne de l’image dégradante (peut-être même déclassante ?) que les enquêtés ont de cette langue. Cela permet d’expliquer l’ambiguïté de l’identité créole de Lourdes, dans un contexte où il existe deux groupes de Créoles, et où le groupe francophone (Hauts Créoles) minorise le second (Bas Créoles). Tandis que Souprayen-Cavery constate l’inexistence d’une langue créole pondichérienne, LT présente une langue presque involontairement créole, qui n’est identifiable que par ceux qui ne la pratiquent pas. Qu’il s’agisse du roman ou de l’enquête déjà citée, une socialisation créole pondichérienne se reconnaît avant tout par ses plats, dont la chercheuse propose une liste. Plusieurs des plats qui y sont cités se retrouvent dans LT, parmi eux le « vindail » attire particulièrement notre attention.
Le père du narrateur qui, nous l’avons vu, s’oppose au créole de Lourdes, n’a toutefois aucun problème à utiliser le mot « Vindail » : « vient me servir un peu de Vindail ; il a l’air tellement bon »64. Pourtant, l’écriture en italiques du mot « Vindail » confirme bien le caractère créole (ou du moins non français) du terme. Nous pouvons en déduire que l’utilisation de la langue créole ne pose problème au père du narrateur que lorsque cela concerne l’éducation de ses fils, qu’il souhaite française. En effet, s’il se permet de consommer du Vindail, le personnage fait préparer pour ses fils des plats qualifiés de français par le texte65 :
le père de Selvanadin […] était notre cuisinier du jour. Celui-ci venait de rater le civet de lapin qui était mon plat favori. […] Après l’avoir frappé, mon père l’avait attaché au pied du cocotier et le laissa rôtir sous le soleil à côté du poulet rôti qui était le plat préféré de mon frère.66
Choisir le « père de Selvanadin » pour cuisiner les plats préférés de ses enfants est étonnant. Le cuisinier est en effet présenté comme moins talentueux que Lourdes dont l’un des plats « pouvait faire pâlir de jalousie »67 le premier. Tout comme Lourdes serait susceptible de « pervertir » le français des fils de son employeur, la laisser préparer des plats français serait prendre le risque que ceux-ci se créolisent à son contact, à l’instar de la sauce « Molly ».
Cette crainte, en plus du mépris de la langue de Lourdes, nous invite à identifier le père du narrateur comme un « Haut Créole ». Pour commencer, sa maîtrise du français, héritée de ses aïeuls français depuis deux générations68, s’oppose au créole de Lourdes. Il fréquente « Le Cercle de Pondichéry »69, qui, selon l’un des entretiens effectués par Logambal Souprayen-Cavery, était fréquenté par des « Hauts Créoles »70. Dans ce même entretien, il est précisé que les Bas Créoles utilisaient un mot tamoul pour nommer les Hauts Créoles (doraï), qui peut être traduit par « chef, patron »71. L’article ne précise pas si ce surnom traduisait ou non une réalité hiérarchique entre les Hauts et Bas Créoles, mais cela est très nettement suggéré. Or, dans le roman, le père du narrateur est effectivement le « chef, le patron » de Lourdes.
Se distinguer des Créoles : cuisines et situations postcoloniales
Pour Frantz Fanon :
Tout peuple colonisé – c’est-à-dire tout peuple au sein duquel a pris naissance un complexe d’infériorité, du fait de la mise au tombeau de l’originalité culturelle locale – se situe vis-à-vis du langage de la nation civilisatrice, c’est-à-dire de la culture métropolitaine. Le colonisé se sera d’autant plus échappé de sa brousse qu’il aura fait siennes les valeurs culturelles de la métropole. Il sera d’autant plus blanc qu’il aura rejeté sa noirceur, sa brousse.72
En adoptant une posture dominante vis-à-vis de Lourdes et de sa culture, le père du narrateur renverse le complexe d’infériorité auquel il peut être soumis en tant qu’habitant d’une ancienne colonie. Pour Fanon « le Noir, Antillais, sera d’autant plus blanc, c’est-à-dire se rapprochera d’autant plus du véritable homme, qu’il aura fait sienne la langue française »73. Comme cela est le cas dans le contexte antillais, le passé colonial de Pondichéry et de La Réunion a rendu impropre et a fortiori inhumaine l’utilisation de langues non françaises. Cela peut expliquer les choix qu’ont fait le père dans LT et Mariana dans MDK pour leurs enfants respectifs, et que nous avons eu l’occasion de commenter74. Les parents des deux romans ont si bien intériorisé l’infériorisation des cultures créoles qu’ils les reproduisent eux-mêmes.
À l’occasion d’un repas dans MDK qui a lieu en France métropolitaine, se regroupent des natifs de La Réunion et un personnage métropolitain (zorey75). Ce dernier, Raoul, est le « patron » du beau-frère de Marko. Son comportement illustre la manière dont la cuisine et la langue créoles peuvent être rendues subalternes vis-à-vis d’une culture française. Ici, Raoul, qui ne s’exprime qu’en français, mange un toast de « rougay pistash76 », sans savoir que celui-ci contenait du piment. Il cherche ensuite à en apprendre davantage sur la fabrication de ce mets, ce qui mène à une critique des pratiques culinaires et de la langue créoles :
Sé Mariana i ésplik ali i kraz pistash dann pilon. Mé i fo ésplik ali galman ke in pilon sé pa « un pilon » fransé é ke pou krazé i ansèrv in kalou. Raoul i trouv lo fason kozé kréol lé vréman bizar : sé in lang i konfonn toute. Son fron i anrid ankor plïss lërk li apran lo pilon lé tayé dan in gro galé é lo kalou sé karéman in galé i trouv bordaz la mèr.
– Ah ! Mais dites donc, c’est dangereux, ça ! À chaque “rougay” comme vous dites, vous devez manger des éclats de pierre ! C’est si fin que vous ne vous en apercevez même pas, mais ça ne se digère pas : c’est pourquoi vous devez souffrir de l’estomac !
Lo boug i soupir pou anplëgn bann Rénioné. Epi li azoute èk in voi ranpli la tristès.
– Et vous savez, ça revient cher dans le budget de la France, toutes ces maladies d’estomac !77 78
Le père dans LT et Raoul se distinguent des personnages créoles en exerçant une violence symbolique, qui leur est permise par leurs positions dominantes. C’est aussi ce qui se passe dans Vavangue quand le père du narrateur, Ludovic Albany, dit que :
ses petites bonnes, Lia, Thérésia, Nielle, [...] ne veulent jamais dormir seules en leurs « calbanons » [...]. Peut-être, continue-t-il, parce qu’elles mangent trop pimenté, trop salé, trop massalé, ce qui attire le coquin… [...]
Comme tout un chacun de sa génération, mon vieux père exagère, surtout lorsqu’il s’emporte contre les nouvelles manières de vivre. Il faut l’entendre boucaner quand sa toute petite cuillère à dessert ne se trouve pas à sa place exacte, sur la table, au moment du dîner ! Mais on ne passe au dessert qu’après le gros du repas, un carry de poissons rouges, par exemple, et gare s’il y a trop de sel ! [Ludovic Albany] économise en bon gourmet et gourmand sa santé, et s’en explique : « Rien de tel qu’un carry de têtes de rougets ou de cabots de fond, [...] parce que leur gélatine contient tout le phosphore et la saveur des grands fonds »79.
Tandis que, dans MDK, Raoul considère le piment comme mauvais pour la santé des Réunionnais (et a fortiori, pour la santé de la France), Ludovic considère quant à lui le piment et le massalé comme encourageant ce qu’il présente comme étant les mauvaises mœurs de ses employées. Telles qu’évoquées, les « nouvelles manières de vivre » s’opposent en effet à celles de Ludovic. Ce dernier prend une posture conservatrice, dans laquelle santé rime avec bon goût, et impose des manières de table qui, si elles ne sont pas respectées, provoquent des plaintes de sa part (« il faut l’entendre boucaner […] »80). Pour Jean-Pierre Poulain :
Les manières, au premier rang desquelles les manières de table qui mettent en scène les corps et définissent les conditions de l’incorporation alimentaire, vont être l’objet de prescription au service de la distinction sociale.81
En précisant l’existence et l’importance d’une place prévue pour la « cuillère à dessert » de Ludovic, le narrateur insiste sur la distinction qui est faite entre l’homme et ses employées. L’absence de description des manières de table de ces dernières suggère, qu’aux yeux de leur employeur, celles-ci seraient inexistantes, ou du moins banales, sans intérêt suffisant pour être mentionnées. Le personnage se place en exemple, et se distingue d’autant plus des deux femmes qu’il justifie ses goûts culinaires par des raisons en lien avec la santé. À l’inverse de ses employées, il refuse ainsi tout excès de sel (« gare s’il y a trop de sel »82) et exprime sa préférence pour certains poissons à travers leur teneur intéressante en phosphore (« contient tout le phosphore des grands fonds »83). Pour Bourdieu, cet intérêt pour l’alimentation jugée plus saine est un critère qui distingue deux classes :
Le goût en matière alimentaire dépend aussi de l’idée que chaque classe se fait du corps et des effets de la nourriture sur le corps, c’est-à-dire sur sa force, sa santé et sa beauté, et des catégories qu’elle emploie pour évaluer ces effets, certains d’entre eux pouvant être retenus par une classe qui sont ignorés par une autre […].84
En somme, Ludovic et Raoul, qui ont une position similaire vis-à-vis des personnages qu’ils jugent, se distinguent des mangeurs de piment pour mieux affirmer leur position de domination vis‑à‑vis de ces derniers. Une hiérarchie symbolique s’installe et vient s’ajouter aux hiérarchisations déjà existantes entre les personnages. Dans MDK, la situation de domination dans laquelle se place Raoul est renforcée par le mépris qu’il exprime pour le créole, qu’il qualifie de paroles que l’on « baragouine »85, « vraiment bizarre », « qui confond tout »86. Dans le dialogue ci-après, Raoul commence la conversation puis les interlocuteurs se confondent, ce qui illustre de fait leur adhésion à des valeurs racistes et xénophobes :
– Regardez les Polonais, les Yougoslaves… […] [qui] débarquent chez nous. Et les Noirs ? Et les Antillais ? […] C’est pareil pour les Bougnoules. […]
– Et j’ai vu les femmes arabes faire la manche et, le soir, compter leurs liasses de billets. Ça vient voler l’argent des Français et ça envoie des sommes considérables dans leurs pays. […]
– Y en a qui ne savent pas parler le français !
– Qui ne savent pas lire !87
On observe que dans MDK la non maîtrise de la langue française, sous ses formes orale et écrite, apparaît comme le summum de l’inacceptable, puisqu’elle est citée parmi les derniers arguments dans cette surenchère. Les Réunionnais qui interagissent avec Raoul, en adhérant à sa langue et ses valeurs, se refusent une expression en créole. Ce faisant, ils se distinguent des catégories d’individus cités, présentés comme des étrangers. Ce comportement leur permet de s’inscrire comme habitants du territoire métropolitain et de se défaire de la potentielle image d’étranger que leur octroie leur île d’origine. En rejetant leur « brousse » pour les « valeurs culturelles de la métropole »88, ils s’inscrivent tout à fait dans la citation de Fanon proposée plus haut. Le piment consommé involontairement par Raoul devient un prétexte pour critiquer les pratiques réunionnaises, tout en rappelant le rattachement administratif encore effectif de l’île vis‑à‑vis de La France, en évoquant l’impact des « maladies d’estomac » dans le « budget de la France »89. Sa posture paternaliste, permise par son double statut de « patron » et de zorey (métropolitain) et par les réactions des convives, sont les conséquences de la continuation d’une domination coloniale. Dans ce cas, la départementalisation de La Réunion n’est « non pas [...] la fin mais [...] la continuation de l’expérience coloniale »90, soit un territoire postcolonial selon la définition de Benjamin Pillet.
Au cours de la scène du repas dans MDK, Raoul est le seul invité non créolophone, mais aussi le seul qui se soit plaint du piment contenu sur les toasts. Dans ce cas précis, la proposition de Frantz Fanon selon laquelle « parler une langue, c’est assumer un monde, une culture »91 s’applique parfaitement. En effet, dans ce chapitre, seuls les personnages créolophones acceptent la nourriture créole. Tout comme c’était le cas pour Marko et Mariana dans notre première partie, parler créole est une condition sine qua non pour pouvoir manger créole. En effet, bien que les créolophones soient en nette supériorité numérique (dix créolophones pour un francophone), en raison de l’arrivée de Raoul c’est le français qui domine : « In mashin [Marko] i romark galman, sé-k dopï Raoul l’arivé, toulmoun la foute a koz fransé92 »93. Et c’est bien de domination dont il est question ici. Raoul fait figure de « véritable homme »94 : à la fois dominant par sa classe (en tant que patron), sa langue française et en tant que zorey, il prend la posture d’un colon face aux colonisés. La seule présence de Raoul incite les créolophones à se hisser à un idéal d’humanité suggéré par sa position dominante, en abandonnant leur langue natale.
Dans LT, Lourdes bascule elle aussi d’une langue à l’autre lorsque le père du narrateur est présent (qui, à l’instar de Raoul, est à la fois « patron » et francophone) : « Tant que mon père était dans les parages, Lourdes s’efforçait de nous parler en tamoul »95. Tandis que dans Q-É, l’absence de situation de domination permet l’utilisation du créole, plutôt que le français.
C’est en effet ce qu’on observe dans Q-É, où il n’y a pas de rapport de domination entre les personnages de Cédar et Raoul. Intérieurement, les pensées de Cédar sont en français (« Mais c’est de chez Raoul, ce curry de homard ; ça sent rudement bon ! »96), mais dès que celui-ci trouve la source de l’odeur qui l’attire, son langage bascule du français au créole (« L’odère-là vantard !97 »). C’est ici la première fois que le personnage s’exprime en créole. L’invitation à déguster un plat créole le motive ainsi à en parler la langue, qui est aussi celle de ses hôtes. L’utilisation de la langue créole est permise par la situation d’égalité qui existe entre les personnages, qui sont tous Créoles.
Conclusion
Les situations postcoloniales dans lesquelles évoluent nos personnages font de l’alimentation un support d’identification pour les personnages créoles. À travers la cuisine, la socialisation créole peut s’effectuer de manière automatique, comme c’est le cas dans Q-É, ou être délibérément entravée voire empêchée comme dans MDK et LT. L’identité créole résulte principalement d’un choix que font ou non les personnages. Ce choix peut être (dé)motivé par des perceptions postcoloniales des cuisines et langues créoles. La langue française joue un rôle déterminant dans ces perceptions, puisqu’elle est utilisée par des figures rendues dominantes par leurs similitudes avec les anciens colons. Tout comme la cuisine joue un rôle déterminant dans l’identification des Créoles, elle permet aussi de faire apparaître les rapports de domination qui existent entre les personnages francophones et créolophones. Manger ou non créole met en évidence une distinction sociale entre les personnages et révèle les rapports de domination postcoloniale qui existent entre eux.
Les extraits commentés dans cet article ne permettent pas de représenter fidèlement la manière dont les personnages incorporent et reproduisent des rapports de domination. Dans LT, le narrateur présente certes la cuisine de Lourdes comme délicieuse, mais sa posture et son attitude restent, à l’image de son père, celles d’un employeur méprisant sa domestique. Dans MDK, le personnage de Marko qui apparaît dans cet article comme un défenseur des langue et culture créoles, change de comportement de retour à La Réunion, en vantant la richesse de la langue française face à une langue créole qui manquerait, selon lui, de vocabulaire98. Dans Q-É, Cédar souhaite devenir propriétaire d’un terrain, à la grande incompréhension de ses proches, pour qui propriété est synonyme de plantation99. Dans Vavangue, et à la différence de son père, le narrateur s’exprime parfois en créole réunionnais100. Les quatre textes incitent les lecteurs à la réflexion, en proposant des créolisations « jamais terminées, toujours retravaillées »101, en déplaçant les corps, les cuisines et les langues avec une question, toujours en suspens : qu’est-ce qu’être Créole ?