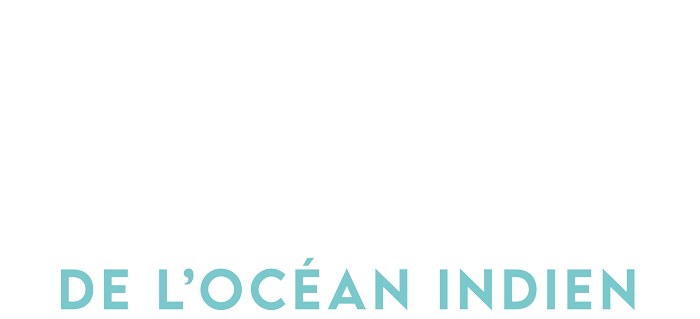Le 28 décembre 2020, l’Indonésie déposait une demande d’extension de son plateau continental dans la région sud-ouest de Sumatra1. Cette demande, qui complète une première prétention portant sur la région nord-ouest de l’île2 est venue s’ajouter à la liste des quatre-vingt-huit autres demandes présentées à ce jour à la Commission des limites du plateau continental (CLPC)3. Ces prétentions émanent de soixante-quatorze États de par le monde ; parmi eux figure la quasi-totalité des États riverains de l’océan Indien4.
Ces derniers ont soumis un total de vingt-quatre prétentions, l’Australie ayant été le premier d’entre eux à s’engager dans cette voie en 20045. Sur la base de recommandations de la CLPC, cinq États ont d’ores et déjà établi la limite extérieure d’un plateau étendu au-delà de 200 milles nautiques : l’Australie, Maurice et les Seychelles, le Pakistan6 ainsi que la France. S’agissant de cette dernière, trois décrets successivement adoptés en 2015 et 2021 sont venus établir la limite extérieure pour les Kerguelen7 ainsi que pour les Îles de La Réunion, Saint-Paul et Amsterdam8. La zone concernée représente ici plus de 150 000 kilomètres carrés9. Les demandes présentées par l’Indonésie et l’Afrique du Sud (partie continentale) ont donné lieu à des recommandations de la CLPC qui restent à concrétiser. Enfin, les demandes restantes sont sous examen ou le seront dans un délai correspondant à un temps long, tant l’agenda chargé de la CLPC freine sa capacité à statuer dans des délais raisonnables. À ce tableau d’une pratique très riche, s’ajoutent deux instances (actuellement pendantes sur le fond) devant le juge international. La première, devant la Cour internationale de Justice (CIJ), concerne le Kenya et la Somalie10 ; la seconde, devant une chambre spéciale du tribunal international de la mer (TIDM), oppose Maurice aux Seychelles11 : l’une et l’autre sont relatives à un différend portant sur la délimitation maritime dans l’océan Indien ; l’une et l’autre couvrent la délimitation du plateau continental étendu.
Cette pratique témoigne du vif intérêt des États de la région pour la procédure d’extension de l’emprise sur l’Océan et, plus concrètement, de leurs droits exclusifs d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles du plateau continental. Le développement continu de la maîtrise technologique des activités pétrolières et gazières offshore12, associé au contexte contemporain de demande accrue, mais de raréfaction des ressources terrestres minérales et fossiles renforce, aujourd’hui plus qu’hier encore, la compétition entre États dans l’accès à ces ressources stratégiques. La découverte d’immenses champs gaziers dans le canal du Mozambique à partir de la fin des années 200013 n’a pu que contribuer à alimenter celle-ci. L’enjeu d’une extension sécurisée14 des droits exclusifs sur le plateau continental est devenu majeur pour l’ensemble des États de la planète, y compris, donc, ceux de l’océan Indien. Vingt-six ans après l’entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), la stratégie déployée ici par ces États mérite donc assurément l’attention.
En tant que réalité factuelle, le plateau continental a pu être défini comme « ce lit et ce sous-sol qui forment géologiquement un sous-bassement ou socle identifiable du territoire étatique »15. Cette définition, donnée dans le contexte où le droit international définit pour la toute première fois un régime juridique dédié, reste très générale. Du point de vue des géosciences toujours, ce socle correspond lui-même à une réalité complexe16, qui a la particularité de s’interrompre par une brusque déclivité, la mer atteignant alors une profondeur abyssale. Cette réalité est elle-même de consistance variable : dans bien des cas, ce socle s’étend sur une distance moyenne de 200 milles marins à partir des lignes de base ; mais il arrive aussi que le territoire de certains États se trouve totalement ou partiellement dépourvu d’un tel socle, là où d’autres sont clairement avantagés par la nature. Dans cette dernière configuration, le socle se prolonge alors au-delà de 200 milles marins. Les États côtiers peuvent-ils alors prendre appui sur cette réalité factuelle pour revendiquer des droits, au-delà de 200 milles marins ? À cette question éminemment stratégique, la CNUDM répond favorablement en 1982. Rappelons que, dans son ensemble, le texte s’inscrit dans un contexte plus général de projection et d’accroissement, toujours plus loin vers le large, de l’emprise des États côtiers sur les océans. L’article 76 donne alors plein effet à la théorie du plateau continental en tant que prolongement naturel du territoire terrestre : tout État apportant la preuve géomorphologique d’un tel prolongement, peut faire valoir l’extension de ses droits.
Ce parti pris, qui justifie une emprise en somme « ordonnée selon la nature »17, emporte toutefois des effets sur les droits des tiers. De fait, l’extension se traduit par un rétrécissement symétrique de la zone des grands fonds marins affectée au patrimoine commun de l’humanité en vertu de la partie XI de la Convention. Elle comporte par ailleurs un risque de chevauchement des prétentions respectives des États voisins. De façon à préserver les intérêts de chacun, la CNUDM définit alors un cadre qui vient borner l’ambition maritime des États.
En substance, ce cadre, qui mêle conditions de fond et de procédure, est ordonné autour de trois points. L’État doit d’abord déposer une demande d’extension à la CLPC, organe dédié à l’examen de l’ensemble des demandes. La demande, qui définit les coordonnées de la zone concernée, doit prendre appui sur un dossier technique établissant la preuve scientifique du bien-fondé de la prétention ; les sciences océanographiques (géologie et géodésie notamment) sont donc ici convoquées pour démontrer l’existence du plateau, au-delà de 200 milles marins. En tout état de cause, la possibilité d’extension des droits est limitée par une double contrainte d’éloignement ou de profondeur : elle ne peut dépasser la limite de 350 milles marins, ou ne peut aller au-delà de 100 milles marins de l’isobathe de 2 500 mètres. La CLPC, ayant examiné les éléments de preuve scientifique, émet alors des recommandations. Sur la base de ces dernières, l’État peut alors fixer la limite extérieure qui devient obligatoire et définitive. On note que la fixation de la limite extérieure revient, in fine, à l’État côtier, là où la délimitation de la zone avec les États riverains doit faire l’objet de négociations, comme l’impose le droit international de la mer18. En cas de différend, le recours aux procédures prévues dans la Partie XV de la CNUDM demeure toujours possible19.
C’est à la lumière de ce contexte juridique que la pratique des États de l’océan Indien peut alors être examinée.
Trois séries de questions retiendront l’attention. À titre liminaire, les conditions d’un accès équitable au droit de présenter une demande à la CLPC doivent être évoquées. Deux autres thématiques se présentent alors, en lien avec la prise en compte des droits des États tiers : ici comme ailleurs, la pratique oscille entre efforts de conciliation et stratégies de confrontation.
L’équité dans l’accès au droit de présenter une demande d’extension
La question est en lien avec une réalité de fait : la grande disparité des États riverains de l’océan Indien. Les capacités d’accès à la procédure devant la CLPC ne sont donc pas égales ; dès lors le recours à des mécanismes et pratiques diplomatiques compensatoires est d’une importance déterminante.
Des capacités très inégales
À l’exception – notable – de l’Australie et de la France, les États de l’océan Indien se rangent dans la catégorie des pays en développement qui regroupe elle-même des acteurs très différents. Aux côtés des puissances régionales que sont notamment l’Afrique du Sud et l’Inde, on compte un nombre élevé d’États très vulnérables dont quatre petits États insulaires en développement20 et huit États émargeant à la catégorie des Pays les moins avancés (PMA)21. L’instabilité et la haute vulnérabilité des institutions politiques, paroxystiques pour un État tel que la Somalie, les situations de conflits ouverts, dans le cas du Yémen aujourd’hui, sont autant de facteurs à prendre en compte également.
Dans ce contexte, on devine que les capacités d’accès à la procédure d’extension du plateau continental ne sont pas égales. La procédure requiert en effet des États qu’ils soumettent à la CLPC un dossier exigeant, lequel suppose une expertise très poussée en géosciences ainsi que des moyens techniques et financiers élevés. Cette exigence est d’autant plus difficile à satisfaire que le délai imposé à l’État pour déposer sa demande est court : il expire au dixième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État22. Nombre d’États riverains de l’océan Indien, à l’instar des autres États côtiers en développement dans le monde, se sont donc trouvés face à des difficultés.
De longue date, l’impératif d’équité a conduit les Nations Unies à développer des mécanismes adaptatifs, obéissant à une logique compensatoire.
La nécessité d’un accompagnement
On rappellera la création en 2001, par l’Assemblée générale, d’un fonds d’affection spéciale permettant aux États en développement d’être accompagnés dans la préparation de leur dossier23 : sans surprise, la totalité des États en développement de l’océan Indien y a eu recours. En outre, l’ensemble des pays en développement, à partir de la dixième Réunion des États parties à la Convention a fait part de ses préoccupations concernant la difficulté de respecter le délai de dix ans24. La onzième Réunion des États parties a été saisie en particulier d’une note verbale adressée par le Gouvernement seychellois au sujet de la prorogation du délai fixé pour la présentation des demandes à la Commission.
Dans le même temps, le groupe des États membres du Forum des îles du Pacifique présentait un exposé de principes prenant appui sur l’impératif d’équité25. Dans le prolongement de ses revendications, reconnaissant le manque « de moyens financiers et techniques, de capacités et de compétences », la CLPC a accepté un assouplissement des exigences : les États, notamment les États en développement, peuvent ne soumettre, à l’échéance, que des « informations préliminaires indicatives » sur les limites extérieures du plateau continental au-delà des 200 milles, assorties d’une description de l’état d’avancement du dossier et d’une prévision de la date à laquelle le dossier complet sera soumis conformément aux prescriptions de l’article 76 de la Convention26. Ils sont par ailleurs encouragés à solliciter l’aide des institutions nationales, régionales et intergouvernementales ainsi que celle de la Commission elle‑même27.
Au printemps 2009, quelques jours seulement avant l’expiration du délai pour certains28, une trentaine d’États ont ainsi déposé des informations préliminaires ; parmi eux figurent sept États de l’océan Indien : les Comores, Maurice, le Mozambique, Oman, les Seychelles, la Somalie, la Tanzanie. Six d’entre eux ont par la suite déposé une demande conformément à l’article 76 de la Convention. Les Comores font donc figure d’exception. Le contenu des informations préliminaires transmises par cet État attire d’ailleurs l’attention en ce qu’il est révélateur des difficultés - ici non encore surmontées - des États très démunis. Le texte comporte seulement deux pages et ne contient pas d’informations scientifiques. Les Comores ont simplement réservé leur droit de déposer une demande, sans être en mesure de constituer un dossier technique, même sommaire. Ils n’ont sollicité aucun accompagnement extérieur, à l’exception d’une « société » d’expertise, dont l’identité n’est pas vraiment révélée29.
La plupart des autres États de l’océan Indien ont en revanche requis l’assistance d’un ancien membre de la CLPC et reçu le concours technique et/ou financier d’institutions internationales (Secrétariat du Commonwealth30, Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), Division des affaires océaniques de l’ONU) mais aussi d’organismes privés ou experts individuels en géosciences comme en droit. Le concours d’États tiers a également été sollicité. On notera que la Norvège est particulièrement présente31, non seulement pour fournir une assistance technique et financière mais également sur le plan diplomatique. La Cour internationale de Justice n’aura pas manqué de relever que le principal artisan du Mémorandum d’accord conclu entre le Kenya et la Somalie à propos de leurs demandes respectives d’extension était un diplomate norvégien32. Le cas somalien fait d’ailleurs figure de cas à part : l’instabilité et la faiblesse des institutions étatiques, de même que la grande vulnérabilité économique et financière rendaient hautement improbable la possibilité pour l’État de saisir la CLPC avant l’échéance du délai de dix ans. L’initiative du Secrétaire général de l’ONU, relayée par l’implication de la Norvège auront donc été déterminantes33. Il va de soi que la demande somalienne s’inscrit dans le contexte plus large de la lutte internationale contre la piraterie au large des côtes somaliennes. Les mesures de sécurisation de la navigation, inaugurée en 2008 par le Conseil de sécurité de l’ONU34 s’avèrent nécessaires et utiles mais insuffisantes à terme. Un rapport de la Banque mondiale adopté en 2013 invite à s’attaquer aux racines économiques et sociales du problème, dont la piraterie n’est qu’un symptôme35. Dans ce contexte, toute initiative visant à promouvoir le développement et le plein exercice, par l’État somalien, de la souveraineté sur ses ressources naturelles fait sens. La demande d’extension du plateau continental est déposée en 2014.
Au final, l’adaptation des règles de procédure, le mécanisme financier compensatoire ainsi que l’accompagnement d’institutions tierces auront joué pleinement leur rôle.
La conciliation des prétentions de l’État côtier avec les droits des États tiers
À l’image de la pratique dans les autres mers et océans de la planète, la pratique dans l’océan Indien illustre la fréquente difficulté à articuler les prétentions respectives des États voisins. La coopération, assortie d’une certaine retenue, permet assurément de dépasser les éventuels points de friction et de concilier au mieux les intérêts de chacun.
Position du problème
Le droit de la Convention distingue on ne peut plus clairement la question de la fixation de la limite extérieure du plateau continental (ou délinéation), de la question de la délimitation avec les États voisins. La première résulte d’un acte unilatéral de l’État côtier, sur la base des recommandations de la CLPC (article 76 § 8). La seconde résulte d’une négociation entre les États intéressés (article 83). Les deux opérations sont ainsi déconnectées dans les textes ; les recommandations de la CLPC sont d’ailleurs toujours établies « sans préjudice de la délimitation ultérieure du plateau continental d’Etats riverains »36. Le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) ne manquera pas de rappeler ces prémisses dans l’affaire de la délimitation du plateau continental dans le golfe du Bengale37. Plus récemment, la Cour internationale de Justice, dans le différend Somalie contre Kenya a elle-même insisté sur la distinction « délimitation-délinéation » ainsi que le caractère séparé des deux processus38.
La pratique montre toutefois que des difficultés peuvent se présenter en cas de chevauchement des prétentions respectives d’États qui se font face ou qui sont en situation d’adjacence. Ajoutant à ces difficultés, les demandes d’extension interviennent aussi parfois dans le contexte d’un différend plus large qu’elles contribuent à mettre en lumière : elles s’inscrivent alors dans des tensions installées souvent de longue date, quand elles ne correspondent pas à une certaine forme d’instrumentalisation de la procédure devant la CLPC pour asseoir et faire prospérer des revendications de souveraineté sur un territoire terrestre : le cas de la demande présentée par Maurice pour les îles Chagos est ici représentatif39.
Coopération et prévention des difficultés
Sans surprise, la coopération et une certaine forme de modération sont des outils précieux pour prévenir les difficultés. La Convention (article 83 § 3 en particulier) ainsi que l’annexe I au règlement intérieur de la CLPC40, incitent fortement les États à coopérer, tant avec la CLPC qu’entre eux. Dans cette dernière hypothèse, la coopération se manifeste par des arrangements provisoires d’ordre pratique susceptibles d’emprunter ici des chemins variés.
Témoins d’un haut degré de coopération, de tels arrangements peuvent d’abord prendre la forme de demandes conjointes, portant sur une zone commune, sans préjudice de la délimitation de la zone entre les États concernés41. Tel est le cas respectivement des Seychelles et de Maurice s’agissant de la région des Mascareignes42, mais également de l’Afrique du Sud et de la France pour l’archipel de Crozet et l’île du Prince Édouard43. Cette dernière n’a pour l’instant pas encore fait l’objet de recommandations de la CLPC44. La première demande a en revanche achevé sa course devant la Commission en 201145. Dans un exercice de coopération abouti et exemplaire, les deux États ont, dans la foulée des recommandations, conclu deux traités bilatéraux, sur le fondement de l’article 83 § 3 de la Convention46. Sur la base des recommandations de la Commission, le premier traité établit la limite extérieure de la zone dite « conjointe » d’un plateau continental étendu et pose le principe d’un exercice conjoint des droits souverains47. Le second traité définit un régime juridique complet de gestion commune, voulu « efficace et équitable » et répondant à l’impératif d’une gestion des ressources « durable et cohérente avec le principe de précaution et avec la protection du milieu marin et de la diversité biologique »48. Conformément à l’article 84 § 2 de la Convention, la limite extérieure de la « zone conjointe » a ensuite été notifiée au Secrétaire général de l’ONU en 201249. Ces arrangements neutralisent ainsi intelligemment la question du chevauchement des prétentions, sans préjuger d’une délimitation future. De bout en bout, Maurice et les Seychelles auront porté une stratégie commune de sécurisation puis d’exercice de leurs droits souverains. Cette solution suppose, cela va sans dire, un lien de confiance et d’harmonie très solide entre les intéressés.
En cas de difficulté, la négociation ne peut être engagée ou n’aboutit pas. Le juge international a précisé à plusieurs reprises la portée de l’obligation de négocier dans le contexte de l’article 83 § 1 de la Convention, rappelant qu’il ne s’agit en aucun cas d’une obligation de conclure mais d’une obligation de se comporter de bonne foi50. Les différends relatifs à la frontière maritime dans l’océan Indien, qui opposent aujourd’hui respectivement le Kenya et la Somalie, les Maldives à Maurice, ont donné l’occasion au juge de confirmer cette interprétation, dans les décisions adoptées relativement aux exceptions préliminaires51. Mutatis mutandis, il est raisonnable de penser que cette interprétation vaut également pour l’article 83 § 3.
D’autres dossiers de demande d’extension, sans révéler un niveau de coopération aussi abouti que dans l’exemple Maurice/Seychelles, s’accompagnent de négociations débouchant sur des formes d’arrangements d’ordre pratique de portée plus modeste.
Selon une pratique devenue banale, ils peuvent ainsi s’engager réciproquement à ne pas s’opposer à l’examen par la Commission de demandes portant sur une (ou des) zone(s) de potentiel chevauchement. De tels accords ont, par exemple, été conclus par la Tanzanie (avec la Somalie, le Kenya, et les Seychelles)52, par le Mozambique (avec l’Afrique du Sud et Madagascar)53 ou bien encore par les Maldives (avec l’Inde et le Sri Lanka)54. L’accord conclu en ce sens entre la Somalie et le Kenya a d’ailleurs été au cœur du raisonnement de la CIJ dans l’arrêt de 201755. Invoquant la réserve à sa déclaration d’acceptation de la juridiction de la Cour (réserve excluant les différends pour lesquels les parties conviendraient d’avoir recours à un autre mode de règlement des différends), le Kenya a tenté de convaincre la Cour de son incompétence. De l’avis du Kenya, l’accord incorporait un mode direct de règlement du différend en matière de délimitation (par la négociation) : la réserve devait donc s’appliquer. Tout en conférant à l’accord la valeur d’un traité international, la Cour n’a pas endossé cette interprétation : elle s’est donc déclarée compétente56.
Sans s’engager explicitement à ne pas s’opposer à la demande présentée, une autre option consiste, pour les États tiers, à réserver leurs droits. Tel est par exemple le cas de l’Inde, suite au dépôt par l’Indonésie de sa demande pour la région de Nord-Sumatra57, puis suite au dépôt par les Maldives de leur demande partielle58. Tel est encore le cas du Myanmar suite au dépôt de la demande de l’Inde59. De tels exemples ne sont pas limitatifs : la pratique est fréquente.
Des questions spécifiques se sont posées par ailleurs s’agissant des prises de position des États riverains de l’Antarctique. L’Australie et la France (région des Kerguelen) se trouvent respectivement dans ce cas de figure. D’éventuelles prétentions se heurteraient au statut d’internationalisation du continent, découlant du Traité de 1959 qui lie les deux États et confère par ailleurs des droits aux autres parties60. D’une part, l’article IV du Traité gèle les prétentions territoriales des États parties ; d’autre part le Protocole de Madrid, complémentaire au traité, interdit toute activité, autre que la recherche scientifique (article 7)61.
Ni l’Australie, ni la France n’étaient donc en position de faire valoir des revendications d’extension de leurs droits souverains. L’une et l’autre ont néanmoins pris soin de réserver leurs droits pour l’avenir, en opérant sur un mode toutefois différent. La demande d’extension de l’Australie portait sur dix zones différentes dont une en Antarctique (côte antarctique et des îles McDonal). S’agissant de cette zone, l’Australie a toutefois indiqué dans la note verbale jointe à sa demande que, tout en transmettant des informations scientifiques établissant l’existence du plateau continental, elle n’attendait pas que la CLPC évalue celles-ci et se prononce pour l’instant62. L’Australie a également pris soin de rappeler le contenu de l’article 77 § 3 de la CNUDM : les droits de l’État côtier sur le plateau continental sont indépendants de l’occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse. La recommandation adoptée par la CLPC a pris acte de cette déclaration et ne s’est effectivement pas prononcée63. La France, pour sa part, a opté pour une seconde voie. Elle n’a pas déposé de dossier scientifique, mais, à l’occasion du dépôt de la demande relative aux Kerguelen, la France a déclaré réserver ses droits pour la zone située au sud du 60e degré de latitude sud : elle se réserve la possibilité de déposer une demande à l’avenir, tout en rappelant, à l’instar de l’Australie, le contenu de l’article 77 § 3 de la CNUDM64.
Les positions australienne et française ont conduit un certain nombre d’États tiers, parties au traité sur l’Antarctique à prendre eux-mêmes position : sans surprise, se prévalant de l’article IV, ils ne reconnaissent aucune revendication territoriale ou de droits souverains65.
Enfin, on observera que, dans certains cas, les difficultés sont résolues en amont par le renoncement de l’État à présenter une demande. On sait que, dans l’hypothèse où existe un différend terrestre ou maritime entre les États riverains, la CLPC est empêchée d’examiner la demande présentée par un État partie à ce différend – sauf accord préalable des États intéressés66. Rien n’empêche toutefois l’État de soumettre une demande : seul, en définitive, le choix diplomatique de la retenue et de la modération le conduira à s’abstenir de le faire. La France, dans le prolongement d’un passé colonial non soldé à l’égard de certaines des îles de la région, a fait preuve de discrétion sur la question de l’extension du plateau continental à l’égard de ces territoires contestés. Les îles Éparses et Mayotte, revendiquées selon le cas, par Madagascar, les Comores ou Maurice67, n’ont pas fait l’objet de demandes d’extension de la part de la France. Il faut dire que la position française, à l’image de la position couramment adoptée par les États, est de ne pas adresser de demandes qui chevaucheraient la zone des 200 milles marins d’États voisins. Compte tenu de cette position sage, seule une demande au Sud d’Europa était, semble-t-il, envisageable. Les explorations préliminaires des fonds marins réalisées dans le cadre du programme EXTRAPLAC ont toutefois montré qu’il n’y avait pas de fondement scientifique à une telle démarche (échec du test dit « d’appartenance »). La nature a en somme imposé une solution anticipant toute éventuelle tension. Réciproquement, aucun des autres États de la région n’a semble-t-il inclus ces territoires dans ses propres prétentions. Les informations préliminaires des Comores ne permettent pas de déterminer la zone de plateau étendu revendiqué.
La position du Royaume-Uni, s’agissant du territoire hautement contesté des Chagos, est différente. Elle révèle bien que celui-ci n’a jamais eu l’intention de déposer une demande unilatérale. Le Tribunal arbitral qui statuera en 2015 rapporte très minutieusement le déroulé des pourparlers qui s’engagent entre le Royaume-Uni et Maurice au tout début de l’année 200968, soit quelques mois avant l’échéance du délai de dix ans69. Le Royaume-Uni se dit alors prêt à accepter le dépôt d’une demande conjointe et des négociations sont engagées en ce sens avec Maurice. L’initiative ne va toutefois pas prospérer ; nous y reviendrons un peu plus loin. Le différend relatif à la question de la souveraineté va prendre le pas sur toute autre considération, imprimant une évolution inédite, rythmée par les interventions du juge international. Le cas, bien que s’inscrivant dans un contexte très spécifique, est néanmoins caractéristique d’une logique de confrontation, conduisant, en cas de différend entre États, à une situation de blocage devant la CLPC.
La confrontation entre les prétentions des États côtiers et les droits des États tiers
Lorsque les demandes sont présentées dans le contexte d’un différend sensible entre États, la coopération peut s’avérer difficile si ce n’est impossible et les difficultés arrivent. Les textes indiquent clairement que la compétence pour les questions relatives aux différends pouvant résulter de la fixation de la limite extérieure du plateau continental reste exclusivement entre les mains des États70. Lors du dépôt d’une demande, un État doit informer la CLPC de l’existence d’éventuels différends avec les États tiers71. Comme indiqué précédemment, ces derniers peuvent alors prendre position par voie de notes verbales et s’opposer à l’examen de la demande : en d’autres termes, ils conservent un pouvoir de blocage72.
Le laboratoire du golfe du Bengale
Une telle hypothèse s’est notamment présentée dans le cas du golfe du Bengale, mais aussi dans le golfe Arabo-Persique. Quatre États continentaux (Myanmar, Pakistan, Bangladesh, Inde) ont chacun présenté une demande, respectivement en 2008, 2009 et 2011. Mais l’existence de différends portant sur la délimitation des frontières maritimes entre le Bangladesh et le Myanmar d’un côté, le Bangladesh et l’Inde de l’autre, mais aussi entre l’Inde et le Pakistan a pu empêcher la CLPC de statuer. Le Bangladesh s’est opposé à l’examen de la demande du Myanmar73, y compris après que le TIDM a rendu son jugement dans le différend qui opposait les États en matière de délimitation maritime74. La demande n’est toujours pas examinée à ce jour. Les deux États se retrouvent donc dans une situation non sécurisée : le TIDM a délimité les plateaux continentaux respectifs des deux États, y compris dans la portion au-delà de 200 milles marins75, sans que la limite extérieure soit encore établie. La demande de l’Inde en revanche a pu un temps prospérer, la sous-commission chargée de son examen ayant été établie en 201976. Elle se trouve néanmoins aujourd’hui bloquée du fait de l’opposition manifestée dans la foulée par le Pakistan (en lien avec la partie ouest de la demande indienne, dans le golfe Arabo‑Persique)77.
Dans le golfe du Bengale, le différend en matière de délimitation maritime entre l’Inde et le Bangladesh a connu un épilogue en 2014, lorsque le Tribunal arbitral a rendu sa sentence. À l’instar du TIDM en 2012, le Tribunal arbitral a délimité le plateau continental étendu entre l’Inde et le Bangladesh, sans que la CLPC ait statué à ce jour sur la limite extérieure pour ces deux États. Seule en définitive, la demande du Pakistan n’a pas soulevé d’objections : elle a prospéré et le Pakistan a notifié en 2016 la limite extérieure d’un plateau continental étendu, sur la base des recommandations de la CLPC.
Au-delà de sa complexité, la situation dans le golfe du Bengale aura hissé l’océan Indien au rang de laboratoire. Elle a en effet conduit à ce que le juge international, pour la première fois, soit saisi de la question de la fixation des limites du plateau continental étendu. Éclairant les rôles respectifs de la CLPC et du juge, et confirmant la possibilité que ce dernier puisse délimiter deux zones de plateau continental étendu, avant même que la Commission ne se soit prononcée, cette jurisprudence a ouvert le chemin pour des cas futurs. L’instance pendante devant la Cour internationale de Justice cette fois, s’agissant de la Somalie et du Kenya a, comme mentionné plus avant, conduit la Cour à se reconnaître compétente pour connaître du différend78. Sans citer le TIDM, la Cour emprunte néanmoins, dans son arrêt du 2 février 2017, le sillon tracé par ce dernier : elle confirme qu’« une incertitude concernant la limite extérieure du plateau continental et, partant, l’endroit précis où se situe le point terminal d’une frontière donnée dans la zone située au-delà de 200 milles marins n’empêche (…) pas nécessairement les États concernés ou la Cour, si les circonstances s’y prêtent, d’entreprendre la délimitation de la frontière avant que la Commission ait formulé ses recommandations »79. L’arrêt sur le fond est désormais particulièrement attendu.
Dans un registre fort différent, la demande présentée par Maurice pour la zone Sud de l’archipel des Chagos, ainsi que la confrontation entre l’État mauricien et les Maldives, s’agissant de la zone Nord de l’archipel constituent un autre exemple de blocage.
Le cas de l’archipel des Chagos, puzzle pour initiés
Les Chagos sont au cœur d’un différend ancien et hautement sensible entre le Royaume-Uni et l’État mauricien. Détaché de Maurice en 1965 lors de l’accession à l’indépendance et nommé par le Royaume-Uni Britsh Indian Ocean territory – BIOT, l’archipel est alors resté, de fait, sous administration britannique. L’État mauricien a entrepris de longue date un combat dans l’arène diplomatique et judiciaire internationale pour obtenir que soit reconnue sa souveraineté80. Au cours de ces dernières années, une accélération assez spectaculaire du processus est constatée, dont témoignent, entre autres, pas moins de trois interventions du juge international81. La question de l’extension du plateau continental est alors intimement et inextricablement liée à cet héritage colonial non soldé. Au fil d’une chronologie dense, les pièces d’un puzzle pour initiés se mettent en place.
Au tout début de l’année 2009, des négociations sont engagées entre le Royaume-Uni et Maurice en vue d’effectuer une demande conjointe d’extension du plateau continental82. Les conversations exploratoires montrent que les deux États étaient donc initialement d’accord pour considérer qu’une telle demande pouvait être déposée, sans préjudice des positions respectives sur la question de la souveraineté (clause nommée « sovereignty umbrella »83). Par ailleurs, la position du Royaume-Uni quant aux effets d’une extension du plateau était clairement affirmée : celle-ci serait intégralement au bénéfice de Maurice, puisque la souveraineté britannique n’est exercée qu’à des fins de défense et que les accords de 1965 consacrent explicitement le droit de Maurice de tirer bénéfice de tout gisement minier ou pétrolier découvert dans ou à proximité de l’archipel84. Au fond, la solution permettait que Maurice puisse faire valoir ses droits et préserve l’avenir, en contournant l’épineuse question de la souveraineté.
En mai 2009 toutefois, Maurice décide de déposer seul, devant la CLPC, des informations préliminaires. L’idée de déposer in fine une demande conjointe n’est toutefois, à l’époque, pas abandonnée comme en témoignent les pourparlers qui se tiennent en juillet de la même année85. Elle ne prospèrera néanmoins pas, les évènements de l’année 2010 contribuant sans doute à éloigner cette perspective. Le 1er avril, le Royaume-Uni décide unilatéralement de créer une aire marine protégée sur le pourtour de l’archipel, prérogative que le droit de la mer réserve à l’État côtier. La décision est attaquée par Maurice en décembre, devant un tribunal arbitral constitué sur le fondement de l’annexe VII de la CNUDM.
Entre-temps, un autre État de la région s’est invité au débat : les Maldives déposent en effet en juillet 2010 une demande devant la CLPC qui provoque une série de réactions. Le Royaume-Uni, d’abord, observe que la demande empiète sur la zone de pêche et environnementale du BIOT et se dit ouvert à la négociation86. Dans la foulée, Maurice réitère sa souveraineté sur les Chagos, demandant qu’il ne soit pas tenu compte de la note verbale du Royaume-Uni87. Il enjoint par ailleurs les Maldives à modifier leur demande, qui chevauche ce que Maurice considère comme étant sa Zone économique exclusive autour des Chagos. Constatant que les Maldives n’ont toujours pas modifié leur demande en mars 2011, Maurice s’oppose à l’examen de celle-ci et suscite, en octobre 2019, le déclenchement d’une procédure judiciaire88. Celle-ci a d’ores et déjà abouti à un premier arrêt sur les exceptions préliminaires. Le 28 janvier 2021, une chambre spéciale du TIDM, rejetant l’ensemble des exceptions soulevées par les Maldives, s’est déclarée compétente pour examiner au fond la question de la délimitation de la frontière maritime entre les deux États, y compris le plateau continental étendu.
Avant cela, le 18 mars 2015, le tribunal constitué pour régler la question de la création de l’aire marine protégée avait invalidé la décision du Royaume-Uni, sans se prononcer sur la question de la souveraineté et la qualité d’État côtier89 du Royaume-Uni contestée par Maurice90. Il confirmait par ailleurs les droits économiques de Maurice au titre des engagements de 196591.
Le 25 février 2019, une procédure initiée par l’Assemblée générale de l’ONU devant la CIJ92 débouche sur l’avis par lequel la Cour déclare que « le maintien de l’administration de l’archipel des Chagos par le Royaume-Uni constitue un fait illicite qui engage la responsabilité internationale de cet État ». En conséquence, « le Royaume-Uni est tenu, dans les plus brefs délais, de mettre fin à son administration de l’archipel des Chagos »93. Au lendemain de l’avis, Maurice dépose une demande d’extension du plateau continental, concernant la Zone Sud de l’archipel. Reprenant les points forts de l’avis, la demande de l’État mauricien interprète la position de la Cour comme confirmant que le Royaume-Uni n’a jamais eu, et n’a pas, la souveraineté ou de droits souverains sur les Chagos94. Du point de vue de Maurice, il n’existe donc pas (plus) de différend concernant l’archipel95. Au regard des règles applicables devant la CLPC, l’affirmation de Maurice, selon laquelle il n’existe plus de différend relatif à la souveraineté sur les Chagos fait assurément sens : elle vise à convaincre que les conditions sont réunies pour que la Commission statue. Le Royaume-Uni ne l’a pas entendu ainsi. Dans une note verbale du 28 juin 2019, l’État britannique réaffirme sa souveraineté sur l’archipel96 et l’existence d’un différend avec Maurice. Invoquant son droit de veto, il s’oppose à l’examen de la demande par la Commission97. L’État britannique suggère le retour aux négociations bilatérales en vue du dépôt d’une demande conjointe. L’avancée dans cette voie paraît toutefois, à ce jour, tout à fait exclue puisqu’elle signifierait que Maurice accepte le jeu de la clause de la « sovereignty umbrella ». La position mauricienne vient d’ailleurs d’être renforcée par l’arrêt rendu par la chambre spéciale du TIDM dans le différend Maurice/Maldives98.
Le juge devait notamment répondre à la question de savoir si Maurice peut être considérée comme l’État dont les côtes sont adjacentes ou font face à celles des Maldives aux fins de la délimitation maritime conformément aux articles 74 § 1 et 83 § 1 de la CNUDM. Pour répondre à cette question, les Maldives considéraient que la chambre devait nécessairement se prononcer sur le différend relatif à la souveraineté sur l’archipel : ils y voyaient un motif d’incompétence du juge. L’arrêt ne fait pas droit à cette analyse : la chambre spéciale, suivant un raisonnement audacieux, qui prend en particulier appui sur l’avis rendu par la CIJ considère que cet avis, en se prononçant sur les conditions de la décolonisation, a bien pris position sur la question de la souveraineté99. La Cour s’est donc bien prononcée sur cette question – en faveur de Maurice – et, l’avis, bien que non obligatoire en tant que tel, a « un effet juridique »100. Il en va de même de la résolution de l’Assemblée qui fixe, dans la foulée, les conditions de la décolonisation. Plus concrètement, la Cour considère que le différend a été réglé et que l’exception préliminaire doit être rejetée. Sévère et sèche, la Chambre assène alors :
il est inconcevable que le Royaume-Uni, dont l’administration de l’archipel des Chagos constitue un fait illicite à caractère continu auquel il doit par conséquent être mis fin dans les plus brefs délais, ce qu’il n’a toujours pas fait, puisse avoir quelque intérêt juridique à disposer de façon permanente de zones maritimes autour de l’archipel des Chagos par la voie d’une délimitation101.
Cela lui permet de conclure :
Maurice peut être considérée comme l’État côtier en ce qui concerne l’archipel des Chagos aux fins de la délimitation d’une frontière maritime, même avant le parachèvement du processus de décolonisation de Maurice102.
Quelles peuvent être à présent les suites, s’agissant de la demande d’extension du plateau continental, présentée par Maurice dans la région Sud des Chagos ?
On notera que lors de la 50e session de la CLPC (juillet-août 2019), Maurice a fait valoir que sa demande faisant partie d’un ensemble de demandes partielles, l’État mauricien entendait déposer « en temps utile » une nouvelle demande partielle au sujet de la région Nord de l’archipel des Chagos. Le représentant de Maurice a poursuivi en rappelant l’avis consultatif de février 2019, ainsi que la résolution 73/295 de l’Assemblée générale de mai 2019, « exposant en détail les vues de son gouvernement sur les incidences de l’avis consultatif et de la résolution pour la Commission »103. Prenant acte de ces éléments, la Commission a décidé, comme le lui permet l’article 51 de son règlement intérieur, qu’elle « reprendrait l’examen de la demande le moment venu, les demandes étant examinées dans l’ordre dans lequel elles étaient reçues »104.
L’arrêt de janvier 2021 conforte incontestablement la position de Maurice ; il sera particulièrement intéressant d’observer à l’avenir les prises de position que ne manqueront pas d’adopter les intéressés ainsi que les institutions onusiennes. On songe notamment ici à la prochaine Réunion des États Parties à la CNUDM (juin 2021), mais également à la 76e session de l’Assemblée générale de l’ONU lorsqu’elle évoquera les suites données à l’Avis de 2019 et à sa propre résolution.
En toute hypothèse, la demande portant sur la région Sud des Chagos, et, plus encore, la demande à venir relative à la région Nord, ne pourront pas être examinées avant de nombreuses années. Dans l’intervalle, la position du Royaume-Uni a largement le temps d’évoluer… ou pas…
Conclusion
Deux ensembles d’éléments, l’un qui constate l’autre qui interroge, peuvent être avancés en guise de conclusion.
Sous le signe du constat, on remarquera d’abord que les démarches d’extension du plateau continental dans l’océan Indien témoignent, ici comme ailleurs, d’une pratique où la généralité et même la banalité des cas côtoient l’unicum comme le montrent les cas de l’archipel des Chagos, ou de l’Antarctique. On aura noté aussi, l’importance des îles, comme point de départ et fondement à l’extension de l’emprise maritime des États : le fait n’est guère nouveau mais il est confirmé de manière assez spectaculaire ici. Également, on ne peut que s’inquiéter de la charge de travail très considérable de la Commission qui ne peut absorber l’examen des demandes dans des délais raisonnables. On comprend alors les États côtiers en développement et les petits États insulaires lorsqu’ils soulignent « l’injustice dont ils pourraient souffrir si leurs demandes restaient sans examen pendant de nombreuses années, alors qu’ils ont dû fournir de gros efforts pour respecter les délais »105. Enfin, il faut souligner que face à ce processus en marche, l’océan Indien, comme les autres espaces maritimes, n’échappe pas à la logique du « mitage » de l’Océan mondial. Cette « obsession du territoire » – si bien décrite par Georges Scelle quand il commentait en 1955 la toute récente consécration en droit de la mer du plateau continental – cette obsession du territoire donc, semble la chose la plus communément partagée par les États de la planète, avec ce qu’elle emporte de complexification dans l’utilisation des espaces maritimes et d’insécurité juridique liée à la nécessité de définir de nouvelles frontières maritimes.
Une seconde série d’observations invite à relier la question de l’extension du plateau continental dans l’océan Indien avec l’enjeu contemporain des changements climatiques. Quels sont ici les liens et les questions ? Il semble que ceux-là et celles-ci sont d’un intérêt particulier pour la plupart des États de l’océan Indien, notamment - mais pas seulement - les petits États insulaires en développement. L’élévation globale du niveau de la mer va-t-elle entraîner une remise en cause des lignes de base actuelles, point de départ à la fixation des limites extérieures des territoires maritimes ? Quid alors de cette ultime frontière que constitue la limite extérieure du plateau continental étendu ? Dans sa décision portant sur la délimitation dans le golfe du Bengale, le Tribunal arbitral invité à se prononcer sur la question par le Bangladesh a décidé que : « Future changes of the coast, including those resulting from climate change, cannot be taken in account in adjusting a provisional equidistance line »106. Il y a toutefois fort à parier que la solution n’a pas épuisé le débat107. Au-delà de la question des lignes de base, comment articuler de manière cohérente les efforts visant à maîtriser les gaz à effet de serre et évoluer vers des économies moins carbonées et l’extension du plateau continental aux fins d’exploration de nouveaux gisements de pétrole et de gaz ? N’y a-t-il pas ici une contradiction vertigineuse ? Et l’on voit, finalement, que le sujet très technique et très spécifique de l’extension du plateau continental pose des questions juridiques aussi classiques qu’actuelles et que toutes n’ont pas trouvé réponse à ce jour.
Le 28 février 2021