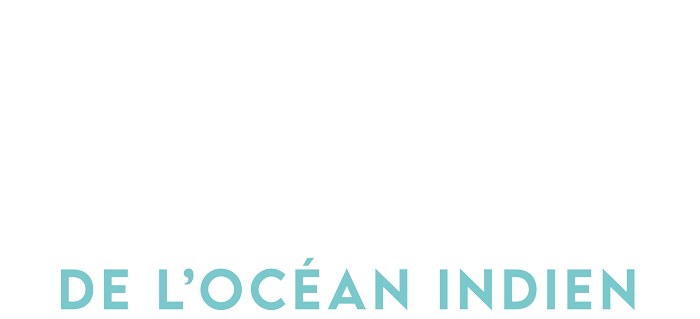Certaines réflexions ayant amené à cet article sont issues des séminaires de master de Carpanin Marimoutou à l’Université de La Réunion, et ont été enrichies par les interventions de ma collègue Elisa Huet et par nos conversations. Je les remercie tous deux.
Introduction
La relation de voyage a été la première forme de discours et de littérature écrite produite à propos des îles des Mascareignes, depuis les aventures de Sindbad le marin jusqu’aux récits de traversées à la voile en solitaire, en passant par la littérature coloniale1. Jusque-là désertes, ces îles sont ainsi venues à la pensée depuis le récit de voyage, depuis un regard du dehors, comme une destination, un ailleurs. Quand bien même à cette première littérature viatique s’ajoute ensuite celle de l’habitant, sous forme orale ou écrite2, la forme du récit de voyage peut demeurer pertinente pour dire l’espace insulaire et l’histoire profondément migratoire des Mascareignes. Mais ces îles ne sont plus aujourd’hui seulement un lieu de passage et de déracinement, qui ne faisait sens qu’à travers le manque d’une autre terre, l’Europe d’où vint le navigateur, l’Afrique d’où fut arraché l’esclave, l’Inde d’où partit l’engagé ; issues des sociétés plantationnaires et de l’engagisme, les Mascareignes sont aujourd’hui un habitat, un lieu créole3. Or le récit viatique repose sur certains présupposés qui posent problème pour dire cette réalité créole. Le premier est la certitude que l’océan et l’île sont offerts au parcours, à la compréhension, à la conquête et à l’écriture : le récit de voyage présuppose que le monde est adéquat à l’esprit humain et, en cela, s’inscrit dans une tradition épique4. Cette vision holiste5 permet de dire la découverte et l’annexion des îles ; mais elle les rend aussi d’emblée familières en les intégrant dans un cadrage cognitif préétabli, réduisant leur altérité et leur étrangeté à un décor exotique pour le voyage épique. Le deuxième présupposé du récit viatique est le regard extérieur qu’il pose sur l’île, celui du voyageur. La pratique du voyageur relève d’une binarité paradoxale : tout en venant conquérir l’île, il ne la verra jamais que comme un ailleurs. Cette dialectique de l’ailleurs est le dernier présupposé viatique que met en crise la nécessité contemporaine d’habiter les îles créoles. Car si l’île se donne comme non-lieu, un lieu manqué puisqu’il advient par le manque du lieu d’origine, l’esclave, le colon, le navigateur et surtout leurs descendants n’ont pas d’autre lieu où revenir. L’île créole doit se dire aujourd’hui dans ce double impératif contradictoire, ce « je n’ai qu’un pays et ce n’est pas le mien »6 : à la fois lieu habitable, pays, nation ; à la fois lieu construit dans le deuil d’autres lieux7.
Écrire le voyage dans les îles des Mascareignes aujourd’hui suppose donc à la fois une rupture et une continuité avec la tradition viatique. Le thème et la forme du récit de voyage sont régulièrement repris et transformés dans les romans mauriciens contemporains, chez Amal Sewtohul, Shenaz Patel ou Carl de Souza. Mais chez Natacha Appanah, et particulièrement dans Le Dernier frère, paru en 2007, le récit de voyage et l’histoire migratoire ressemblent plus à une hantise qui empêche le roman du lieu mauricien de s’écrire, et les personnages de l’habiter. Dire le voyage semble à la fois inévitable et impossible, paradoxe qui était déjà au cœur du journal de Jean-Marie Le Clézio, Voyage à Rodrigues, paru en 1986. Si l’auteur y adopte la forme traditionnelle du récit viatique8, ce n’est semble-t-il que pour montrer les limites de ce regard venu d’ailleurs ; Appanah, une vingtaine d’années plus tard, met le roman, forme vernaculaire articulée dans l’histoire littéraire à la naissance des nations9, au défi de dire l’ici mauricien d’aujourd’hui sur la base des voyages non-dits d’hier. Avec la question de la forme dans laquelle le voyage peut être dit, c’est ainsi celle du point de vue depuis lequel il peut être raconté qui est posée par ces deux œuvres. Maurice et Rodrigues s’écrivent ici à rebours du voyage, dans un renversement progressif de la tradition viatique : du voyage même, dont l’île n’est la destination que parce qu’elle en est l’origine perdue ; du lieu insulaire ensuite, qui ne peut plus être traversé ; du récit enfin, qui renonce à ses prétentions épiques.
À rebours du voyage
Le titre du journal de Le Clézio est programmatique : Voyage à Rodrigues s’inscrit d’emblée dans la tradition des récits de navigateurs et de colons (par exemple Voyage à l’Île de France de Bernardin de Saint-Pierre en 1773, pour n’en citer qu’un). Ce genre de titre inscrit également le récit dans une tradition épique puisqu’aucune remise en question n’est annoncée, ni de la destination du voyage, ni de la possibilité de l’atteindre. Le voyage paraît accompli avant même que le récit ne commence, et Le Clézio ne laisse aucun doute : le narrateur posera pied à Rodrigues. Ellipse est même faite du trajet jusqu’à l’île, comme si ce n’était finalement pas cela l’objet du voyage – ou comme si ce n’était pas ce voyage-là l’objet du récit. Car Voyage à Rodrigues (VAR) est déjà à rebours de la tradition viatique : si l’île y est la destination du voyage, c’est avant tout parce que le narrateur y cherche une origine, en revenant sur les traces de son aïeul. Le récit se met alors en quête de sa propre origine créole, mais cette origine est perdue, refusée – et avec elle c’est la destination qui est aussi refusée. L’errance n’est pas en mer, la question n’est pas « où est Rodrigues ? y arrivera-t-on un jour ? » ; la question est « qu’est-ce que Rodrigues ? » : oui, le narrateur a posé pied sur l’île – mais il n’y conquerra rien, n’y comprendra rien. L’île ne se donne que pour mieux se refuser. Le narrateur est ainsi pris dans une errance spatiale et identitaire que reflète un récit qui se mord la queue : « J’avance le long de la vallée de la rivière aux Roseaux » (VAR, p. 9), parcours qui ouvre le récit in medias res, le clôt aussi (VAR, p. 130 ; 144). De repères imaginés en remises en questions, le narrateur a tourné en rond et n’a pas trouvé le trésor du Corsaire. La seule origine du récit est aussi celle du voyage, et c’est une origine perdue : « C’est la perte de cette maison qui, je crois, commence toute l’histoire » (VAR, p. 121) ; il y a là un deuil de l’origine dans le sens où le narrateur hérite de la mémoire d’un exil originel, de l’absence d’une terre natale, et que cette absence, cet exil n’ont pas de mots10. Le deuil de l’origine devient alors un manque structurel à la fois dans la diégèse, condamnant le narrateur à l’errance en court-circuitant sa pratique du lieu11, et dans le récit même, qui bégaie12 – le narrateur revient dix fois sur le vent qui balaie l’île –, se questionne, ne s’ordonne ni chronologiquement ni spatialement, ne tient finalement que par la conscience rétrospective du narrateur.
Le Dernier frère (DF), en revanche, ne s’annonce pas, sous son titre énigmatique, comme un roman du voyage. Il n’en est d’ailleurs pas un, stricto sensu : le protagoniste Raj ne quitte pas l’île Maurice avant son vieil âge, et ce voyage-là est seulement mentionné. Dans les deux œuvres, on peut noter l’absence de parcours maritime et de représentation de la mer, topoï du récit viatique. Mais chez Appanah le voyage manque : celui des ancêtres de Raj jusqu’à Maurice, très probablement des « travailleurs engagés » indiens ; celui de David jusqu’à l’île, lui-même échec d’un autre voyage, vers la Palestine. Le voyage hante pourtant les consciences et se fait la matrice du récit :
« Je lui ai dit que, moi aussi, j’avais voyagé avant de venir ici parce que c’est comme ça que je voyais les choses à cet âge-là, les kilomètres et les océans ne faisaient pas la différence, David et moi avions quitté là où nous étions nés et nous avions suivi nos parents pour un endroit étrange, mystérieux et un peu effrayant et où nous pensions échapper au malheur » (DF, p. 87).
Si le récit du roman ne s’annonce pas comme un récit de voyage traditionnel, il trouve pourtant son origine dans le déracinement ; ce sont là des voyages contraints, inachevés, sans retour possible – des voyages non à contresens mais au cœur desquels œuvre un contresens, puisqu’au lieu de dire la découverte et la conquête de nouvelles terres, ils en disent la dépossession.
Ainsi le parcours spatial dans les deux œuvres est-il caractérisé par des ratages épiques13. Au début du chapitre 3 du Dernier frère, la famille de Raj, récemment endeuillée de ses deux frères, quitte le camp de Mapou adossé à une exploitation sucrière pour traverser le pays et finalement s’établir dans une maison dans la forêt : ce voyage, qui n’est pas sans rappeler le trajet des esclaves marrons, provoque l’attente d’une référence épique au sens où l’épreuve devrait exalter un sentiment collectif et permettre la fondation d’une communauté14. La voix du narrateur redouble cette attente : « Ce voyage aurait pu nous souder encore plus, nourrir des espoirs de lendemains, nous aurions pu être des pionniers » (DF, p. 38). Et pourtant, rien n’y est fondé : le sentiment de communauté semble empêché par le deuil, et le voyage n’est pas un nouveau départ mais une fuite ; d’autre part, l’actualisation du récit même est suspendue par l’usage du conditionnel et de nombreuses phrases interrogatives. L’espace traversé devient une suite de lieux communs, « des locomotives, des gens, des paysages, des fleurs, des chevaux luisants, des sentiers de terre qui mouraient dans la mer, la mer même peut-être », tout cela sous le couvert d’un « j’imagine » : le récit viatique est désactivé, signalé dans toute sa fictionnalité. L’attente du voyage est créée, dans le déroulement de l’action, dans les souvenirs du personnage, dans le roman lui-même, mais ce voyage ne vient jamais – il est manqué, raté. Le même trajet est refait ensuite en sens inverse, transformant le parcours linéaire en parcours cyclique, et à nouveau, c’est un ratage : annoncé à la fin du chapitre 10, le départ est retardé par le récit d’un rêve, par une digression sur les archives, par un détour par l’école ; lorsque la traversée de la forêt commence enfin, elle est brutalement interrompue par l’irruption de la prison en travers du chemin. Le voyage erre alors à nouveau, revient au village, et avec lui c’est la narration tout entière qui bégaie, se mine de questions à la fin du chapitre 11 pour ensuite s’extraire de l’analepse. Il y a là quelque chose qui résiste, qui refuse de se dire : le bégaiement devient l’équivalent narratif de l’errance, au sens que quelque chose bloque et empêche le récit et le voyage d’être linéaires. Et lorsqu’enfin le récit commence, c’est celui d’un voyage qui ne mène nulle part : Mapou, ne figurant pas sur les cartes de l’école, est devenu le lieu utopique d’une enfance heureuse pour Raj, et se confond en cela avec Eretz, terre promise vers laquelle tend David, deux destinations rêvées pour un voyage impossible. La seule référence épique du voyage est ironique : Raj et David se retrouvent brièvement inclus dans une communauté qui construit… une autre prison. Par ailleurs, la focalisation interne de l’enfant donne parfois à la quête une allure de conte avec la maison en lisière du bois, la traversée de la forêt, ou encore les « mArrOns », dont l’orthographe emphatique montre bien qu’ils sont tout droit sortis d’un discours qui les diabolise, relayé par le père, et qui ne sont plus si loin de l’ogre qui mange les enfants. Mais le vieil homme qu’est devenu le narrateur se distance bien vite de ce scénario contique qui aurait pu lui aussi constituer une référence épique. Ainsi, les premiers temps du voyage donnent l’impression d’une mise en spectacle : la fuite de l’école est comparée à celle de voleurs, puis à « deux clowns se pourchassant » (DF, p. 144) ; Raj a des « jambes agiles de singe », David saute « comme s’il était champion de saut en longueur » (DF, p. 148), leur fuite est « grand numéro », un « jeu », une « illusion » (DF, p. 149). Le voyage épique est parodié : si l’illusion peut perdurer un temps que l’espace se pliera à la volonté humaine de le traverser, elle finit par s’effondrer lorsque le chemin parcouru ramène les deux enfants à la réalité – à la prison. Le narrateur du Voyage à Rodrigues quant à lui compare le voyage de son aïeul, et donc le sien qui en est une reprise, avec celui de Jason et des Argonautes. Mais ce ne sont pas tant les références épiques des épreuves initiatiques qui rapprochent les deux quêtes que la mise en suspens de leur origine et de leur but : « Que voulait Jason ? […] Qui l’avait investi de ce rôle ? » (VAR, p. 64). La quête du Voyage n’est pas celle de la Toison d’or : le trésor du Corsaire n’est finalement qu’un indice, pour le narrateur, de ce qu’il recherche vraiment, son grand-père, sa mémoire, son origine. La dimension épique de chasse au trésor est d’emblée désactivée ; le trésor est un horizon qui, au lieu de résoudre l’énigme du lieu, l’épaissit.
Le parcours de l’île se tisse ainsi, par l’intermédiaire du récit et de la mémoire, de références au conte, à l’épopée antique ou à la geste fondatrice des pionniers – qui serait donc, historiquement, celle des conquêtes coloniales – à laquelle se mêle le spectre du marronnage : « nous étions des mArrOns désormais et notre place était bien ici » (DF, p. 151) – ; mais les prétentions épiques ne semblent pas fonctionner dans l’île créole, et le voyage devient une errance. C’est ainsi que devenu adulte, Raj ne sait jamais ce qu’il cherche lorsqu’il se rend aux archives – car ce qu’il cherche est une histoire sans mots ni discours. D’une visite aux archives qui lui apprend la date du cyclone, il déduit la date de leur fugue (DF, p. 147) : le récit viatique est inversé, on met en avant son artifice. Le voyage est fabriqué, a posteriori, par les archives, à partir de ce qui n’était qu’une errance. Car la double absence d’origine et de destination dessine un espace labyrinthique dans lequel on ne peut ni se diriger, ni entrer complètement15, et donc seulement errer : Le Clézio déplore régulièrement un paysage « hermétique » (VAR, p. 24), « d’éternel refus » (VAR, p. 77). Et ce que le paysage refuse d’abord, c’est d’être codifié dans une lecture monosémique : « Nous passons notre temps à essayer de lire les signes de la nature » (DF, p. 181) dit Raj, tandis que le narrateur du Voyage s’use les yeux à déchiffrer dans le paysage « d’incompréhensibles frontières », « d’inutiles chemins », « d’étranges ronds-points » (VAR, p. 14). L’espace a pourtant bien un sens, mais ce sens recule :
« Comment ne pas voir dans ce paysage désertique, façonné par le vent et par la pluie, imprégné de soleil, l’expression d’une volonté ? Message laissé comme par inadvertance par quelque géant terrestre, ou bien dessin de la destinée du monde. Signes du vent, de la pluie, du soleil, traces d’un ordre ancien, incompréhensible » (VAR, p. 46).
Les efforts pour déchiffrer ce langage et faire du paysage un indice sont vains : dans Le Dernier frère, la carte de l’institutrice qui devait rendre le paysage intelligible est caduque dès le début, puisque Mapou n’y figure pas. Chez Le Clézio, « chaque parcelle du paysage devient un symbole » (VAR, p. 48), par la toponymie, par le balisage en repères, en points, la triangulation ; mais finalement, ces lignes, angles et points de repères qui devaient rendre le paysage intelligible « recouvrent le dessin simple et facile de l’Anse aux Anglais », opacifiant encore davantage le lieu. Dans un tel labyrinthe, il n’est plus possible de voyager, si le présupposé du voyage était la compréhensibilité du lieu.
À rebours du lieu
Le labyrinthe des Mascareignes, d’autres l’ont pourtant traversé. Quelque chose ici dans la conscience narrative révèle l’opacité de l’île, l’impossibilité de la traverser : si les personnages errent au lieu de traverser16, c’est qu’ils devinent, au cœur du lieu, quelque chose de silencieux qui se manifeste et qui les fait trébucher. C’est cette sensibilité, cette nostalgie sans objet qui leur permet d’entrer en consonance avec le lieu créole et qui, tout en empêchant le voyage, y révèle un ailleurs – un autre espace17.
Le récit viatique est supposé dire un espace référentiel ; cependant, parce que le point de vue sur cet espace est extérieur, il dira aussi un espace marqué par la différence, en bien ou en mal : c’est le tableau de l’île édénique ou, au contraire, infernale telle l’Île de France décrite par Bernardin de St-Pierre en 1773. L’entreprise de Le Clézio est à cet égard double : il s’agit à la fois de construire une familiarité de l’espace, et en cela la représentation référentielle de Rodrigues est très précise sur le plan de la topographie ; mais le récit témoigne aussi de la recherche d’un ailleurs dans le paysage, espace mythique dont les pierres seraient les signes : « une pierre, une ombre portée, une marque sur la roche, ou bien la position d’une montagne, d’un pic, la hauteur d’une falaise, le chemin de l’érosion sur les pentes des collines, la place d’un arbre, tout parlait, avait un sens, une urgence » (VAR, p. 80). Cette herméneutique de l’île qui fait du paysage une écriture s’appuie sur l’hypotexte des Révélations du Grand Océan18 et va devenir une quête, « quête d’autres espaces sur le territoire qu’on habite, mais aussi quête du langage qui pourrait dire la vérité de ces espaces »19. C’est cette quête que redouble le Voyage, mais l’espace mythique et sa langue y restent inaccessibles : « ce message que je cherche, qui est écrit au fond de cette vallée, ne peut me parvenir, seulement m’effleurer. Comme une parole qui viendrait du bout du temps, et qui irait en volant droit devant elle, vers l’autre bout du temps » (VAR, p. 45). Le sens mythique du lieu et la langue mythique pour dire ce sens20 restent des horizons. Une nouvelle fois, le manque de l’origine court-circuite la quête du voyage, et le lieu reste une énigme.
Le parcours de l’île dans Le Dernier frère inverse lui aussi la logique viatique de découverte en opacifiant le lieu. Lorsque Raj et David quittent la maison, ils mettent une journée entière au lieu de la demi-heure habituelle pour arriver au village. Cette première étape d’un voyage qui refuse de commencer opère pourtant un glissement vers l’ailleurs. L’arrivée à la prison de Beau-Bassin constitue une rupture dans le trajet qui s’était engagé : avec la forêt prend fin aussi une protection qui était celle de l’imaginaire. Retour brutal à la réalité – mais quelle réalité ? Car la prison, avec son « chemin de terre propre et bien tassée, incongru après le cyclone », avec sa grille qui « [semble] avoir été épargnée par la tempête » (DF, p. 149), est en rupture non seulement avec les attentes du voyage mais avec le lieu mauricien. Le chemin est comparé aux voies du paradis, et l’enseigne sur la grille scande un « Welcome » hors de propos, dans le sens et dans la langue du récit. La prison semble un lieu arraché au lieu, hors de l’île : il n’est soumis ni à ses catastrophes naturelles, ni à sa nature, et se dit même, comme l’indique l’hétérolinguisme anglais dans le texte, dans une autre langue, « officielle » celle-là – dans un vocabulaire foucaldien, on pourrait parler d’hétérotopie.21 À la suite de cette rupture dans le chronotope romanesque, la forêt devient hostile. Tantôt accueillant espace de jeu, scène de la comédie de fuite par laquelle les enfants ne s’évadent pas tant de Beau-Bassin que de la réalité, la forêt semble à présent au contraire empêcher la fuite et le voyage. Les arbres leur refusent l’entrée, leur barrent la route, les menacent. On remarque que ce qui a métamorphosé l’espace, c’est la perte du chemin repéré sur la carte : la reprise en négatif des symboles cartographiques, comme les carrés qui sont devenus « humides et pourrissants », laisse penser que la carte, artéfact épique qui veut faire coïncider l’espace et l’esprit humain, est une illusion. Car cette adéquation ne peut se faire qu’au prix d’une réduction du paysage à un indice, à une vue de l’esprit : or tout ce que ne dit pas la carte, « l’épaisseur des forêts-pièges et le labyrinthe des champs de canne, la profondeur des lacs et la sinuosité des routes » (DF, p. 148) témoigne de l’opacité, de la polysémie du paysage. Sous l’espace ordonné de la carte se cache un autre espace qui refait surface sur le mode de la terreur : la forêt s’anime, peuplée de « monstres et de diables », elle devient un lieu de pourriture et de mort, « comme si une partie de la forêt était venue expirer ici » (DF, p. 163). Le paysage ne coïncide plus avec la carte ni avec la pratique que Raj en avait jusque-là, et c’est cette incertitude sur la consonance entre soi et le lieu devenu unheimlich22 qui court-circuite le voyage : le lendemain, les enfants longent la forêt, refusent d’y pénétrer. Le parcours révèle une dimension terrifiante du paysage ; il métamorphose l’espace et le rend étranger. De même le village, dévasté par le cyclone, ne correspond plus aux repères de Raj. La maison blanche aux dahlias rouges, dont les couleurs simplifiées rappellent encore les symboles de la carte, est annoncée mais n’apparaît jamais. La forêt comme le village subissent une distorsion qui les rend étrangers, comme si un autre espace, ou un autre temps, s’y manifestaient.
Les ruines du village mettent en effet deux temps en coprésence : celui d’avant le cyclone, un « village mort », « village fantôme », et le présent. À travers l’histoire de Mapou racontée à David revient un autre temps antédiluvien, et avec lui le fantôme d’Anil, « car il en faut peu pour que l’on croie que les morts peuvent revenir » (DF, p. 157). D’autres fantômes arrivent avec lui, fantôme d’un « garçon venu de loin » et de son peuple ; le chant en yiddish, « cette chanson cette mélodie cette prière », ressemble à une incantation qui métamorphose David en « un garçon qui se souvient de ce qu’il a été », un énonciateur de son histoire. Ce sont encore d’autres espaces, la lointaine Prague et la mythique Eretz, qui viennent hanter le lieu mauricien. Plusieurs espaces-temps sont donc coprésents dans la diégèse et dans les différents niveaux de narration puisque le vieux Raj raconte comment le petit Raj raconta l’histoire de Mapou : le lieu et son récit deviennent des palimpsestes. On remarque que l’invocation des fantômes se fait au milieu des ruines et des débris d’une autre histoire que symbolise la machine à coudre cassée, comme un rituel de deuil : la ruine devient la poétique du récit. Chez Le Clézio aussi le paysage est une ruine, vestige d’une signification perdue – trace de la Lémurie ou du trésor du Corsaire, peu importe. Le récit tente d’y ramener ces regards d’outre-tombe qui diffracteraient le lieu, y révéleraient d’autres espaces : « j’ai poursuivi des fantômes », dit le narrateur. « J’ai compris que ce n’était pas l’or que je cherchais, mais une ombre, quelque chose comme un souvenir, comme un désir » (VAR, p. 134). Comme le constate Carpanin Marimoutou, on a affaire dans les littératures de l’océan Indien à un chronotope non linéaire : au sein du lieu coexistent plusieurs temporalités qui empêchent un voyage linéaire à travers ce lieu23. La ruine est la trace de cette coprésence des temps, d’autres espaces-temps qui reviennent dans le présent sur le mode de la hantise24. Les récits eux-mêmes sont marqués par la revenance : questionnements incessants des narrateurs, ritournelle « Anil ! Vinod ! » chez Appanah, itération des mêmes syntagmes « terre brûlée » et « terre de vent » chez Le Clézio, comme si le paysage faisait violence au verbe. Le narrateur lui-même s’y qualifie de revenant, habité tour à tour par son aïeul et par le Corsaire, et c’est ainsi que le vieux compagnon de son grand-père le reconnaît : « Étrangement, je n’ai même pas été étonné qu’il me reconnaisse tout de suite. Ne savait-il pas que je devais revenir ? » (VAR, p. 144). Les récits bégaient, bloqués dans leur progression par quelque chose qui les hante et qu’ils ne peuvent dire.
Les îles elles-mêmes portent le deuil d’autres terres : l’Inde d’où sont venus les ancêtres de Raj à l’abolition de l’esclavage ; Prague d’où vient David, la Palestine où il devait aller ; l’Afrique d’où furent déportés ces esclaves « mArrOns » qui hantent la forêt – et la façon dont le père déforme le mot, reflétée par la graphie « mArrOns », signale bien à quel point on tente de rejeter ces hommes et femmes hors de l’histoire du pays, d’en faire des parias ; en assimilant les Juifs en exil à ces « mArrOns », le père exemplifie par son discours comment à leur tour ils seront relégués aux marges de l’Histoire nationale. De son côté, Le Clézio lui-même semble venir chercher à Rodrigues une origine insulaire perdue, recoudre l’histoire de ses ancêtres à la sienne, depuis le domaine mauricien d’Euréka où il n’est pas né : « maison pour moi mythique » (VAR, p. 125). À plus petite échelle, on voit lors du passage du second cyclone, dans Le Dernier frère, comment Mapou revient hanter Beau-Bassin, comment les deux temps du premier et du second cyclone viennent coexister en un même lieu :
« À l’instant même où le tonnerre a crevé, nous avions eu l’impression qu’une main géante et malfaisante venait nous enlever Vinod et Anil et que la maison de Beau-Bassin, la forêt, la prison, la nouvelle école, les longs mois depuis ce jour à Mapou, que tout cela s’était volatilisé d’un coup, et notre cœur et notre douleur étaient de nouveau à vif. C’est pour des moments pareils qu’il faudrait un mot pour dire ce qu’on devient à jamais quand on perd un frère, un fils » (p. 105).
Le deuil de Raj et sa mère reflète celui qui marque l’histoire des îles des Mascareignes ; ce deuil inscrit un temps passé dans les lieux, dans les corps aussi, fait d’eux des palimpsestes. Le lieu créole porte un tombeau : c’est d’ailleurs la visite au cimetière, sur la tombe de David, qui est l’embrayeur du récit en analepse, comme si ce récit était celui d’une histoire enfouie sous la terre. Les tombes allégorisent la dimension palimpsestique du lieu et le deuil originel qui l’a engendrée. Le cimetière devient ainsi, selon Françoise Lionnet, un lieu de « mémoires multidirectionnelles »25, à l’intersection entre les deuils de David et de Raj, ceux du peuple Juif et du peuple mauricien.
Car le lieu dont Maurice et Rodrigues portent le deuil est bien un lieu d’origine, historique comme l’Inde, l’Afrique ou Prague mais aussi mythique : l’Eretz dont rêvent David et les autres Juifs emprisonnés, terre promise, figure l’Eden originel ; la Lémurie, continent mythique à l’origine des Mascareignes vers lequel fait signe le paysage de Rodrigues26 ; ou encore simplement une Rodrigues mythique, celle que le Corsaire inconnu puis le chercheur d’or ont parcourue, et qui hante l’île que foule le narrateur. L’île porte ainsi le tombeau d’un lieu rêvé :
« […] il allait rentrer maintenant car là-bas, à la prison, ils attendaient le départ vers Eretz. Ma mère répéta en fronçant les sourcils Eretz ? David fit alors un geste très curieux. Il enfonça deux doigts dans le sol et, les ramenant couverts de terre sur sa poitrine, là où battait son cœur, il dit Eretz » (DF, p. 138).
Le geste de David montre bien qu’Eretz n’est pas une direction, qu’on ne peut y faire un voyage ; qu’Eretz est un lieu rêvé, promis, perdu – un lieu dont on porte le deuil en soi, et dont Maurice aussi portera le deuil, dans sa terre, dans ses ruines. De la même manière, si le voyage de Le Clézio à Rodrigues ne semble pas s’accomplir, au sens où Rodrigues ne devient jamais l’île au trésor qu’il cherchait, c’est que le lieu est paradoxal : le narrateur y cherche un autre espace que celui qu’il parcourt, voit les signes de l’ailleurs qu’il recherche, dessinés par les pratiques d’autres avant lui, et ne peut l’atteindre. La destination du voyage est un lieu fictif, la Rodrigues de la légende du Corsaire ; un lieu rêvé, la Lémurie dont on croit lire les vestiges sur les pierres ; un lieu passé, celui des plans du chercheur d’or et d’un monde plein de mystère qui n’existe plus : « Ce que je suis venu chercher à Rodrigues m’apparaît maintenant clairement. Et m’apparaît aussi clairement l’échec de cette enquête. J’ai voulu remonter le temps, vivre dans un autre temps, dans un autre monde » (VAR, p. 122). Il y a au cœur du lieu insulaire le deuil d’une origine qui court-circuite tout voyage, et même tout récit de ces voyages. L’île se dit et se parcourt dans le deuil et le désir d’un autre lieu, fût-ce un lieu rêvé. Le récit viatique ne peut plus dire le parcours découvrant et conquérant du lieu, puisque le lieu est une énigme. L’île créole porte un tombeau – et son récit également.
À rebours du récit ?
La hantise du lieu se traduit bien dans la narration : le voyage semble faire bégayer le récit dans Le Dernier frère. La première traversée de l’île est une ellipse dans les souvenirs du narrateur et se dit au conditionnel ; le récit de la deuxième traversée peine à commencer, s’interrompt d’analepses et de métalepses. Le récit du voyage ne commence enfin que haché, saccadé, ponctué d’ellipses – comme si ce qui était dit se refusait à la verbalisation et faisait hoqueter la narration. Lorsque Raj et David arrivent au village ravagé par le cyclone, la « machine à coudre noire, cassée, pliée au sol » évoque cette impossibilité de recoudre les morceaux de l’histoire. Le village et l’école dévastés sont d’ailleurs à chaque fois théâtres d’un « silence épais et effrayant » : il y a bien une hantise dans ce silence, une dialectique qui se met en place entre la présence de la ruine, signe d’un autre temps, et l’absence d’énonciation de cet autre temps, là où « personne ne pleurait sa maison ». Au cœur du lieu gît une histoire qu’on ne sait pas dire, un deuil qui comme celui de Raj et sa mère n’a pas de mots :
« Ma mère a porté, toute sa vie, comme moi, la mort d’Anil et de Vinod et comme moi, elle n’a jamais réussi à mettre un mot sur ce deuil-là. On peut dire qu’on est orphelin, veuf ou veuve, mais quand on a perdu deux fils le même jour, deux frères chéris le même jour, quel mot dit ce qu’on devient ? Ce mot nous aurait aidés, nous aurions su de quoi nous souffrions exactement […], ce mot-là aurait pu nous décrire, nous excuser, et tout le monde aurait compris » (DF, p. 103).
L’histoire de la famille de Raj et celle de Maurice, mise en miroir avec celle de David et du peuple juif, pose une question à l’historiographie : en face de la Shoah qui conduira à la création de l’état d’Israël, sur quels tombeaux s’est construite la nation mauricienne ? Notons bien que le miroir de la question juive permet de poser la question mauricienne, mais n’y répond pas : il ne s’agit pas, pour structurer le récit de Maurice, d’utiliser le paradigme de l’histoire juive, au risque de l’aliéner27. D’où l’inlassable passion de Raj, devenu adulte, pour les archives : comme s’il cherchait les mots dans lesquels s’est inscrit son deuil.
De la même manière, le récit de Le Clézio porte un deuil, celui d’une « écriture des pierres », d’une histoire mythique de l’île et d’une langue mythique également. Ce deuil se retrouve dans la narration à travers l’hétérolinguisme que constitue le langage cartographique non traduit dans le texte même. Le récit se peuple de symboles, de schémas, de notes fragmentaires indéchiffrables (VAR, p. 84-87) comme s’il tendait vers une autre langue plus à même de dire le lieu, cherchait une langue qui pourrait se faire la « parole de son mythe » (VAR, p. 105). On peut bien parler ici, selon les mots de Derrida ou Régine Robin, de deuil d’une langue originelle, authentique à soi et au lieu, qu’illustre le mythe lémurien :
« [chez Hermann] la langue créole ‟authentique” ne peut exister là aussi que comme trace, puisque, et c’est une constante chez lui, l’authenticité et la pureté n’ont de sens que comme désir et comme perte. C’est sans doute pour cette raison que le mythe lémurien est lié à une archéologie du langage, mais aussi à un désir de la transparence des mots, où dans la mort du sens se lirait la parole vivante, mais disparue »28.
Il est au cœur du paysage et du récit une absence signifiante : les histoires des origines, enfouies sous l’océan et les pierres, court-circuitent à la fois le voyage à Rodrigues et son récit. S’il y a une énigme du lieu, il y a aussi une énigme de l’écriture de ce lieu29. Ainsi l’écriture accompagne-t-elle le voyage : Le Clézio tient son journal et écrira un roman, Le Chercheur d’or30, Raj emmène avec lui son cahier, son crayon et sa gomme, « [fixe] la ligne de [son] destin » (DF, p. 140) – comme s’il ne s’agissait pas tant d’accomplir un trajet que de l’écrire. Or fabriquer une histoire, n’est-ce pas tracer un espace, dessiner une pratique qui y installe l’énonciateur ? « Nous étions des mArrOns désormais et notre place était bien ici » dit Raj (DF, p. 151). C’est comme si ce voyage manqué, pour lequel ils n’avaient « qu’à suivre une route marron », devenait acte de mémoire du marronnage ; ce faisant, il installe l’errant dans le lieu et rend l’histoire du marronnage à sa dimension structurante. En écrivant Voyage à Rodrigues, Le Clézio donne corps à la figure de son grand-père, à ses origines mauriciennes et crée une filiation à rebours31. La seule chose peut-être qui s’accomplit dans le voyage est alors un acte de mémoire.
Ce que le voyage opère finalement n’est pas tant un déplacement spatial qu’un déplacement du regard. J.-M. Racault remarquait à propos de Bernardin de Saint-Pierre que le regard du voyageur européen dans Voyage à l’Île de France devient insulaire dans le roman Paul et Virginie dont les deux héros, nés sur l’île de parents européens, sont les premiers Créoles32 ; le récit de voyage devient alors un récit du lieu. L’hypotexte en est sous-jacent chez Appanah, qui reprend la fuite de deux enfants à travers les forêts des hauts de l’île Maurice. Le Dernier frère s’inscrit donc dans la suite de ce premier roman de la créolisation33, mais l’origine insulaire du regard y est problématisée. Raj, le narrateur, est natif de l’île Maurice et descendant d’Indiens, donc créole34 ; mais sa parole doit, pour émerger, faire un détour par l’autre. Avant son voyage avec David, Raj était un enfant silencieux, qui aimait se cacher pour observer les autres : « je souhaitais faire un métier où l’on peut se cacher et surveiller » (DF, p. 53) ; il incarnait donc un point de vue insulaire, mais silencieux. Ce n’est que par le détour de l’expérience que l’autre fait de l’île, l’expérience du voyageur, que le récit peut advenir : il devient l’énonciation par un locuteur créole de l’expérience d’un voyageur qu’il partage, et en ce sens une créolisation du voyage. Chez Le Clézio, la focalisation est a priori celle du voyageur, extérieure à l’île. Mais le récit met en scène une parole qui trouve son origine dans l’île, quoiqu’elle soit incompréhensible : « quelque chose parle » (VAR, p. 78). Le récit refuse de rester un monologue du dehors : il se fait dialogue entre le regard du voyageur et un regard originaire de l’île, incarné tantôt par celui du grand-père (« c’est étrange, ce regard d’un homme mort depuis si longtemps […] et qui continue d’habiter dans cet endroit », VAR, p. 61) tantôt par celui du Corsaire et même des oiseaux ; le voyageur ne peut voir par ces yeux-là, mais il atteste l’existence de cette autre focalisation. Le Clézio installe ainsi une polyphonie dans son texte : ces autres voix, ces autres regards sont des exigences de l’habiter car « le silence exile » (VAR, p. 82), ferme l’espace ; ici les regards tiers, silencieux, ouvrent des brèches dans le récit du lieu, en font un tiers-espace dans lequel peut se faire entendre, en d’autres mots, une voix créole.
Conclusion
Tout en se plaçant dans la continuité du récit viatique, puisque le regard extérieur du voyageur semble encore nécessaire au récit de l’île, la narration dans Le Dernier frère et Voyage à Rodrigues va à rebours d’un monologue du dehors en problématisant l’origine du regard et de la parole. Les deux œuvres développent ainsi des récits de voyage créolisés, marqués par un deuil de l’origine et donc de la destination. Les codes du récit viatique sont alors inversés puisque le voyage ne révèlera aucune vérité sur le lieu : le paradigme épique du voyage devient caduc dans l’océan Indien. Mais la question que se posait le récit viatique, les deux œuvres se la posent toujours : c’est celle de la possibilité d’habiter l’île.