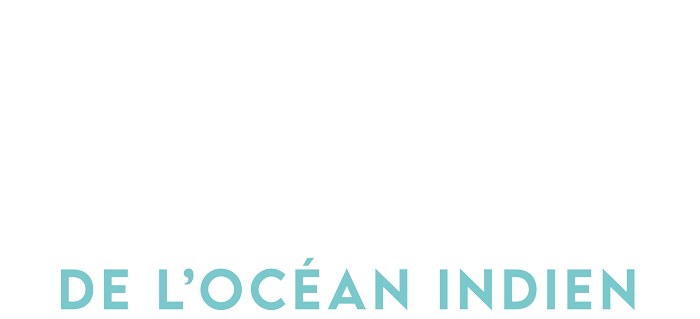« Les images favorites des poètes mélancoliques sont presque toutes empruntées d’objets négatifs, tels que le silence des nuits (…) qui ne sont que l’absence de la lumière, des hommes, et des inquiétudes de la vie »2, écrit Chateaubriand. La vie d’un homme n’est pas faite seulement de son appartenance culturelle : un crépuscule, une nuit, l’obscurité peuvent fonder une mémoire apaisée.
Ainsi de la nuit australe :
Bientôt je vis le jour s’éteindre autour de moi (…) Auprès, tout était silence et repos, hors la chute de quelques feuilles, le passage brusque d’un vent subit (…) La grandeur, l’étonnante mélancolie de ce tableau, ne sauraient s’exprimer dans les langues humaines ; les plus belles nuits en Europe ne peuvent en donner une idée3.
La nuit bourbonnaise illustre-t-elle cette peinture de « l’enchanteur », quelle place occupe-t-elle dans la symbolique de l’esclavage ?
Nocturnité des esclaves… ?
La nuit des tropiques jouit chez les voyageurs d’un incomparable prestige. Héritiers de la pensée chrétienne pour laquelle l’obscurité est bienfaisante par le plaisir d’un repos mérité porteur – depuis les médecins, spiritualistes, philosophes de l’Antiquité – de bon conseil, les visiteurs de Bourbon au XIXe siècle sont frappés par la splendeur de la nuit insulaire : « Si notre bonne étoile nous ménageait une de ces belles nuits tropicales que poètes et voyageurs ont tant de fois chantées »4, quémande Lavollée ; sa sérénité saisit Bory de Saint-Vincent : « Quelles sont belles ces nuits paisibles sur le sommet des hautes montagnes où tout porte déjà un caractère imposant et silencieux que les ténèbres et la lueur des astres rendent encore plus austère ! »5 ; sa paix comble l’abbé Macquet allant « sous l’allée des manguiers, où le bruit de nos pas interrompait seul le silence de ces nuits paisibles du tropique ; tout dormait, les feuilles aux arbres, les oiseaux dans leurs nids, les brins de la fougère »6.
Ce n’est pas avant la Renaissance que cette « contre image » littéraire d’une nuit apaisée, réparatrice, immobile s’édifie peu à peu. Car « toujours, écrit Corinne Bayle, la nuit s’est donnée comme le lieu de l’inquiétude, de l’aveuglement, de la confusion ou des illusions. Elle est apparue comme devant être combattue : la peur du noir trouble la pensée qui s’y noie, submergée par la mélancolie et la terreur du néant »7. Le romantisme, ici aussi, fait évoluer les choses car « le XIXe siècle est une étape essentielle dans l’appréhension de la nuit », et malmené ou vivifié par la modernité, il redonne « une place à tout cet au-delà du visible et du lisible, en proposant un retournement de la nuit en une force, une énergie, travaillant l’homme et le monde, acceptant le risque du rêve et de la folie dans ce renversement »8. Victor Hugo en tire un précepte : « L’homme qui ne médite pas vit dans l’aveuglement, l’homme qui médite vit dans l’obscurité. Nous n’avons que le choix du noir »9. La nuit dès lors devient lisible, nourricière, « intuition d’un certain ordre vital selon lequel l’informe monte progressivement à la lumière »10. C’est en ce sens que l’immense poète Boris Gamaleya écrit que l’esclavage est « le monde de la nuit ».
Mais pour les colons de Bourbon, la nuit reste l’effrayant moment empli de crainte magique et religieuse, la « nuit d’Ancien régime » : « La nuit est périlleuse pour le corps et pour l’âme, elle est l’antichambre de la mort et de l’enfer »11, écrit Jean Delumeau, et pour les habitants, elle est le temps de l’intranquillité. Ouvrant sa page journalière Lescouble évoque invariablement la « mauvaise nuit », la « nuit d’inquiétude », où sévissent la pluie, le tonnerre, le « coup de vent » dévastateur ; moment du récurrent « mal-aise », de la maladie ; de l’incendie ; du complot… Car l’obscurité informe, sans cesse à exorciser, se conjugue avec la force et la colère des esclaves, et la nocturnité suspecte est constitutive de l’expression de leur violence sans langage. La transition du jour à la nuit n’est-elle pas peuplée de leur seule voix : « … Il n’est pas encore huit heures du soir ; le plus profond silence règne bientôt sur toute l’habitation ; il n’est troublé que par le cri des grillons, ou par le chant monotone d’un noir qui s’accompagne du bobre ou du vali »12 ? L’obscurité ne les trouve-t-elle pas toujours éveillés : « Les noirs ne prennent que peu de sommeil : en nous promenant dans leur camp entre dix et onze heures, nous en trouverons encore un grand nombre qui ne sont pas endormis »13 ? C’est alors qu’ils quittent subrepticement le camp pour se répandre à l’extérieur : « Voyez-vous ce noir qui, croyant ne pas être aperçu, enjambe lestement le mur de clôture dont le camp est entouré ? »14.
Les esclaves se seraient donc livrés – selon les maîtres – à un « ajustement temporel »15, adoptant un mode de vie nocturne. Dans ce grouillant « fénoir »16, l’esclave récupère un corps propre, un corps dont on pense qu’il jubile furtivement en hymens cachés générant d’affolantes fécondations, d’angoissantes gestations, jusqu’à celles des complots qui abattront l’ordre établi. Aussi les vols et violences commis de nuit par les esclaves sont-ils plus durement châtiés, et la peur impose-t-elle au gouverneur Dumas d’organiser une patrouille toutes les nuits, et d’arrêter les noirs trouvés dans les chemins (1732)… Cette traque est une tentative de purger la nuit des noirs qui la hantent, s’y dissimulent, s’y fondent. Il n’y a pour les colons qu’une espèce humaine, celle des maîtres, et cette espèce est foncièrement diurne. L’espèce des esclaves logiquement peuple la nuit, propice aux besoins et assouvissements serviles : c’est la nuit que leur hypothétique identité coagule…
En réalité c’est le psychisme fiévreux et tourmenté des maîtres hantés par la nuit où tout peut arriver, qui refoule et emmure les esclaves dans l’obscurité. Dès lors abandonner la nuit aux esclaves, les y confiner, décréter que c’est là qu’ils existent et se réalisent en leurs pauvres vies, est une projection de l’inconscient et de l’imaginaire fébrile des maîtres, un châtiment supplémentaire infligé aux asservis, en aucune façon la revendication de ces derniers, comme le confirme Lacaussade :
Enfant né pour le jour, persécuté par l’ombre
On l’abreuva de fiel et de dégoût sans nombre17.
Les maîtres en effet n’ont pu concevoir et moins encore accepter que c’est au grand jour que les esclaves les ont affrontés et les affrontent ; au grand jour qu’ils ont construit leurs marges de manœuvre. Cette notion aurait fait scandale il y a seulement quelques années. À l’époque où l’on professait que les esclaves étaient totalement déculturés par le système servile qui arrachait d’eux toute trace et toute disposition socialement construite de leur culture antérieure, on ne pouvait penser une seconde que l’esclave possédât la moindre marge de manœuvre. L’envisager apparentait au révisionnisme : c’était le sens de la remarque outrée d’une collègue malgache, descendante par ailleurs de cette noblesse merne qui avait longuement profité de la sujétion des andevo, et en bénéficie encore…
Pourtant, les bases juridiques du système servile dessinaient en creux l’existence de telles marges de manœuvre, car le droit considérait l’esclave noir comme un bien et protégeait l’intérêt de son propriétaire, mais dans le même temps et de manière contradictoire, reconnaissait son humanité et son libre-arbitre, en affirmant que s’il était reconnu coupable d’un crime, il répondrait de ses actes devant la justice pénale des Blancs !
Pour le sens commun, cette expression est en prise directe avec la liberté, et désigne dans une globalité opaque tout ce qui indiquerait que l’esclave aurait la possibilité de se mettre peu ou prou à l’écart, en retrait, du système servile. Cette acception mérite débat, et il est nécessaire d’abord de s’intéresser aux présupposés philosophiques, ainsi qu’à l’épistémologie de la notion.
⁂
Les esclaves, êtres dotés de conscience
Individus sans liberté, sans raison, sans conscience, bref, appréhendés à travers une série de négations ou d’ablations, les esclaves ont été réifiés dans les discours et les représentations des maîtres ; ce n’est pas une raison pour que l’historien leur dénie toute humanité – même au nom d’une hypothétique déculturation, comme on l’a pensé jadis – et les réifie à son tour. En tant qu’êtres humains, les esclaves sont naturellement dotés d’une conscience : elle relève de l’intime et concerne l’individu seul et non la société qui l’entoure. La conscience de l’individu désigne d’abord la conscience que l’individu a de lui-même, et celle qu’il a du monde extérieur, sa perception. La conscience de soi s’éprouve dans l’intimité et la subjectivité. La conscience de l’individu, qui est d’abord sentiment de sa propre existence, est une certitude absolue qui n’est pas procurée par le monde extérieur, mais que tout homme sent et vit en lui, fut-il libre ou esclave. Ce sentiment n’est donc pas le reflet du monde extérieur car il est vécu dans l’intimité de chacun.
Toutefois la conscience de l’individu désigne aussi les représentations construites qu’il se fait de lui-même et du monde. En ce sens, lui est-il possible de faire abstraction de la société qui l’entoure, et dont il est tributaire ? On a pu souligner, dans la représentation que nous avons de nous-mêmes, le rôle de l’autre. Il est celui qui nous perçoit comme un objet extérieur, et pour accéder à une représentation objective de nous-même nous devons passer par son regard. En ce sens Sartre écrit18 que dans tout ce que nous pensons de nous-mêmes, autrui entre en ligne de compte. Aussi a-t-on pu dire que la conscience individuelle n’est que le reflet du regard des autres, d’autant plus que la société dans laquelle on vit désigne aussi la place que l’on doit occuper : singulièrement pour les esclaves…
Par ailleurs, dans L’Idéologie allemande19, Marx et Engels affirment que ce que sont les individus dépend des conditions matérielles, que l’on ne peut se fier à la conscience qu’un individu a de lui-même qui n’est que le reflet de sa vie réelle et matérielle, que la conscience de l’individu n’est donc que le reflet de la société à laquelle il appartient puisque précisément il en subit l’influence en tant que membre ; que par ailleurs les idées de la classe dominante sont les idées dominantes, et donc que la puissance matérielle dominante est aussi la puissance spirituelle dominante. On voit dès lors, selon cette configuration de pensée, quelle était la place assignée à l’esclave et à la conscience qu’il a de lui‑même…
Un marxisme latent et invasif, imposant l’interprétation matérialiste, a été à la fois recyclé et réactualisé dans ses commentaires par la théorie des champs et celle de l’habitus développées par Pierre Bourdieu20 dont les énoncés, qui ont jadis éclairé l’analyse historique, ont malencontreusement produit une vulgate d’interprétation qui se veut transposable à toute l’histoire sociale – cependant aujourd’hui mise en discussion.
D’abord en référence à Kant21, qui distingue la sphère sociale et la société civile universelle, en notant que tout individu – et donc un esclave – est également membre d’une communauté universelle, l’humanité ; que son rapport aux autres ne se réduit pas à son appartenance à une société précise ; que sa conscience morale peut se fonder sur d’autres valeurs que les valeurs particulières propres à sa société, l’individu – ici l’esclave – n’appartenant pas à une seule société ; dans ces conditions, la conscience de l’individu – y compris l’esclave – peut donc échapper à la société particulière à laquelle il appartient.
Ensuite en référence aux travaux du sociologue Bernard Lahire relatifs aux trajectoires particulières qui paraissent contredire la thèse du destin socialement tracé22. L’individu reste capable de se libérer de la société à laquelle il appartient et sa conscience ne peut être réduite à n’en être que le reflet. Sa théorie de « l’action dispositionnaliste et contextualiste » nuance la théorie des champs et de l’habitus de Pierre Bourdieu. Il existe des « forces et contre-forces, internes (dispositionnelles) et externes (contextuelles) (…) qui nous font sentir ce que nous sentons, penser ce que nous pensons et faire ce que nous faisons »23 : cela est valable aussi pour les esclaves. Ces « forces dispositionnelles », ces dispositions, sont des manières de faire, dire et penser d’un individu ; socialement construites, elles sont intériorisées par l’individu à l’issue de processus de socialisation, ce qui invalide l’acception usuelle de « prédispositions innées ». De ce fait l’esclave – nous parlons de lui – n’est pas une terre vierge sur laquelle ne s’est exercée aucune socialisation, ni d’où toute socialisation (antérieure) aurait été effacée par l’asservissement ! Sans aucun doute les esclaves sont-ils des êtres historiquement et socialement contraints notamment par l’ordre social (institutions, traditions, organisations, routines) ; mais ils ont en eux un héritage antérieur, et ont eux aussi une certaine latitude à changer par leur action leur rapport à cette contrainte. Par les actions qu’ils mènent, ils peuvent se (re)placer comme acteurs sociaux dans la société. Ainsi, les esclaves sont-ils des êtres « non totalement déterminés », même s’ils sont assurément des êtres « non totalement et absolument libres comme le postulent les théories d’inspiration néolibérale »24.
Il faut admettre aujourd’hui que les esclaves n’ont pas vécu dans un contexte de déculturation, mais d’interculturalité, même si ces échanges entre cultures – personne ne le soutient – n’ont pas été de même valeur, et même si la créolisation n’a pas produit – qui l’allèguerait maintenant ? – une culture totalement nouvelle, mais au contraire une culture réutilisant ici ou là des éléments antérieurs. Il n’y a pas d’individu autrement que comme individu qui incorpore du social. Bernard Lahire note que « le monde social ne se présente pas seulement aux individus comme des réalités extérieures (collectives et institutionnelles), mais qu’il existe aussi à l’état plié, c’est-à-dire sous forme de dispositions et de compétences incorporées »25 : les esclaves ont donc connu différentes socialisations qui ont pu les façonner. Dès lors, la notion de marge de manœuvre des esclaves réapparaît, en toute légitimité.
⁂
Epistémologie de la « marge de manœuvre »
La science qui a théorisé la notion de « marge de manœuvre » est l’ergonomie : cette étude scientifique des conditions de travail26 peut être appliquée aux esclaves, qui par définition sont dans un premier temps des êtres de travail – la privation de liberté étant le dogme de la recherche d’un labeur le plus efficace et le moins cher possible – même si par la suite cette privation de liberté – connotant un être dès lors proclamé inférieur dans un système humain représenté de manière hiérarchique – a pu devenir l’élément définitoire principal de l’esclave.
Si cette science n’a été fondée comme champ disciplinaire que dans la seconde moitié du XXe siècle, ses préoccupations et réflexions relatives à la santé des humains au travail, au rendement du travail humain et à l’analyse des caractéristiques des situations de travail sont bien plus anciennes, et le vocable lui-même, créé par Wojciech Jastrzebowski en 1857, a été popularisé l’année suivante par Jean-Gustave Courcelle-Seneuil. L’ergonomie est donc contemporaine de l’esclavage, même si elle ne s’en préoccupe pas nommément.
En ergonomie, la marge de manœuvre est le plus souvent associée aux libertés et aux possibilités dont dispose un actif pour accomplir son ouvrage en tenant compte des exigences de production sans nuire à sa santé. C’est l’ensemble de possibilités qui lui sont offertes et qu’il peut s’offrir pour faire face à une situation donnée ; on peut aussi traduire la notion de marge de manœuvre comme l’espace de régulation de la personne en activité, qui varie et se construit selon deux paramètres en interaction, d’une part les caractéristiques de la personne et, d’autre part les exigences des tâches et les moyens offerts par le milieu de travail. Le travailleur possède ainsi un certain contrôle sur son environnement, son activité. Les marges de manœuvre internes sont la gamme des automatismes acquis sur le versant corporel, les marges de manœuvre externes sont l’étendue des instruments d’action construits sur le versant social.
L’empilement de ces définitions qui se recoupent met en évidence trois points : dans le travail, l’opérateur n’est pas strictement ou totalement contraint, il existe des moyens de modification voire d’amélioration des modes opératoires ; ces changements relèvent en partie de l’autonomie de l’opérateur ; ces mutations s’inscrivent dans, sont favorisées par, font sens avec un contexte social général. L’ergonomie s’intéresse au travail « libre » – si tant est que l’on puisse employer ce terme pour le travail à la chaîne des O. S. – et les marges de manœuvre concernent le travailleur, l’ouvrier, libres. Le tout est de savoir si ces marges concernent aussi le labeur servile et l’esclave.
Il est vrai que ce point n’a pas été véritablement étudié – en dehors des travaux que nous avons-nous-mêmes esquissés – et cela s’entend dans la mesure où l’esclave était pensé comme totalement déculturé, ayant, tel une éponge, absorbé tout ce que lui prescrivait le maître en matière de travail. On a pu aussi affirmer que l’esclave aurait tellement incorporé les principes de contrainte qu’il n’aurait pas même pu avoir la distance « réflexive », aimons-nous écrire, pour modifier ses gestes – car au fond, en matière d’esclavage, c’est par ses gestes de travail que l’esclave se manifeste comme esclave.
Le maître en effet a cherché, dans un but de rendement optimum, à faire intégrer des automatismes par l’esclave. Dans la plantation, il fait normaliser le geste pour ménager la plante et atteindre la plus grande efficacité. À l’usine sucrière, la machine primitive n’épargne qu’une partie de l’ouvrage à l’esclave/ouvrier, ne court-circuitant pas les enchaînements humains, mais alors elle intègre le geste, qui doit avoir les mêmes caractères de précision, entre les séquences de la fabrication accomplies mécaniquement : les insuffisances de l’automatisation sont pour un temps résolues en intégrant l’ouvrier/esclave comme rouage de la machine. Le bon geste au bon moment est exigé par la pratique agricole ou technique. Toutefois, si la mesure du geste est précise et sa justesse recherchée, la mesure du temps, la cadence, sont encore peu présentes avant la fin du XIXe siècle, laissant ici aussi une certaine latitude à l’opérateur (ici l’esclave). C’est au milieu de la bande ou de l’atelier que s’exécute le geste de l’esclave, et cet environnement collectif permet des comparaisons et révèle des contrastes jusqu’au moment où il se décante.
Comment les esclaves ont-ils reçu et interprété les gestes imposés ? Nous ne le savons pas. Y a-t-il eu dialogue sur les gestes avec le maître, le régisseur, voire le commandeur ? Nous ne le savons pas. Les esclaves ont-ils réalisé des gestes modifiés ou opposés à ceux prescrits, soit en une sorte de création ou de transgression individuelle, soit surchargés des avis de leurs compagnons ? Nous ne le savons pas.
Mais rien n’indique que ce ne fut pas le cas, pour deux raisons. D’une part, comme l’esclave n’est ni déculturé, ni non plus totalement « acculturé » par le maître, la prescription du geste du maître n’a pas une réalisation absolue, mais a pu – et dû – connaître un/des aménagement(s). Dans ce contexte, la mise en œuvre et l’évolution du geste s’appuient sur des allers retours entre évacuation ou reproduction du geste d’autrui : travail, selon les ergonomes, qui n’est jamais solitaire27. D’autre part, la volonté du maître de faire acquérir par les esclaves des automatismes, n’exclut pas que l’esclave ait conservé une possibilité de choix dans l’exécution du geste. Car selon Henri Wallon : « À tous ses degrés et dans son principe, l’automatisme n’est (…) qu’adaptation. Il n’y a pas une de ses manifestations qui soit possible sans un ajustement de tous les instants aux conditions changeantes et mouvantes du milieu, et à celles de l’action elle-même »28. L’apprentissage des gestes techniques, y compris l’automatisation requise des gestes prescrits, suppose donc une ductilité de l’agir de l’esclave. Est-ce à dire qu’une plasticité psychique est ainsi acquise et/ou acceptée ? Nous ne le savons pas. Quelles sont les raisons de ces adaptations gestuelles : soulager les structures corporelles, marquer une résistance vernaculaire, rechercher un meilleur effet ? Nous ne le savons pas.
Notre ignorance s’explique par le désintérêt d’historiens qui, aveuglés par l’idéologie de la déculturation, n’ont jamais accordé la moindre attention aux gestes du travail – sinon pour souligner à l’envi, mais de manière au fond très conventionnelle, leur caractère répétitif, épuisant, dangereux. Mais nous affirmons que d’un point de vue ergonomique, les esclaves ont possédé une certaine marge de manœuvre. Bien qu’imposée par les maîtres, la gestuelle technique a été adaptée et modifiée par l’esclave. Cette marge de manœuvre se rencontre-t-elle dans d’autres domaines de la vie des esclaves ?
⁂
Marges de manœuvre des esclaves
Les esclaves n’ont pas pu ne pas intérioriser, incorporer sous la forme de dispositions et de compétences l’oppression comportementale et mentale qu’ils connaissent de par leur confrontation aux contraintes extérieures de leur statut d’asservis. Si l’on lit leur action à la lumière des « théories du choix rationnel »29, qui attribuent aux acteurs un comportement rationnel leur faisant viser le plus grand profit ou le moindre mal, il faut aussi reconnaître chez l’esclave une capacité de calcul, de ruse, et un mode de pensée rationnel historiquement déterminés qu’il a pu acquérir, dans un objectif général d’évitement des sanctions. Toutefois mettre en lumière cette dimension active des esclaves/acteurs ne conduit pas sur le terrain d’une liberté individuelle, y compris au sens de liberté par rapport à toute détermination sociale30.
Ceci posé, on admet aujourd’hui que les esclaves, quelles qu’aient pu être les inhumaines contraintes du système servile, ont pu disposer dans leur pratique quotidienne de menus, brefs et discontinus moments pendant lesquels ils pouvaient éloigner si peu que ce soit ces contraintes, et agir selon leur volonté propre. Ces moments, entendons-nous bien, ne préfigurent en aucune façon la construction d’une liberté. Bien au contraire, à notre sens, ils ont sans doute contribué à l’incorporation du système servile par les esclaves, et d’une certaine façon ont freiné son rejet. Mais ils montrent à la fois que les esclaves avaient une volonté d’autonomie, et qu’ils savaient se donner la possibilité de la mettre en œuvre dans les interstices d’un système servile qui ressemble bien plus aux filets – à larges mailles – que l’absolutisme a étendus sur la société, qu’aux carcans que le totalitarisme a naguère imposés aux hommes. C’est du reste ce dont convient Dominique Chathuant : « L’esclave n’est pas un rebelle permanent rêvant à chaque instant de détruire la société coloniale mais un être humain tentant de s’accommoder du cadre qui est son seul horizon. Il n’est pas non plus l’être totalement aliéné et soumis par le système qu’on a souvent décrit »31. C’est ce qu’écrivaient avant lui Joao Pedro Marques, ou encore Gwyn Campbell32.
Bref l’esclave n’est pas dépourvu de tout agir social sous forme de marge de manœuvre. Certaines ont été étudiées par nos collègues : on pense aux marges de manœuvre « héroïques » que sont le marronnage et la révolte. Mais on ne saurait négliger les marges de manœuvre moins violentes et moins spectaculaires, plus banales et triviales, que sont l’usage des outils, la fête et le chant, les pratiques amoureuses, l’humour. Approfondissons ces exemples.
Il n’y a aucun doute qu’à l’occasion d’un marronnage, l’esclave manifeste la conscience et la volonté de s’extraire du système servile. Qu’il s’agisse d’un rejet définitif de l’esclavage au nom de la recherche de la liberté ou de sa restauration, ou d’une mise entre parenthèse temporaire du système – le marronnage permanent suppose en effet un immense courage de la part des esclaves – cette volonté peut être recommencée, en cas de répétition du marronnage : Lescouble33 signale le cas de Marceline, de Louise, parties plusieurs fois marronnes, etc. Quelles qu’en soient les raisons, dans tous les cas le marronnage exprime et met en œuvre une marge de manœuvre des esclaves. D’autant plus que le retour de marronnage, quand il est délibéré, peut donner lieu à négociation et compromis – autre manifestation de cette marge de manœuvre et de son incorporation par l’esclave : « Le Noir de Bruno Favori [Favory] est venu ce soir me dire qu’il était marron et me prier de demander sa grâce. Je lui ai donné un billet pour son maître »34, écrit Lescouble.
Quant aux complots et révoltes, bien que rares à Bourbon, nous avons déjà noté en quoi ils révélaient eux aussi l’existence de marges de manœuvre des esclaves. Nous nous représentons en effet les esclaves révoltés selon un paradigme sartrien, suivant lequel l’acteur est plus que son environnement. C’est là le fonds de l’appréciation que nous portons sur leur résistance et/ou leur soulèvement. Ils ont pu, jugeons-nous, se détacher suffisamment du système, se mettre, eux et l’esclavage, à une distance réflexive leur permettant d’avoir un regard critique et lucide sur leur appartenance à la société servile et sur cette société. Le complot ou la révolte étant des entreprises de plus grande envergure et engageant plus qu’un individu, les esclaves ont alors profité d’une fluidification de la conjoncture (politique, sociale, culturelle) qu’ils avaient préalablement ressentie et comprise. Si bien que, si la question peut se poser pour le marronnage, le complot et la révolte supposent chez les esclaves une conscience politique, comme présence chez eux d’une culture, d’une expérience et d’une maturité politiques – sur l’origine desquelles on pourrait se questionner – impliquant une conscience de la société où l’on vit, de la manière dont le pouvoir y est organisé et exercé et une lecture de cette réalité, autorisant des choix réfléchis.
Parmi les formes de résistance moins violentes, il faut relever l’usage subversif des outils, peu pris en considération dans l’île. Eugene D. Genovese remarque, pour les États-Unis, que les Noirs s’ingénient à taper le plus fort possible avec leurs outils afin de les briser et d’être ainsi au « chômage technique », tant que d’autres instruments ne leur sont pas fournis35. Un tel sabotage s’est aussi produit à Bourbon. On en a la preuve indirecte dans les mentions réitérées de Lescouble : « Godar est venu travailler et m’a fait deux fers de sagailles et commencé à réparer nos pioches, haches, piques » ; « Godar, qui est venu travailler à remettre à neuf nos pioches… » ; « Godar est venu travailler à la forge et a racommodé des pioches et des haches »36, etc. Les réparations successives du forgeron Godard ne s’expliquent pas par une détérioration normale, mais par des actes légitimes de sabotage. L’exemple des camps de concentration, lors de la Deuxième Guerre mondiale, a montré comment des populations, même en situation d’extrême détresse, pouvaient malgré tout saboter l’ouvrage37. Les esclaves travaillent à contrecœur. Un encadrement plus contraignant imposerait au maître de recruter davantage de surveillants qu’il ne peut se permettre d’en engager, sauf à réduire la main-d’œuvre servile et à se priver ainsi d’une production de masse. Le bris d’outil, difficile à surprendre par le maître dans sa réalisation et ses effets, illustre ici encore la mise en œuvre d’une marge de manœuvre par les esclaves.
Au travail les esclaves ont plus encore contesté en freinant les cadences – résistance généralement qualifiée de « paresse »38. Jusque dans les années 1830, contrôlés le matin au départ du camp et le soir au retour, ils sont dans la journée laissés à la seule surveillance du commandeur, courroie de transmission entre le maître et les esclaves. Cela a pu multiplier les abus, mais il n’en reste pas moins qu’une solidarité certaine a existé entre les commandeurs et les esclaves de pioche, dans l’application effective des peines (fouet), et dans la surveillance aux champs : le livre d’ordre de Charles Desbassayns le laisse entendre clairement39. Or à partir des années 1830, les maîtres, confrontés aux exigences du capitalisme en matière de production et de rendement, prennent conscience que le labeur des esclaves est trop peu rentable, car ces derniers ont coutume de se « défiler » autant que le commandeur peut le tolérer. Pour les maîtres, la punition, qui affaiblit la main-d’œuvre ou la retire des champs pour la geôle, n’est pas la solution. Ils choisissent de renforcer les contrôles : désormais, en plus des appels du matin et du soir, c’est plusieurs fois par jour que les esclaves sont soumis à l’appel. Plus moyen de se mettre à l’abri du travail, de se « planquer ». Importés sur l’habitation, ce sont les contrôles stricts des usines d’Europe, les objectifs de rendement, qui envahissent le monde routinier et peu productif de l’esclavage. Une nouvelle stratégie s’impose dès lors aux esclaves : ils recherchent l’interruption temporaire de l’ouvrage, y compris la prison à la suite de provocations. Ils se plaignent d’un surcroît de tâches, associé par eux à la multiplication des appels. Ils avaient su aménager le quotidien de l’esclavage ; avec l’invasion des objectifs de rendement, contraints à intérioriser la culture industrielle, ils transposent leur marge de manœuvre au plan politique : le sucrier Kervéguen qui dénonce leur refus de travail, y voit un exemple de leur « nature révolutionnaire », fustige « la notion de liberté » qu’ils invoquent quand ils affirment que « le travail doit être rémunéré » et leur attente de « voir ce que donnerait la justice »40. La marge de manœuvre des esclaves de Kervéguen par rapport au labeur dénote aussi, il faut en convenir, une bonne connaissance du système juridique, judiciaire et pénal de la société créole et de son fonctionnement. Ces esclaves ont donc su aménager en permanence, et de manière évolutive, le contraignant contexte du travail, sans cependant s’en affranchir.
La fête, le chant, tolérés par les maîtres, témoignent aussi de la marge de manœuvre des esclaves, singulièrement par la mise en œuvre d’un élément qui leur est commun : le rythme. Les esclaves ont eu de secrètes réjouissances, pratiquées après le travail, la nuit tombée, dans les recoins des habitations, et que nous ne connaissons pas. Empoignés par le zamal41 et l’arack, les esclaves comme possédés n’ont pas parlé de leurs fêtes. Nous connaissons celles qu’ils célèbrent avec l’autorisation des maîtres, et dont les maîtres fournissent une grille de lecture et diverses dénominations : « Bal des Noirs », « bal des esclaves », « shéga ou danse des nègres », « danse des Cafres », etc. Ces fêtes autorisées revêtent bien sûr pour les esclaves un sens qui leur est propre. Elles associent le chant, la danse, le jeu, l’art. Reprenons l’exemple de la fête des Noirs à laquelle assiste Marguerite42. Elle voit les esclaves manifester une joie violente, qui dépasse celle qu’aurait provoquée le don de viande et de vin par le maître. La joie de « cette grosse masse noire, qui s’agitait, qui sautait, qui courait (…) les cris, qui ressemblaient à des hurlements »43 lui est incompréhensible. L’obsessionnelle musique percussive que Marguerite ne perçoit pas comme danse/transe, met en évidence ce qui, dans la fête des noirs, dérange le plus les blancs : le rythme. Le rythme – que le maître ne lit que comme métronomie saccadée – permet à l’esclave de mettre de l’organisation dans un monde qu’il perçoit comme instable, impénétrable, imprévisible. Mais surtout la forme immatérielle du rythme dévoile l’être de l’esclave : « La musique fait signe vers le rythme ontologique »44. L’hyperflexion ou hyperextension du cou, la pression sur les globes oculaires, la respiration accélérée, l’usage de zamal à défaut de plantes enthéogènes, l’échauffement collectif enfin, provoquent la transe du « maître de la fête » « un grand Noir, [qui] s’était mis sur la tête une espèce de diadème de plumes et tenait à la main une queue de cheval, qu’il remuait dans tous les sens », et roule de gros yeux « en se dandinant et en montrant ses grandes dents blanches, quand il riait »45. Sans doute faut-il voir dans la transe la relique des rites animistes des Africains pour qui « le rythme est la mélodie secrète des choses et tout chante dans la nature »46, ou des Malgaches déportés par l’esclavage, croyances probablement déjà émoussées à Bourbon, mais qui ont pu se maintenir – et jusqu’à aujourd’hui – dissimulées derrière des masques chrétiens, indiens, etc.
Plus sûrement la transe est pour l’esclave le passeur entre la région des sens et celle de l’être. Elle matérialise un espace entre l’être humain et le monde, la personne et le collectif, le corps matière et l’esprit ou encore l’impossible et l’imaginaire, un espace transitionnel47. « Le phénomène rythmique est à la fois agi et subi. C’est le déplacement du sujet »48. Ces interstices où se produisent de tels phénomènes de déprivations ou surstimulations sensorielles qui font littéralement sortir le transi de lui-même et de son monde, produisent ainsi doublement une marge de manœuvre : chez l’esclave/sujet qui les vit et peut de la sorte s’évader des contraintes de l’oppressive vie quotidienne. Chez le spectateur – l’esclavagiste – qui prend la mesure de l’irréductible altérité de l’esclave, lue comme altérité culturelle – généralement connotée de manière négative – alors qu’elle est aussi – d’abord ? – altérité politique, assignable à son statut de subalterne.
Les habitants et visiteurs, frappés et déroutés par la profusion des chants d’esclaves, ont-ils conscience de l’efficacité du rythme sur l’action ? Les Noirs chantent en permanence : les instruments de musique, rares, parfois même confisqués – notamment les tambours qui font résonner la révolte – et remplacés par les outils, servent à accompagner rythmiquement les chants. Car il ne reste aux esclaves que la voix, les chants rythmés pour communiquer dans les plantations. Des codes sont utilisés, pour que les maîtres blancs n’y saisissent rien :
Navipole navipole ê
Hê hê hê hê ê ê ê ê ê ê49,
tel est, selon Sigoyer qui en prend note, l’incompréhensible début d’un chant entonné par les esclaves malgaches. Ces chants de travail (work song)50 développent un sentiment de familiarité et de confraternité entre les esclaves qui les partagent. Pour alléger une tâche fastidieuse, les noirs de pioche chantent. Pour aider les camarades à synchroniser leurs mouvements dans un travail d’équipe (ramer, scier, écraser les grains dans un mortier avec des pilons, porter le manchy51 sans dévirer la maîtresse), les esclaves chantent. Les gardiens et bergers fredonnent pour traire et apaiser le bétail. Le chant est aussi un signal destiné au voisinage : avertir le marron que le maître survient, localiser les bûcherons dans la forêt, les vachers ou chevriers dans la ravine, identifier les porteurs qui approchent52, indiquer le début ou la fin d’une tâche. Au long de la journée, les divers chants allègent la monotonie du labeur et dissolvent la sensation de vide : « La musique (…) peut (…) arracher magiquement l’homme à lui-même. Les plis et replis du souci s’effacent d’un seul coup », écrit à juste titre Jankélévitch53.
Ces chants, dont les paroles muables peuvent être adaptées par improvisation des chanteurs, sont transmis par tradition orale. Ils évoquent les coutumes et la culture originelle des asservis, leur permettent d’éviter que le fil ténu, fragile, de la mémoire ne soit rompu, exprimant cette présence-absence qui sauve l’origine du néant, de l’oubli définitif et radical. Dans ce repli se manifeste l’identité des esclaves, marge de manœuvre singulièrement indéchiffrable pour les maîtres : être là par le travail et la souffrance, ne pas être là par la mémoire et le chant… Ils connectent entre eux les esclaves, établissant un espace de communication qui contourne et exclut le maître, leur permettant de s’exprimer sans entraves, véritable marge de manœuvre d’ordre quasiment « médiologique ».
L’abolition met un terme à ces manifestations. Sigoyer le remarque et le commente : « Ces chants et ces danses qu’ils aimaient tant, les noirs les dédaignent à présent, parce que s’ils chantaient et dansaient encore, ce serait comme du temps de l’esclavage ! »54. En réalité, déjà désorganisés par les rythmes d’action contraints liés au travail industriel du sucre, bientôt à ceux du monde du salariat, les affranchis perdent graduellement avec l’avènement de la liberté les rythmes ancestraux péniblement préservés. Devenus des citoyens, ils n’ont d’autre choix que de jouer/mimer l’assimilation.
Sur les espaces réels ou symboliques où l’esclave choisit de rivaliser avec le maître ou de s’affronter à lui, s’édifient aussi des marges de manœuvre, lieux de négociations, implicites ou explicites, voire de compromis.
Ainsi des pratiques amoureuses « interethniques »55. Limitons-nous aux deux exemples que donne le docteur Yvan. Il évoque d’abord une jeune esclave devenue la « maîtresse »56 du géreur de l’habitation :
Il m’introduisit dans la maisonnette qui venait d’attirer mes regards. Tout en effet y était propre et rangé (…) une petite alcôve abritée par une moustiquaire renfermait un lit composé d’une natte et d’un pan d’étoffe aux vives couleurs (…) Sur une étagère on avait soigneusement disposé quelques ustensiles de ménage en terre coloriée (…) Cette jolie cabane était habitée par une jeune négresse, laquelle, lorsque nous entrâmes, cousait silencieusement assise devant la fenêtre, chose rare assurément dans une case à nègres. La jeune esclave portait un jupon bleu de toile de coton, et un grand fichu blanc était modestement croisé devant sa poitrine. Notre présence ne parut nullement l’intimider ni l’étonner : elle tourna à peine sur nous son grand œil inintelligent et mélancolique, puis, sans s’occuper davantage de nous, elle continua silencieusement son ouvrage. L’aspect de cet intérieur, dont des habitudes laborieuses semblaient avoir banni la pauvreté, faillit me convaincre des assertions de mon guide créole ; mais je fus promptement détrompé. Cette jeune fille au maintien modeste était l’esclave favorite de l’administrateur de l’habitation ; je venais de voir non les résultats de l’ordre, du travail, mais le prix des faveurs intéressées de cette noire beauté57.
La marge de manœuvre sexuelle de l’esclave révèle aux yeux d’Yvan l’existence d’une délicatesse, d’un goût, d’un sens de l’ordre, d’une compétence dans les travaux définis comme traditionnellement féminins à l’époque (couture), d’un apaisement, entre sérénité et placidité, qui sont généralement déniés aux esclaves. L’échange sexuel débouche ici sur la mise au jour chez l’esclave d’une humanité enfouie, réduisant la distance entre la femme noire, asservie, et la femme libre, blanche. Malgré les prises de position moralisantes certifiant qu’être remarquée par le maître attirait l’inimitié de l’épouse trompée, faisait abandonner les siens en fraternisant avec celui qui les tourmentait58, faisait d’une telle femme une paria, etc., le cas s’est présenté très régulièrement. Quel que soit le degré de violence initial que ces femmes ont eu à subir dans leur liaison, ces relations leur ont permis d’atténuer leurs souffrances59, dans la mise en œuvre d’une marge de manœuvre de séduction.
On aurait tort de la croire spécifiquement féminine, et l’inverse a bien sûr existé – Yvan en témoigne encore – objet d’une réprobation unanime et d’une omerta absolue qui n’interdit pas la rumeur :
Ainsi que chez M. P***, je logeais, avec deux de nos compagnons de voyage, dans un pavillon attenant à l’habitation ; au moment où nous gagnions nos appartements respectifs, un nègre se présenta pour me servir de valet de chambre. Le drôle était jeune et bien découplé ; il portait la simple livrée du pays, un pantalon rayé et une chemise blanche, dont les manches retroussées laissaient apercevoir ses bras robustes. En jetant les yeux sur cet homme, je remarquai, non sans étonnement, qu’il portait au-dessus du poignet un bracelet en cheveux de la nuance la plus claire ; cette blonde tresse produisait un si singulier effet sur ce bras noir et luisant, que j’eus la curiosité de lui demander où il avait trouvé celle galante relique. À cette question indiscrète l’esclave sourit et répondit, d’un air d’orgueilleuse satisfaction, en regardant complaisamment le bracelet orné d’un large fermoir en or : “Je ne l’ai pas trouvé ; on me l’a donné : ce sont des cheveux de ma maîtresse”. Je restai confondu. Il n’existe certainement point de mulâtresse de cette nuance-là : il y a donc des femmes blanches pour lesquelles un nègre est un homme60.
Sans doute dans le domaine littéraire le sujet est-il alors moins tabou qu’on le dit61. Hugo en a fait le sujet de son premier roman, Bug Jargal62, Sophie Doin63 de l’une de ses nouvelles, « Blanche et Noir », Louis Timagène Houat l’évoque en 1844 dans Les Marrons64 et la même année Anaïs Ségalas dans le poème « Un nègre à une blanche »65, Amédée Brun66 enfin dans Deux Amours (1895).
Yvan, toutefois, n’évoque pas une situation littéraire, mais un cas réel comme le père Labat en a rencontré en Martinique :
Quoi qu’il soit plus rare de trouver des femmes blanches débauchées par des Nègres, que des Négresses débauchées par des blancs, cela ne laisse pas d’arriver quelquefois (…) Une fille âgée de dix-sept à dix-huit ans s’amouracha d’un esclave de son père ; et malgré toute la résistance que fit ce pauvre Nègre qui prévoyait les suites de cette action si elle éclatait, elle le pressa si fort qu’il succomba à ses insistances. Elle devint grosse. (…) Je lui dis [au père] d’envoyer le Nègre à Saint Domingue ou à la côte d’Espagne pour le vendre et de faire passer la fille à la Guadeloupe ou à la Grenade sous quelque prétexte, et de l’y faire accoucher le plus secrètement qu’il se pourrait, lui offrant en même temps tout le secours dont il pouvait avoir besoin. Mais la colère où il était contre son Nègre qu’il prétendait faire punir comme ayant suborné la fille, ne lui permit pas de voir la bonté du conseil que je lui donnais ; il alla trouver l’intendant, et y conduisit son Nègre. Mais elle avait trop d’honneur et de conscience pour dire les choses autrement qu’elles s’étaient passées ; elle avoua que c’était elle qui avait sollicité le Nègre, et qu’elle était la seule coupable dans cette affaire67.
Mais là où Labat dénonce le mélange des sangs, le « métissage »68 biologique qui met en péril le statut symbolique, politique et économique du blanc, l’abolitionniste Yvan est médusé par l’émergence et la reconnaissance du désir féminin, qui fait de l’esclave et de la femme asservis des êtres humains ! Ces deux types de cas, difficiles à reconnaître et impossibles à quantifier, indiquent l’existence d’une marge de manœuvre des esclaves dans l’échec du système juridique du Code noir à contrôler les individus.
L’humour manifesté par les esclaves à l’endroit des maîtres est le dernier type de marge de manœuvre que nous voudrions signaler. Il n’y a pas eu pour l’esclavage français en général, ni bourbonnais en particulier, de récolement de contes et d’historiettes humoristiques comparable à celui qui a été fait pour les États-Unis par des folkloristes noirs ou blancs69, et dont une anthologie a été récemment traduite en français70. La réalité servile décrite n’y a rien de compassionnel, le pathos en est absent et l’esclavage n’est pas vu à travers la lorgnette des libéraux et des abolitionnistes qui le plus souvent ont monopolisé le discours. C’est une voix de l’intérieur, différente de celle des censeurs de la servitude qui demeure celle de Blancs extérieurs ; ce sont la voix et les mots des esclaves eux-mêmes. Nous avons cependant quelques traces de cet humour des esclaves des Mascareignes, jamais vraiment gratuit et plutôt corrosif. Il n’est pas rare que le chant servile établisse une connivence humoristique avec/contre le maître : « Notre gibier est triomphalement emporté au chalet par les esclaves ; là, ils chantent et l’adresse des tireurs, et les mérites des pièces abattues », écrit l’abbé Macquet71. Billiard évoque l’esclave malgache qui « se venge sur son maître, et par les tours qu’il lui fait, et par une paresse bien calculée, d’un droit qu’il sait fort bien n’être que la raison du plus fort », ou ces « plaisanteries sur les blancs qui ne paient pas le coup de sec72 avec assez de générosité », ou enfin cette blague des esclaves :
Des noirs empressés de recevoir les voyageurs se jetèrent à la mer jusqu’au cou pour haler et retenir la pirogue dans la barre que les lames formaient au rivage ; s’approchant deux à deux du bord de l’embarcation, ils nous enlevèrent lestement sur leurs épaules en nous faisant accrocher les mains à leurs cheveux crépus ; puis ils nous déposèrent à l’endroit où la lame cessait de courir après nous.
Ils barrent la route aux voyageurs en réclamant trois sous pour un verre de rhum. « Si l’on ne paie pas le coup de sec, et que l’on vienne ensuite se rembarquer, les malins noirs se laisseront envelopper d’une lame pour avoir le plaisir de vous y tremper tout entier »73, ce dont Billiard ne se formalise pas. Lescouble cite ce noir à Hugot qui imite les blancs, et emploie « des expressions si plaisantes pour les y engager qu’il était impossible de voir une scène plus risible. “Naturellement”, “c’est fort bien” et d’autres expressions de ce genre. Il a ensuite chanté des romances et alors il a été impossible d’y tenir »74 (1822). De Rauville rapporte les lazzis que les esclaves du Port-Louis adressent aux soldats anglais qui doivent reculer devant la détermination des officiers de marine français : « Anglé filé, criaient-ils, Anglé filé ! La poude fine tombe dans dilo ! Acote to fisi, mo compère ? Napas enan licien ! [Les Anglais se sauvent ! Les Anglais se sauvent ! Leur poudre est tombée à l’eau ! Où est ton fusil, compère ? Il a perdu son chien !] »75. On citera enfin ce très long « sketch » que narre Sigoyer entre Jean Bitambar, déjà cité, ce « jeune noir domestique du bureau de mon père aux Deux Rives et qui nous était livré corps et âme, sitôt que nous arrivions, ce qui lui convenait fort », Willeum Pajot, ses amis et l’esclave gardien. Bitambar défie son maître : « Quonqu’ vou i perde » lui dit-il « d’un air narquois » ; immobilisé le cul dans le sucre après une blague de potache, il interpelle son maître d’une manière hardie : « O vous, msié ! (…) Ah ! Msié, la lé fou, va ? »76.
Forte – non onirique – résistance à l’égard de maîtres d’abord, du système ensuite, ces sources, peu prises en compte par les historiens, témoignent de l’impertinence, l’insolence, l’ironie, l’humour justement dosés des esclaves qui ont su « jusqu’où on peut aller trop loin »77. Ils en usent comme d’une arme défensive pour supporter leur condition et affirmer leur humanitude face aux maîtres. Contrepoint au stéréotype de l’esclave qui module sa plainte, là par le negro spiritual puis le blues, ici par le maloya, la dérision du maître et de son apparat, l’irrévérence, tout cet ensemble de signes verbaux et comportementaux ont pour objectif de mettre en crise la servitude. Subtiles réparties, elles s’opposent à la privation de la parole et offrent aux esclaves un mot, le dernier.
On pense en règle générale que les marges de manœuvre sont acquises par des relations interindividuelles au sein de collectifs fédérés. Il est plausible au contraire qu’en ce qui concerne les esclaves, les marges de manœuvre sont apparues en situations de contrainte, explicitée ou non. L’asservissement, l’oppression vécue dans le travail, convoquent de nouvelles ressources inimaginées, oubliées, empêchées, condamnées.
La découverte ou la mise en œuvre de ces marges de manœuvre chez l’esclave sont-elles de l’ordre du réflexe, et donc irrationnelles ? Cela semble peu probable. Une autre façon de poser la question consiste à se demander si l’esclave a pu faire des choix qui l’auraient amené à se donner : quoi ?… De quoi manger et boire ? Des parcelles de temps et de liberté ? Un peu d’argent ? L’amélioration de ses conditions de vie voire de sa santé ? Entretenir des relations interpersonnelles moins tendues avec ses congénères ou avec les maîtres ? Bref, faire des choix qui permettraient d’absorber d’éventuels changements sans que son univers de vie s’effondre. Car ces choix amènent l’esclave dans une certaine marginalité par rapport au monde où il vit…
Doit-on en conclure que l’idée de marge de manœuvre s’est d’abord implantée dans l’esprit de l’esclave ? Peut-être vaut-il mieux en effet commencer par la conscience : celle des désavantages à ne pas avoir de marge de manœuvre et celle du « prix à payer » pour en obtenir. Et donc imaginer que les esclaves ont pu avoir une autre vision des choses, une autre « vision du monde » que celle que les acteurs du système et le système leur imposaient…
Cela rappelle que l’esclave est fondamentalement un être humain. Sa déshumanisation, sa réification ont été le fait du discours et des pratiques des maîtres esclavagistes coupables de ce que l’on désigne aujourd’hui à juste titre comme un « crime contre l’humanité ». C’est en effet d’humanité qu’il s’agit et les chercheurs, plutôt que de manifester pour les esclaves une empathie post-moderne de convention, ont bien plus à rechercher l’humanité existante et résistante chez les esclaves. Ils n’ont pas à reprendre à leur compte, pas même comme point de départ, ni même pour les réfuter par le point de vue d’où ils parlent, les positions idéologiques des maîtres. C’est à ce titre que nous avons affirmé que les esclaves disposaient d’une marge de manœuvre – dont nous avons donné quelques exemples – non certes qui leur aurait permis d’échapper à l’asservissement, pas même d’en atténuer l’inhumanité, mais qui les pose comme acteurs, les dote d’un certain « agir social » et montre comment, dans cette adversité absolue, ils ont été capables de mobiliser ce qu’ils conservaient de « l’humaine condition »78.
Il existe au cœur du folklore africain et d’origine africaine, une croyance archaïque qui veut que les forts ne puissent pas toujours faire ce qu’ils veulent : dans ce contexte apparaît le personnage du laissé-pour-compte dont la ruse permet de déjouer le plan de l’oppresseur. C’est Tizan dans la tradition créole réunionnaise. Replacé dans le contexte de l’esclavage, le conte est une allégorie de la résistance à la violence de la servitude. Les opprimés usent d’astuce et de ruse, inventant des techniques de survie dans les mailles et les failles d’un ordre politico-économique qui les écrase et les exclut. Si l’esclave est indiscutablement une victime, il est aussi un résistant, un combattant.