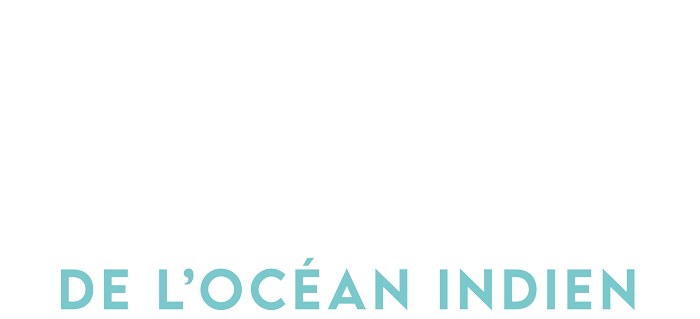Introduction
« De moyen, la mer est devenue objet de conquête »1. Si la mer est avant tout un espace permettant la circulation de marchandises, elle apparaît aujourd’hui également comme un espace foisonnant de ressources biologiques, végétales ou minérales, qui sont autant de sources de richesses et renvoient à un imaginaire de ressources inépuisables, de prospérité et d’équité. Le développement des activités en mer relatives à l’exploitation de ces ressources témoigne néanmoins de cet esprit de « conquête ». Le développement des activités entraîne en effet inévitablement la coexistence de prétentions concurrentes, voire de conflits d’usages.
La question de la coexistence et de l’articulation parfois difficile des droits des États en mer, pouvant aboutir à des conflits d’usages, n’est certes pas nouvelle. Elle avait été envisagée dès l’élaboration de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM)2, et certains articles de la Convention y font référence, comme l’article 87(2) qui précise par exemple que les libertés de la haute mer doivent s’exercer « en tenant compte des droits reconnus par la Convention concernant les activités dans la Zone ». Jean-Pierre Quéneudec, en 1981, publiait ainsi un article dans la Nouvelle revue maritime intitulé « Espaces marins : des usagers antagonistes ».
La notion de conflit d’usages peut être définie comme la rencontre de deux utilisations concurrentes et incompatibles de la mer ou de ses ressources. La concurrence ou l’incompatibilité est à la fois juridique, provenant alors de l’existence de droits ou de devoirs potentiellement concurrents, résultant de normes différentes, et géographique, provenant de l’impossibilité de réaliser les deux utilisations dans un même espace ou dans des espaces adjacents, simultanément voire successivement.
Ces conflits entre activités peuvent notamment se manifester dans un même écosystème qui possède des propriétés attractives à de nombreux égards, comme l’illustre l’exemple des monts sous-marins : ceux-ci abritent des espèces de poissons à forte valeur économique, tout en étant visités par de nombreuses espèces migratrices. Ils abritent des habitats sensibles à certains instruments de pêche, mais aussi des ressources génétiques potentiellement prometteuses scientifiquement ou des ressources minérales. Les activités de conservation s’ajoutent à ces usages divers. La cohabitation verticale ou horizontale, statique ou dynamique entre un grand nombre d’utilisateurs n’est donc pas possible, que ce soit simultanément ou successivement.
Comment le droit de la mer permet-il d’appréhender et de prévenir les conflits d’usages entre utilisateurs concurrents des océans ? Le juge international a jusqu’à présent adopté une approche au cas par cas afin de départager les usages de la mer et éventuellement accorder la priorité à l’un ou l’autre. En effet, il convient de remarquer que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) consacre en particulier l’obligation de « tenir raisonnablement compte » des droits et obligations des autres États. Ces derniers doivent notamment dans ce cadre coopérer dans la mise en œuvre de bonne foi de leurs droits et obligations, et veiller à ne pas commettre d’abus de droit, mais cela reste très vague.
La question des conflits d’usages en mer témoigne bien de la nécessaire confrontation à la réalité de l’imaginaire d’une mer immense aux ressources inépuisables et équitablement réparties, au sein duquel le principe de l’utilisation raisonnable s’avèrerait suffisant pour modérer les comportements et prétentions des États. Ainsi, en prenant l’exemple de l’océan Indien, il s’agira de remarquer que si la grande diversité des situations de conflits d’usages nécessite une approche au cas par cas en matière de prévention et de résolution (I), c’est notamment parce que les moyens imaginés en droit de la mer sont en grande partie insuffisants ou insuffisamment disponibles (II), notamment car ils interviennent dans un contexte géopolitique et de revendications territoriales et souveraines complexe dans l’océan Indien.
Les revendications territoriales et souveraines concurrentes dans l’océan Indien toile de fond de l’analyse des conflits d’usages en mer
Le principal facteur de conflits d’usages en mer, y compris dans l’océan Indien, provient des prétentions d’ordre territorial des États. La notion de conflit territorial est définie par Jean Salmon comme un « conflit entre États relatif à l’appartenance d’un territoire ou à la manière dont ce dernier doit être divisé entre eux par une délimitation frontalière »3, définition qui s’étend au « territoire maritime » de l’État, voire au-delà. Les conflits territoriaux découlent souvent du processus de décolonisation passé ou de l’imprécision des traités de cession de territoires ou de frontières, à l’origine inévitablement de conflits d’usages.
Comme l’explique Jean-Marc Châtaigner, en matière de revendications territoriales dans l’océan Indien, « [l]’exemple le plus connu demeure l’île de Mayotte »4. Cette île, lors de deux référendums en 1974 et 1976, a demandé son maintien dans la République française et est devenue, à la suite d’une nouvelle consultation référendaire en 2009, département français en 2011. Cependant, elle reste revendiquée par l’Union des Comores. Ikililou Dhoinine, Président des Comores entre 2011 et 2016, a ainsi affirmé que la transformation de Mayotte en département et région d’outre mer le 31 mars 2011 était selon lui « nulle et non avenue »5.
D’autres conflits territoriaux liés au processus de décolonisation sont bien connus dans la région, comme celui concernant les Iles Eparses qui ont été rattachées à partir de 1896, pour leur administration, à la colonie française de Madagascar6. L’Assemblée générale des Nations Unies, interpelée par Madagascar, a adopté la Résolution 34/91 du 12 décembre 1979, intitulée Question des îles Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India. Cette résolution endosse les revendications malgaches et invite le gouvernement français à « entamer sans plus tarder des négociations avec le gouvernement malgache, en vue de la réintégration des îles précitées, qui ont été séparées arbitrairement de Madagascar »7. Selon Madagascar, comme cela est rapporté dans la résolution de l’AGNU, il s’agissait d’invoquer le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et la nécessité de respecter l’intégrité nationale et territoriale. Un Comité national pour la restitution des îles Éparses a ensuite été mis en place en 2014 dans cet État. De l’autre côté, Jean Marc Châtaigner, qui défend la position française, soutient que la référence au principe du droit des peuples à disposer d’eux- mêmes s’avère inappropriée si l’on considère que lorsque la France a colonisé Madagascar, ces îles étaient des territoires sans maître. Selon André Oraison, au contraire, un faisceau d’indices démontre que les quatre îlots revendiqués par les gouvernements successifs de Madagascar à partir de 1972 ont bien été des territoires étatiques malgaches et plus précisément des dépendances du Royaume souverain de Madagascar jusqu’à son annexion par la France, le 6 août 1896. Il est évident qu’ils ont été, par la suite, des dépendances administratives de la Grande Ile jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 1er avril 19608.
Pour l’auteur, ainsi, « le différend franco-malgache sur les îles Éparses apparaît essentiellement comme le procès du décret français du 1er avril 1960 », puisque celui-ci a été adopté sans consultation des populations malgaches. Ce décret du 1er avril 1960 plaçait ces territoires sous l’autorité du Ministre de l’Outre-mer, dans un contexte où l’indépendance de Madagascar n’avait cependant pas encore été proclamée puisqu’elle n’est intervenue que le 26 juin 1960. En outre, la loi du 21 avril 20079 prévoit le rattachement des Iles Éparses, classées en réserve naturelle depuis 1975, aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) pour leur administration, leur accordant un statut spécifique au même titre que les îles de Kerguelen. Elles forment ainsi un territoire d’outre-mer doté de la personnalité morale et possédant l’autonomie administrative et financière, bien que demeurant un territoire disputé10.
L’île de Tromelin, qui fait partie du même ensemble est, quant à elle, revendiquée non plus par Madagascar et Maurice mais seulement par Maurice (Madagascar laissant le soin à Maurice de contester la souveraineté française) depuis le 2 avril 197611, date à laquelle le Traité de Paris a organisé la cession par la France au Royaume-Uni de l’île Maurice « et de ses dépendances », sans la mentionner explicitement12. L’île Maurice, indépendante depuis 1968, mentionne Tromelin dans sa constitution comme un « territoire constitutif ». La France et Maurice, qui excluent pour l’instant un règlement juridictionnel de cette situation13, ont choisi de signer un accord bilatéral de cogestion le 7 juin 2010 (bien que le processus de ratification de cet accord soit encore bloqué en France) : l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice sur la cogestion économique, scientifique et environnementale relative à l’île de Tromelin et à ses espaces maritimes environnants2. L’article 2 de cet accord précise que « rien dans [le texte], ni aucun acte en résultant, ne peut être interprété comme un changement de la position française ou mauricienne, sur la question de la souveraineté ou des compétences territoriales et maritimes ». Cette disposition témoigne du fait que le caractère disputé d’un territoire n’empêche pas une action commune pour la gestion de ses ressources (voir infra).
On peut enfin évoquer le différend relatif aux îles Chagos, qui résulte d’un conflit entre le Royaume-Uni et l’île Maurice, Maurice reprochant au Royaume-Uni d’avoir été forcée à céder l’archipel au Royaume-Uni le 8 novembre 1965 lors du processus de découpage territorial dans le cadre de la décolonisation de Maurice, pour devenir le Territoire britannique de l’océan Indien. Le Royaume-Uni avait en effet établi une base de défense commune avec les États-Unis sur l’île de Diego Garcia, la plus grande de l’archipel, entraînant l’expulsion d’environ 2 000 Chagossiens14, ce qui était d’ailleurs l’objet de la demande d’avis consultatif à la CIJ déposée le 23 juin 2017 : Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965 (requête pour avis consultatif).
La Cour internationale de Justice, dans son avis consultatif rendu le 25 février 201915, a rappelé que « l’Assemblée générale s’est toujours employée sans relâche à mettre un terme au colonialisme »16, en particulier depuis l’adoption de la résolution 1514 en 196017. La Cour rappelle également que dans la résolution 2066 du 16 décembre 1965 intitulée Question de l’île Maurice, après avoir noté « avec une profonde inquiétude que toute mesure prise par la Puissance Administrante pour détacher certaines îles du territoire de l’île Maurice afin d’y établir une base militaire constituerait une violation de ladite déclaration et en particulier du paragraphe 6 de celle-ci », elle avait invité « la Puissance Administrante à ne prendre aucune mesure qui démembrerait le territoire de l’île Maurice et violerait son intégrité territoriale »18. Ce rappel évoque de manière sous-jacente mais assez évidente la situation des autres îles de l’océan Indien du sud-ouest mentionnée ci-avant, et pourrait ainsi tout à fait avoir un impact sur la situation des îles Éparses ou encore de Mayotte, bien que l’avis ne concerne évidemment que le cas d’espèce. La Cour établit ici que le processus de décolonisation de Maurice n’a pas été validement mené à bien en 1968, en se déroulant en violation du droit des peuples à l’autodétermination qui constitue pourtant une obligation erga omnes19. Elle conclut que « [d]ès lors, le Royaume-Uni est tenu, dans les plus brefs délais, de mettre fin à son administration de l’archipel des Chagos, ce qui permettra à Maurice d’achever la décolonisation de son territoire dans le respect du droit des peuples à l’autodétermination »20.
Les différents conflits territoriaux et de souveraineté évoqués sont susceptibles d’engendrer d’importants conflits d’usages en mer, puisque chaque État revendique la capacité à exercer les droits et obligations conférés par la CNUDM dans ces espaces, mais aussi dans les espaces que la souveraineté sur les îles permet de contrôler, à savoir la zone économique exclusive lorsque celle-ci a été déclarée, et le plateau continental qui s’étend pour chaque État jusqu’à deux cent milles nautiques des côtes et permet ainsi de contrôler une partie importante du troisième océan mondial.
Une approche au cas par cas qui découle de la grande diversité des situations de conflits d’usages dans l’océan Indien
L’approche au cas par cas en matière de résolution et de prévention des conflits d’usages en mer dans l’océan Indien découle non seulement de l’exercice de droits concurrents et l’expansion des activités humaines en mer, mais aussi de la diversité des acteurs opérant dans la région et des modalités de coordination entre eux.
Diversité des catégories de conflits d’usages en mer liés à l’exercice de droits concurrents et à l’expansion des activités humaines en mer
Dans le même temps, les conflits d’usages peuvent également résulter de situations dans lesquelles il n’existe pas forcément de concurrence en matière de souveraineté sur une zone maritime, mais uniquement une concurrence entre des droits pourtant prévus par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ou tout autre instrument applicable. Ces droits concurrents concernent souvent l’exploitation des ressources, puisque la CNUDM prévoit un régime juridique spécifique à chaque espace et chaque activité en mer, et que ces régimes ne sont en pratique pas toujours compatibles.
Concernant les régimes juridiques relatifs aux activités en mer, des conflits peuvent, par exemple, se manifester dans un même écosystème qui possède des propriétés attractives à de nombreux égards, qu’il s’agisse de zones maritimes sous juridiction ou de zones maritimes internationales, comme l’illustre l’exemple des monts sous-marins évoqué en introduction. En effet, les monts sous-marins21, « points chauds » de biodiversité22, abritent des coraux profonds, des éponges, servent d’habitat à de nombreuses espèces de poissons d’une grande valeur commerciale comme le poisson empereur, tout en étant visités par de nombreuses espèces migratrices. Ces écosystèmes sont fortement menacés par certaines méthodes destructrices comme la pêche au chalut23. La cohabitation entre un trop grand nombre d’utilisateurs, qu’il s’agisse de pêche, d’extraction, d’activités militaires, ou simplement de navigation ou de recherche scientifique, et d’activités de protection de l’environnement, n’est donc pas possible. Comme le note Daniel Owen, « [p]otentially, a difficult decision will need to be made as to which takes priority »24. L’exemple du Banc Walter, mont sous-marin situé dans le sud-ouest de l’océan Indien et dans les eaux internationales, peut utilement être étudié dans ce cadre25.
Concernant les régimes juridiques relatifs aux différentes zones maritimes, ces derniers se chevauchent et peuvent engendrer ainsi des conflits d’usages. Les États sont d’ailleurs en train de procéder à l’extension de leur plateau continental par le biais de la Commission des limites du plateau continental. La France, second territoire maritime au monde, a ainsi étendu son plateau continental de plus de 500 000 km2 en 201526. Cette extension sera à l’origine de nouvelles utilisations de ces espaces, mais il convient de noter que les droits conférés aux États sur leur plateau continental étendu par la CNUDM ne concernent que le sol et le sous-sol : la colonne d’eau surjacente obéit à un régime juridique différent : celui de la ZEE ou celui de la haute mer, selon la distance à la côte. Cette coexistence de régimes juridiques pourrait donc également générer des conflits d’usages27. D’un côté, l’État côtier possède, conformément à l’article 77, « des droits souverains […] aux fins de son exploration et de l’exploitation de ses ressources naturelles ». De l’autre, les autres États ont l’obligation, conformément à l’article 192 de la CNUDM, de « protéger et préserver le milieu marin », et ont la possibilité de recourir, à cette fin, à certains outils comme les aires marines protégées (AMP), soit dans les espaces situés sous leur juridiction, soit dans le cadre de leur coopération au sein des organisations régionales compétentes en la matière. Cette question est au cœur des négociations actuellement en cours au sein des Nations Unies relatives à l’adoption d’un nouvel accord de mise en œuvre de la CNUDM dédié à la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité dans les zones maritimes internationales28. L’une des questions qui se pose est de savoir dans quelle mesure les États peuvent créer une AMP dans une zone située juste au-dessus du plateau continental étendu d’un État, alors que l’exercice de ses droits d’exploitation par ce dernier aura forcément un impact négatif sur la colonne d’eau surjacente et risquerait donc de réduire considérablement les effets positifs liés à la création de la zone.
Les hypothèses de conflits d’usages apparaissent en outre exacerbées par le développement d’activités nouvelles en mer, favorisées par le développement des techniques et technologies. Les utilisations futures ou potentielles de la mer et leur compatibilité avec les droits et devoirs des États dans les espaces maritimes renouvellent ainsi la question des conflits d’usages dans les différentes zones maritimes. Parmi ces « nouvelles » activités on peut citer la question de la production des énergies marines (vagues, courants, vent), amenée à se développer près des côtes mais aussi en haute mer29. L’utilisation de drones à des fins scientifiques ou touristiques, notamment en Antarctique, pose aussi de nouvelles questions, étant donnés les risques que ceux-ci font peser en cas de collisions ou autres accidents sur la sécurité humaine, mais aussi sur la faune et la flore. Une intensification de cette utilisation engendrerait des problématiques quant à la compatibilité avec d’autres activités30. L’Association internationale des tour-opérateurs de l’Antarctique (IAATO) a ainsi adopté un moratoire concernant l’utilisation de ces appareils, dans le cas où leur impact pourrait être « plus que mineur ou transitoire »31. Ces mesures, cependant, ne lient que les opérateurs qui sont membres de ces associations32. S’agissant enfin de l’aquaculture, elle s’étend de plus en plus au large des côtes33.
Diversité des acteurs et parties prenantes, avec de nouvelles formes de coopération
Il convient de préciser que les États demeurent les acteurs privilégiés du droit de la mer, comme c’est traditionnellement le cas en droit international général. En effet, ils sont les destinataires principaux des droits et obligations prévus par la CNUDM34, qui n’évoque qu’indirectement le rôle d’autres personnes juridiques ou acteurs du droit international : les organisations internationales « compétentes » (voir par exemple l’article 61 de la CNUDM), ou encore le capitaine du navire (article 98 CNUDM). Cependant, ce ne sont pas les États qui réalisent concrètement les activités en mer, bien que ces derniers, par le biais de l’immatriculation des navires, participent activement à leur bon déroulé. Les principaux protagonistes, personnes physiques ou morales, sont plutôt les pêcheurs, armateurs, organisations régionales de gestion des pêches, ONG, organisations internationales, entreprises patronnées menant des activités dans la Zone, etc. En effet, dans la mesure où le milieu marin constitue un lieu d’activités répondant à une grande variété d’intérêts, tant publics que privés, dans la mesure par ailleurs où ces activités doivent faire l’objet de règlementations afin d’en permettre le déploiement harmonieux mais aussi d’en limiter les excès, il n’est guère surprenant que cette branche du droit mette aux prises des acteurs divers, qui ne se limitent pas aux acteurs classiques du droit international public35.
En dehors des États donc, un grand nombre d’organisations internationales ou autres institutions publiques sont tout d’abord spécifiquement compétentes dans la région de l’océan Indien et jouent un rôle primordial dans la réglementation et la réalisation des activités, ainsi que dans la centralisation des informations, ce qui pourrait être précieux en matière de prévention et de résolution de conflits d’usages. Le Secrétariat de la Convention de Nairobi pour la protection, la gestion et le développement de l’environnement marin et côtier de l’Afrique de l’Ouest est une organisation de mer régionale mise en place dans le cadre du Programme des Nations Unies pour l’environnement en 1985 ; elle crée un cadre régional de coopération pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières. Les Parties se sont engagées à s’efforcer de prévenir, réduire et maîtriser les pollutions causées par les rejets des navires et par des sources terrestres, établir des zones spécialement protégées, établir une coopération scientifique et technique. Néanmoins, en l’absence de moyens matériels et financiers conséquents, l’action de cette organisation de mer régionale progresse lentement. La Commission de l’océan Indien (COI) créée également dans les années 1980, a quant à elle vocation à faciliter le développement économique, la solidarité entre les îles de la région et la coopération avec les États africains notamment. Elle joue un rôle politique plus important et est très impliquée dans la lutte contre la piraterie, notamment au travers du programme MASE (Maritime Security) qui a permis la création de deux centres, dédiés à la fusion de l’information maritime à Madagascar et à la coordination de l’action des Etats en mer aux Seychelles.
À ce cadre régional s’ajoutent les organisations compétentes pour la gestion des pêches : la Commission pour la conservation des thons de l’océan Indien (CTOI, 1996) et l’Organisation pour la gestion des pêches de l’océan Indien du Sud (SIOFA, 2006). D’autres organisations jouent également un rôle particulier dans la région, comme c’est le cas de la Commission baleinière internationale (CBI), puisque l’océan Indien a été désigné comme un sanctuaire en matière de chasse à la baleine depuis 1979, conformément à l’article V(1)c) de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine et son Annexe, article II(7)a). Les organisations globales telles que l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM), l’Organisation maritime internationale (OMI), voire la Commission océanographique internationale de l’UNESCO sont aussi compétentes et toutes ces compétences spéciales et enchevêtrées sont à la fois la source et la clé en matière de prévention et de résolution des conflits d’usages en mer, même si pour l’instant cette potentialité ne s’exprime principalement qu’au travers de la coopération entre États.
Par ailleurs, certaines organisations hybrides, telle que l’UICN, qui est une organisation à la fois publique et privée, participent activement aux activités de recherche scientifique marine ainsi que de conservation du milieu marin dans la région. Le projet Seamounts est intéressant à cet égard, puisqu’il a permis d’étudier certains de ces écosystèmes singuliers au sud de Madagascar, dans des zones maritimes internationales, au travers de la collaboration entre les différentes parties prenantes de la région, et de constater les effets des activités humaines sur ces milieux en vue d’améliorer leur protection36. Le projet a cependant été volontairement réalisé dans des zones dans lesquelles aucune revendication de souveraineté n’a lieu, afin de ne pas exacerber les conflits existants.
Les personnes privées font également figure de parties prenantes à part entière dans la région et prennent souvent le pas sur les opérateurs publics en matière de protection de l’environnement. Le cas de la Southern Indian Ocean Deepsea Fishers Association (SIODFA) est dans ce cadre emblématique. Sa particularité est d’avoir été fondée en 2006 par quatre entreprises privées pratiquant cette pêche dans la région : l’Austral Fisheries Pty Ltd (Australie), la Bel Ocean II Ltd (Île Maurice), le Sealord Group (Nouvelle Zélande) et la TransNamibia Fishing Pty Ltd (Namibie). Ces entreprises, actives en matière de pêche profonde dans la région, ont décidé de se grouper afin de coordonner leurs activités en vue de promouvoir une pêche durable37. L’association, afin de prendre en compte les menaces à la biodiversité (surpêche d’espèces ayant un cycle de reproduction très lent, prises accessoires…), a décidé de fermer certaines zones à la pêche profonde, par une déclaration unilatérale38. L’UICN relève cependant que :
[w]hen SIODFA members were asked to identify their strengths and weaknesses, they replied that their biggest positive attribute was directing world attention to the problems surrounding high seas fishing in the Indian Ocean, where States have been unable to implement formal international arrangements. […] The biggest weakness of SIODFA is said to be its inability to control the operations of others who might choose to fish in the same area without any controls39.
Les opérateurs privés interviennent par ailleurs activement dans le cadre d’autres activités relatives à la conservation. Il s’agit de la désignation et de la gestion des AMP par certaines ONG, qui sont souvent qualifiée de Charitable trusts, ou fondations caritatives (comme par exemple The Nature Conservation ou Pew Charitable Trusts), dont les intérêts et objectifs privilégiés ne sont pas toujours, malgré les apparences, les objectifs attendus40. Ainsi, le projet de création d’une aire marine protégée autour des îles Chagos était au départ défendu par l’ONG Greenpeace41. Comme le dénonce Nathalie Ros, des collusions existent ainsi parfois entre ces ONG ou fondations, et d’importants lobbies, certaines organisations étant par exemple tributaires des industries minières. Les ONG concernées plaident en général pour la création d’AMP « no-take », c’est-à-dire de véritables réserves naturelles non ouvertes aux activités de pêche, mais n’excluant pas forcément la réalisation de toutes les activités en mer. C’est le cas des Seychelles, où l’ONG The Nature Conservancy autorise les activités minières dans l’AMP « no-take » désignée. En outre, comme le dénonce encore Nathalie Ros, ces organisations ne s’arrêtent pas à la réalisation d’activités de désignation et de gestion d’AMP, mais vont parfois beaucoup plus loin. L’action de The Nature Conservancy aux Seychelles s’inscrit en effet dans une véritable logique de « financiarisation des services écosystémique », avec la création, dans le cadre d’une politique d’« économie bleue », d’un système d’échange de dette dit « debt swaps », visant à permettre à l’État le rachat d’une partie de sa dette publique grâce à des fonds publics et privés, en échange de la réalisation d’activités liées à la conservation et à la lutte contre les effets des changements climatiques42. Indépendamment des conflits d’intérêts engendrés, cette logique apparaît donc particulièrement propice à l’émergence de conflits d’usages.
Le panorama des différents acteurs présents sur la scène maritime dans la région de l’océan Indien témoigne bien, finalement, de la diversité des facteurs potentiels de conflits d’usages, mais aussi de la diversité de modalités de coopération et d’actions conjointes en mer pour la protection de l’environnement et la réalisation d’autres activités, ainsi que la diversité de parties prenantes pouvant intervenir dans leur prévention et leur résolution le cas échéant.
Une tentative inachevée de systématisation en vue de favoriser la prévention et la résolution des conflits d’usages en mer
La CNUDM, surnommée la « Constitution des océans », fixe le cadre général de l’exercice des activités en mer. Cependant, en ce qui concerne la prévention et la résolution des conflits d’usages, les règles élaborées dans ce cadre s’avèrent insuffisantes, bien qu’elles pourraient servir de base à l’adoption d’outils plus pertinents en la matière.
Le caractère souple et lacunaire des principes existants, favorisant l’approche au cas par cas
Le standard du comportement « raisonnable » ou « justifiable » consacré dans la CNUDM. La CNUDM présente un champ lexical relativement riche concernant les standards de comportement que doivent adopter les États dans l’exercice de leurs droits et obligations en mer, selon les zones maritimes : « tenir raisonnablement compte », « tenir dûment compte », ne pas « affecter », ne pas « porter atteinte », ni « gêner l’exercice de manière injustifiable », ou encore « s’abstenir de toute ingérence injustifiable ». Ces termes très proches mais distincts sont utilisés à différentes reprises dans la Convention, en particulier au sein des dispositions qui prennent en compte, justement, la coexistence entre zones maritimes et activités des États. Il est significatif de noter que le terme « raisonnable » apparaît quarante-huit fois dans la Convention et ses annexes, même si ces occurrences ne concernent pas toutes le comportement des États mais aussi des questions de délai, etc.
Ces standards de comportement traduisent le principe international traditionnel de l’utilisation « raisonnable » de la mer. La notion d’interaction raisonnable entre zones maritimes est d’ailleurs confortée par l’article 300 de la Convention, qui renvoie à la bonne foi et l’abus de droit, notions fortement liées au principe du raisonnable puisqu’elles limitent le pouvoir discrétionnaire de l’État de manière générale43. Ces éléments montrent bien que les conséquences préjudiciables de l’exercice de leurs droits par les États sont tolérées, dès lors qu’elles ne sont pas considérées comme abusives, et que la notion de raisonnable nécessite donc une appréciation a contrario.
L’interprétation des standards de comportement raisonnable ou justifiable, à première vue laconiques, montre que des règles plus précises peuvent être, dans une certaine mesure, utilisées en cas de conflit d’usage dans une même zone maritime ou entre des zones distinctes. Ces « tests » et « méthodes » identifiés sont autant d’outils d’interprétation pour le juge44. Cependant, selon Jean-Pierre Cot, si la polysémie du terme raisonnable permet, certes, d’identifier ses différentes fonctions « sociales »45 et de favoriser son utilisation par le juge qui doit « gérer tensions et contradictions au mieux de ses moyens limités »46, ces standards laissent toujours une importante marge d’appréciation aux États47 et autres utilisateurs de la mer, qui peut alors être source d’incertitude. Ces concepts, en outre, traduisent un compromis, ou une absence de consensus lors de la création de la règle. Celle-ci sera donc vraisemblablement interprétée de manière variable par les États. Comme le remarque Erietta Scalieris, on peut ainsi s’interroger sur la « pertinence et la suffisance de ce critère au regard des diverses situations de conflits nés de compétences concurrentes »48. Ces standards, en effet, ne permettent pas de résoudre toute situation où l’exercice des droits par les différents États dans une zone maritime pourrait générer des conflits d’usages.
L’approche au cas par cas induite par cette interprétation n’apparaît donc pas suffisante. Comme l’évoque également Marine They, les standards de comportement de la CNUDM permettraient plutôt, au contraire, d’identifier des « zones de neutralité juridique », dans lesquelles « l’analyse des règles fait apparaître avec certitude qu’il n’y a aucune certitude »49. Ces standards auraient alors simplement un rôle transitoire, et appellent le développement de règles subséquentes, en vue d’apporter plus de prévisibilité à la règle de droit. Les conflits d’usages en mer font partie de ces « zones de neutralité juridique », qui appellent l’élaboration de normes plus précises permettant, par exemple, de déterminer des règles de priorité ou encore des seuils au-delà desquels toute interférence doit être proscrite.
L’utilisation de ces standards par le juge international. L’affaire récente de l’arbitrage concernant l’AMP des îles Chagos (Royaume-Uni c. Île Maurice) portait notamment sur la contestation de l’établissement d’une AMP par le Royaume-Uni autour de l’archipel disputé des Chagos50, posant la question de savoir si celle-ci avait été instrumentalisée pour asseoir la souveraineté de l’État51. Comme l’affirme Sarah Cassella, le Tribunal arbitral a, dans cette affaire, « maritimisé » un différend portant sur la souveraineté territoriale, en insistant sur l’un de ses aspects a priori pourtant « secondaire »52. Le Tribunal n’a en effet accepté de se prononcer que sur l’une des parties du différend, excluant sa compétence pour trancher le litige relatif à la souveraineté territoriale, cet aspect étant l’objet de l’avis consultatif rendu par la CIJ le 25 février 2019 (voir supra). Le rattachement du différend à la CNUDM a été justifié par le fait que le 1er avril 2010, le Royaume-Uni avait établi une AMP qui rendait impossible un « éventuel retour des Chagossiens dans les îles, et compromettait la mise en œuvre des engagements assumés à l’égard de Maurice »53, notamment par le fait que la réserve marine empêchait toute activité de pêche dans l’archipel. Maurice demandait ainsi au Tribunal de déclarer que le Royaume-Uni, en établissant l’AMP autour de l’île, avait violé différentes dispositions de la CNUDM (y compris l’article 300 susmentionné), ne respectant pas les droits de l’État dans la zone concernée54, y compris les droits de pêche55.
Le Tribunal arbitral a décidé que la proclamation de l’AMP des Chagos par le Royaume-Uni, dans une zone dont la souveraineté est contestée, était juridiquement nulle. Concernant les droits de Maurice en vertu des Engagements de 1965 dans la zone contestée et en particulier ses droits de pêche, le Royaume-Uni n’a ainsi pas « tenu dûment compte des droits et des obligations des autres États » dans l’exercice de ses droits dans sa ZEE (conformément à l’article 56(2) de la CNUDM), et aurait dû s’abstenir, dans l’adoption de mesures relatives à la protection de l’environnement, « de toute ingérence injustifiable dans les activités menées par d’autres États qui exercent leurs droits » (article 194(4) sur les mesures visant à prévenir la pollution du milieu marin), notamment en adoptant cette mesure de protection conjointement (article 194(1)). Le Royaume-Uni n’avait pas suffisamment coopéré avec l’Île Maurice lorsqu’il a réalisé cette désignation, alors que son comportement vis-à-vis des États-Unis, à propos de la base militaire sur l’île de Diego Garcia était irréprochable. Pour autant, le tribunal arbitral a insisté sur le fait que c’était bien la manière dont l’AMP avait été désignée, sans consultation de l’État intéressé, et non son bien-fondé en tant que mesure de conservation qui a été remise en cause. Cet exemple témoigne tout de même de la portée pratique des dispositions certes générales et lacunaires de la CNUDM, contribuant potentiellement à la résolution des conflits d’usages en mer.
Les dispositions spécifiques aux zones dans lesquelles il existe des prétentions concurrentes sur le plateau continental ou la ZEE. La CNUDM contient, par ailleurs, des dispositions spécifiques aux zones maritimes disputées, mais uniquement lorsque le conflit d’usage concerne des zones dans lesquelles des États se disputent les limites d’une ZEE ou du plateau continental. Il s’agit des articles 74 et 83. Ces articles précisent la méthode à appliquer par les États dans le cas où ces derniers ne seraient pas parvenus à se mettre d’accord sur la délimitation : ces derniers doivent tout d’abord faire « tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique » et, toujours dans un « esprit de compréhension et de coopération », « ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de l’accord définitif » (articles 74(3) et 83(3)), notamment en ne causant pas de dommage permanent ou « irréparable ».
Cette méthodologie relative à la coopération des États concurrents dans un espace maritime constitue en fait, elle aussi, en plus d’un instrument renforçant la coopération entre eux, un outil permettant au juge, de manière ici encore casuistique, de déterminer si les États ont agi de bonne foi et n’ont pas abusé de leurs droits. Comme le rappelle Youri Van Logchem, l’obligation de ne pas compromettre ou entraver la conclusion d’un accord est une limite importante quant à la marge de manœuvre des États dans les zones maritimes disputées56. En effet, les conséquences de la réalisation concrète d’activités dans de tels espaces sont encore plus importantes qu’en matière de conflits d’usages « classiques ». Dans l’océan Indien peu d’accords provisoires ont pour l’instant été conclus57, mais on peut évoquer à cette occasion l’accord de cogestion entre la France et l’île Maurice concernant les îles Tromelin, qui constitue un exemple intéressant de coopération en l’absence de résolution du conflit de souveraineté entre les États58. Néanmoins, l’originalité de cet accord, à savoir la cogestion économique, scientifique et environnementale, sans aucune influence sur le conflit de souveraineté, est précisément la cause de sa non ratification, à l’heure actuelle, par l’Assemblée nationale française59. L’accord est qualifié de « pragmatique » par Patrick Chaumette60. En effet, celui-ci règlemente les activités en matière de pêche, fouilles archéologique et préservation de l’environnement (article 3), mais la cogestion n’est pas étendue aux activités de surveillance et de contrôle de la pêche, car ces activités ont une importante dimension régalienne (les articles 4 à 9 sont relatifs aux modalités pratiques de la cogestion, en conformité avec la CNUDM). Par ailleurs, il est bien précisé qu’aucune activité, ou aucun acte de la part de ces États dans le cadre de l’application de l’accord ne pourra constituer une base pour affirmer, ou contester les revendications souveraines des parties (article 2). Trois conventions d’application sont annexées à l’accord : l’une porte sur la recherche archéologique, l’autre sur l’environnement, et la troisième sur la cogestion des ressources halieutiques61.
La difficile mise en œuvre et l’instrumentalisation potentielle des autres outils disponibles et adaptables en vue d’une prévention et d’une résolution plus effective des conflits d’usages en mer
La contribution potentielle des études d’impact environnemental à la résolution des conflits d’usage en mer. Si la réalisation d’études d’impact est considérée comme une obligation coutumière en droit international62, celle-ci est généralement formulée en des termes si généraux qu’elle n’est effectivement mise en œuvre par les États que lorsqu’elle est explicitement prévue par un accord63. Un renforcement de l’obligation de réaliser de telles études, obligation prévue par ailleurs à l’article 206 de la CNUDM et à l’article 15 de la Convention sur la diversité biologique, avec des critères précis et unifiés concernant la réalisation des activités en mer, prenant en compte les conflits d’usages potentiels, constituerait ainsi un véritable fondement permettant la conciliation, et un exercice réellement « responsable », de ses activités par l’État côtier.
À travers les données collectées dans le cadre des évaluations de l’impact environnemental des activités, en effet, de tels conflits pourraient être anticipés et réglés en amont, que ce soit par la négociation ou par l’établissement d’une commission de conciliation. L’élaboration des études d’impact environnemental ou social devrait pour ce faire comporter de manière généralisée non seulement une description de l’activité envisagée, mais aussi des projets alternatifs, et leurs impacts potentiels sur l’environnement64, ce qui permettrait, à la suite d’une mise en balance des différents intérêts en jeu conformément au « test du raisonnable », de dégager un compromis tant dans l’espace que dans le temps, permettant de concilier les activités en question. Dans le cas d’un conflit avéré ou imminent, c’est alors sur la base de ces études d’impact que les États seraient évalués et pourraient se voir départagés, et auraient la possibilité de prévenir tout différend.
Le contenu de cette obligation de réaliser des études d’impact environnemental est d’ailleurs actuellement discuté au sein de la Conférence intergouvernementale chargée de négocier un nouvel accord sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité au-delà des limites de la juridiction nationale (« BBNJ »). Elle fait partie comme les AMP du « package deal » identifié par les États depuis 2011 et servant de base à la négociation65. Cependant, ce sont les modalités de réalisation et les exigences relatives à la réalisation de telles études qui permettront d’évaluer leur capacité à remplir ce rôle. La réalisation de telles études d’impact supposerait, pour jouer un rôle en matière de conflits d’usages, de prendre en compte l’impact cumulé des différentes activités ayant lieu potentiellement et actuellement dans une zone, ce qui serait particulièrement utile en matière de conciliation des usages en mer.
Les activités de pêche ou de protection de l’environnement étant centralisées auprès des organisations régionales compétentes en la matière, ces propositions apparaissent réalisables. Les libertés de navigation, de pose de câbles, et de recherche scientifique, ne passent pas par ces organisations régionales, mais elles pourraient relativement aisément être anticipées. Par ailleurs, les activités d’exploration ou exploitation des ressources minérales font par principe l’objet d’une publicité, notamment lorsqu’elles ont lieu sur le plateau continental. Une telle publicité permettrait par là même aux membres de l’organisation régionale d’agir également en fonction des activités prévues par l’État. Les organisations régionales compétentes pourraient ainsi jouer un rôle déterminant dans la coordination et la conciliation entre les droits et obligations des États dans les zones maritimes en question.
Les difficultés et tensions géopolitiques liées à l’utilisation de cet outil. Les études d’impact environnemental sont néanmoins utilisées actuellement dans un contexte géopolitique très particulier et pourraient se voir ainsi instrumentalisées, inadaptées ou encore ineffectives. De manière très générale, il existe dans l’océan Indien une importante pression et une concurrence certaine entre grandes puissances et en particulier entre les États-Unis, l’Inde, mais aussi la Chine, pour renforcer leur présence et occuper cet espace stratégique. En effet, « la prédominance des États-Unis fut, pendant des décennies, un gage de stabilité » dans la zone, mais « l’incertitude s’installe peu à peu »66, la présence de l’Inde et de la Chine s’affirmant de plus en plus. Ainsi, comme le constate Thomas Marrier d’Unienville dans son article « L’océan Indien, nouveau centre du monde ? »67, « si régner sur l’océan Indien est l’objectif de tous, la Chine est le pays qui s’en approche le plus ». La présence chinoise est stratégiquement développée au travers de la mise en place de projets de plateformes pétrolières offshores, notamment dans des zones sous souveraineté ou juridiction comorienne. En effet, il convient de rappeler que le troisième océan mondial abrite « plus de la moitié des réserves mondiales en hydrocarbures et en uranium, plus de trois quarts des ressources en diamants, ainsi que presque la moitié des réserves d’or et de gaz »68. En outre, la Chine s’est imposée, par sa présence dans le détroit de Malacca et le golfe d’Aden, comme un acteur clé en matière de lutte contre la piraterie dans la région.
Face à cet investissement de la Chine dans l’océan Indien, l’Inde tente de maintenir sa présence dans la région, notamment militairement. L’installation de bases militaires indiennes par le biais d’accords conclus non seulement avec Maurice, autorisant l’installation d’une base militaire et de facilités aéroportuaires sur l’île d’Agaléga, mais aussi avec les Seychelles, concernant une base militaire sur l’île Assomption, illustre parfaitement cette tendance à la militarisation et l’occupation stratégique de l’océan Indien, facteur potentiel également de conflits d’usage. Concernant la première, sur l’île d’Agaléga, il convient de noter que la construction d’une base militaire suscite de vives craintes de la population de se retrouver dans le cas chagossien69. Alors que l’île Maurice demande dans le même temps la restitution par le Royaume-Uni de l’archipel des Chagos, le débat perdure concernant l’accord classé secret d’État avec l’Inde sur le sort de l’archipel des Agaléga. Particulièrement éloigné des côtes, à la lisière nord de la ZEE Mauricienne, l’archipel devait officiellement faire l’objet d’investissements en matière d’écotourisme. Il se trouve en fait au centre d’une véritable « guerre froide » que se livrent les Indiens et Chinois dans l’océan Indien70. Au-delà du manque de transparence dénoncé des autorités, l’impact environnemental de ce projet est au cœur des considérations de la population71.
De même, concernant la seconde installation de base militaire, c’est en mars 2018 que l’armée indienne a négocié et conclu un accord similaire pour une durée de vingt ans avec les Seychelles. La coopération entre l’Inde et les Seychelles, en place depuis de nombreuses années en matière de surveillance des espaces maritimes et de lutte contre la piraterie ou le trafic illicite, alimente ainsi une situation de dépendance contestée par la population locale72. Des préoccupations environnementales se mêlent ici directement aux intérêts stratégiques et militaires, puisque l’île est, entre autres, un site de nidification des tortues. L’île voisine d’Aldabra, patrimoine mondial de l’UNESCO, attire de nombreux scientifiques qui passent par l’île d’Assomption pour se rendre sur la petite île voisine. D’un côté, une base militaire permettrait de faciliter la surveillance des activités humaines dans cet espace (argument que partage notamment la Seychelles Islands Foundation, en charge de la protection du patrimoine mondial depuis 1979). D’un autre côté, une telle présence stratégique engendre également des risques dans cet espace. Des études d’impact environnemental auraient permis de conclure que la région était « idéale pour ce projet »73 ce qui témoigne du fait que ces outils, en théorie prometteurs, peuvent être utilisés à des fins diverses et parfois stratégiques.
La planification spatiale maritime comme autre outil disponible et prometteur de gestion de l’espace. Par ailleurs, la planification spatiale marine a été imaginée en vue de favoriser la préservation de l’environnement ainsi que le développement de certaines activités comme les énergies marines renouvelables, qui sont une source importante de conflits d’usages près des côtes74. Elle a été définie par l’UNESCO comme un « processus public d’analyse et d’affectation spatiale et temporelle des activités humaines dans les espaces maritimes en vue d’atteindre des objectifs écologiques, économiques et sociaux qui ont été généralement spécifiés au travers de processus politiques »75. Il s’agit d’un outil de gestion par zones, impliquant une approche intégrée, qui s’inscrit également dans le cadre plus général de l’approche écosystémique. Elle nécessite, dans une logique d’acteurs, la prise en compte de l’ensemble des parties prenantes susceptibles d’être affectées par la planification des activités maritimes. Pour Jérémy Drisch, la planification des espaces maritimes est un :
moyen pratique pour créer et établir une gestion plus rationnelle des espaces marins et des interactions entre les usages, de concilier les demandes pour le développement d’activités avec le besoin de protéger l’environnement et de délivrer des résultats sociaux et économique de manière ouverte et planifiée76.
Cet outil de gestion des espaces est notamment utilisé et prôné dans le cadre de l’Union européenne, comme en atteste la directive cadre 2014/89/UE du 23 juillet 2014, établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime (DCPEM)77. Les questions liées au développement d’activités en mer et aux conflits d’usages susceptibles d’en résulter peuvent aussi, dans la même optique, être étudiées du point de vue du droit interne et de la planification des côtes et des espaces maritimes. Plus l’on s’approche des côtes, espace pour lequel la notion de planification spatiale maritime a été créée, plus l’on se rend compte du fait que l’interface terre-mer et particulièrement poreuse et qu’il est difficile d’exclure du champ de l’étude les activités littorales. La notion de gestion intégrée des zones côtières (GIZC), qui se généralise au sein de différentes régions78, permet d’appréhender en partie ces questions79. La pollution tellurique représentant environ 80 % de la pollution totale des océans selon certaines estimations, les interactions avec les usages littoraux doivent nécessairement faire partie intégrante de toute réflexion consacrée à la prévention et la résolution des conflits d’usages en mer.
Du conflit d’usages au « zones multi-usages ». Un dernier outil qu’il semble intéressant de mentionner concerne la conciliation des différents usages entre eux dans une logique encore plus poussée de combinaison bénéfique de différentes activités, ce qui est à l’heure actuelle plus prospectif. Bela Buck et Richard Langan proposent ainsi de combiner physiquement des activités d’aquaculture avec le développement des parcs éoliens80. Ces activités fixes sont en effet potentiellement plus aisément superposables simultanément dans un même espace que des activités dynamiques telles que la pêche ou la navigation, et ne sont à première vue pas compatibles avec des activités de conservation de la biodiversité, bien qu’il ne soit pas encore démontré que les espèces concernées par l’aquaculture ne soient pas dérangées par le fonctionnement des éoliennes.
S’il convient de préciser que la directive européenne n’est pas applicable dans les régions ultrapériphériques françaises, ce qui ne les empêche pas de s’y référer volontairement, le droit de l’UE apportant à cet égard une influence non négligeable en la matière81. Avec le temps, les documents métropolitains et ultramarins devraient ainsi se ressembler sur le volet planification. En outre, une telle référence peut être lue au travers du prisme d’une volonté croissante d’affirmation de l’Union européenne dans l’océan Indien, en tant que « modèle de puissance ou puissance modèle » comme le questionnent Didier Blanc et Julie Dupont-Lassale82, au travers de la présence française (dont un quart de la ZEE se trouve dans l’océan Indien) et anglaise assurées à La Réunion, à Mayotte ainsi que dans l’archipel des Chagos (bien que cette dernière situation soit amenée à évoluer rapidement en conséquence de l’avis consultatif rendu le 25 février dernier par la CIJ). Cette affirmation de la puissance européenne pourrait néanmoins faire contrepoids avec la montée en puissance d’autres États dont l’Inde, la Chine ou faire concurrence à la présence des États-Unis (supra).
En conclusion, des options existent en droit international pour compléter l’appréhension actuelle et inéluctable au cas par cas de ces situations : outre la nécessaire coopération entre États, des études d’impact environnemental ou social poussées, traduisant la hiérarchisation que la valeur particulière de protection de l’environnement implique nécessairement aujourd’hui, ainsi que la mise en place d’une planification rationnelle de l’espace maritime pourraient contribuer à une meilleure anticipation et gestion de ces conflits.