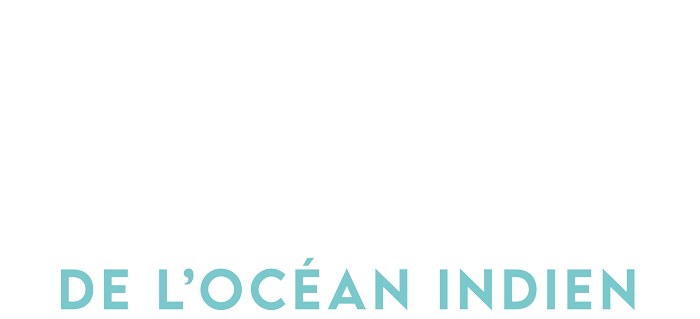Introduction
Le 31 mars 2011, Mayotte devenait le 101e département français. Un nouveau département au triple record : le plus jeune1, le plus pauvre et le plus inégalitaire au plan national. En 2011, 84 % de la population mahoraise vit en-dessous du seuil de pauvreté national. Vivant avec moins de 87 euros par mois, les ménages les plus modestes (appartenant au premier décile) ont alors des revenus 14,1 fois inférieurs à ceux des individus les plus aisés, contre un rapport égal à 3,7 en métropole2. Si ce type de données n’a pas été actualisé depuis, on sait que le PIB par habitant demeure 3,5 fois plus faible à Mayotte qu’au niveau national, tandis que les transferts sociaux sont, quant à eux, environ cinq fois plus faibles. Malgré les avantages juridiques que cette transformation statutaire apporte aux femmes notamment3, les promesses attachées à la départementalisation en termes de développement économique et d’égalité nationale restent, pour l’heure, en suspens. La mise aux normes françaises de la société locale profite d’abord aux populations en mesure d’occuper les nouveaux emplois qualifiés, en l’occurrence des métropolitains et une fraction diplômée de la population mahoraise4. Pour les autres, massivement peu diplômés, pourvus ou non de la nationalité française, les logiques de survie s’organisent autour du maintien d’une économie agraire d’autosubsistance, de l’économie informelle, de la petite délinquance (essentiellement juvénile), des solidarités privées et des quelques revenus de transfert mis récemment en place dans l’île5.
Les femmes sont particulièrement affectées par le chômage, l’inactivité et la pauvreté qui en résulte. Leur taux de chômage, au sens du recensement de la population, est près de deux fois plus élevé que celui des hommes (47,2 % contre 28 % en 2012)6 et elles représentent près des trois-quarts des allocataires du revenu de solidarité active (RSA). En 2018, le taux d’emploi des femmes est de 25 %, contre 41 % pour les hommes. Si ces quelques données semblent objectiver une pauvreté féminine et des inégalités sexuées, il n’en demeure pas moins que ces indicateurs sont très euro-centrés. En ce sens, ils ne permettent pas ou prou de mesurer les circuits de redistribution économique traditionnellement observés à Mayotte et les logiques honorifiques qui les sous-tendent, la femme (épouse, sœur, mère) étant normalement prise en charge par un homme (mari, frère, fils) selon des régimes d’obligations et de réciprocités socialement institués7. Les transferts privés observés à l’échelle des lignages échappent en partie à la statistique publique et aux catégories administratives et fiscales de l’État dont l’unité de mesure reste le ménage.
Les transformations rapides et brutales que connaît la société mahoraise depuis plus de dix ans posent la question de la reconfiguration des régimes publics et privés de solidarité. C’est précisément à cette reconfiguration que nous avons consacré nos travaux de recherche au cours des deux dernières années. En nous appuyant sur un corpus de données portant sur le recours et le non-recours au RSA8, cet article entend éclairer les formes de régulation contemporaines de la pauvreté féminine. Nous présentons, dans un premier temps, quelques données relatives à la difficile montée en charge du RSA et à la surreprésentation des femmes parmi les allocataires ; données à partir desquelles se dessine le cadre problématique de notre recherche. Nous analysons, dans un second temps, les deux figures dominantes de la pauvreté féminine que sont, d’un côté, la pauvreté prise en charge par l’action publique et, de l’autre, la pauvreté contenue et régulée dans le cercle privé9. Ces deux figures renvoient à la définition simmelienne selon laquelle la pauvreté ne peut être approchée que dans une perspective relationnelle et non substantialiste10. Il n’y a pas de pauvreté en soi, mais seulement une réaction sociale de la part de la société et/ou de la communauté. Ce faisant, nous analysons plus avant l’articulation entre ces deux figures et la dynamique des rapports sociaux de genre et de solidarité. Si le recours aux transferts sociaux est à la fois une conséquence de rapports de genre inégalitaires et le support d’une transfiguration des rapports de dépendance économique, la pauvreté prise en charge selon le régime d’obligations privées souligne, pour sa part, le maintien d’une organisation sexuée des principes d’attribution et de redistribution des ressources.
Le RSA à Mayotte : un recours féminisé et une difficile montée en charge
Introduit à Mayotte au 1er janvier 2012, le RSA constitue le premier et le seul minimum social appliqué à ce jour dans l’île. Compte tenu du niveau de pauvreté, de chômage et de sous-emploi, ce dispositif a suscité beaucoup d’espoir dans la population. Il faut savoir, sur ce point, que le RSA a été présenté comme la vitrine de l’Égalité sociale lors du vote pour la départementalisation. De fait, de nombreux ménages pensaient pouvoir disposer de cette allocation, sans en connaître réellement les critères d’éligibilité et les conditions administratives. L’engouement pour ce minimum social aura été de courte durée. Ainsi, on a enregistré quasiment autant de demandes en janvier 2012 (6 457) que sur les onze mois suivants (6 673). Un an après le début de sa mise en œuvre, le nombre d’allocataires était environ cinq fois plus faible que ce que les autorités avaient estimé. Fin 2012, seuls 2 586 allocataires étaient enregistrés par la Caf (contre 13 000 à 18 000 allocataires attendus), soit 9 223 bénéficiaires, soit encore 4,3 % de la population couverte par cette nouvelle prestation11. Une faible couverture qui a d’abord été expliquée par la minoration de son montant : 25 % du montant national pour l’année 2012, revalorisé à 37,5 % pour l’année 2013 et à 50 % depuis le 1er janvier 2014. Malgré cette revalorisation, le nombre d’allocataires est encore bien en-deçà des effectifs escomptés. Outre les difficultés d’accès au RSA, on note également des discontinuités dans le maintien du droit : un cinquième des allocataires sort du dispositif tous les trimestres du fait du non-envoi de la déclaration trimestrielle des ressources. Ainsi, alors que le nombre d’allocataires augmentait de manière régulière depuis janvier 2012 (4 300 allocataires fin mars 2014 ; 6 365 fin juin 2016), il a connu une baisse sensible avec un peu plus de 4 800 allocataires inscrits au premier trimestre 2019. Une baisse qui interroge d’autant plus que la population recensée à Mayotte a augmenté, pour sa part, de 21 % entre 2012 et 2017.
Outre le faible recours au droit, on note que la mise en place du RSA à Mayotte a attiré une population majoritairement féminine : en 2012, trois allocataires sur quatre étaient des femmes. L’observation de ces deux propriétés – un faible recours et un recours féminisé – pose ainsi la question des tensions et des ajustements opérés aujourd’hui entre les logiques exogènes et endogènes de la régulation sociale. Ainsi, en dehors des facteurs liés à la complexité des procédures publiques pour faire valoir un droit12, le non-recours est-il l’expression du maintien de solidarités privées exercées à l’échelle du lignage ? Que nous dit le non-recours des représentations indigènes de la citoyenneté sociale (droits et devoirs, solidarité publique, périmètre du lien social, etc.), de la pauvreté et des conditions de vie observées à Mayotte ? Quel est, a contrario, le degré de pénétration des transferts sociaux dans les économies familiales contemporaines ? Quel rôle jouent les femmes dans ces transformations de régimes de solidarité ? Dans quelle mesure le recours aux revenus assistanciels est-il le témoin et le support d’une renégociation des rapports sociaux de sexe adossée aux nouvelles règles juridiques d’égalité hommes‑femmes ?
La pauvreté régulée par l’action publique : reproduction des rapports de genre et transfiguration des rapports de dépendance
Dans un article traitant de la pauvreté au prisme du genre, Hélène Périvier rappelle combien :
les inégalités professionnelles et domestiques (périodes d’inactivité professionnelle et/ou de moindre investissement en termes de temps de travail, de postes recherchés ou obtenus…) se cristallisent au moment des séparations. Coûteuse, la désunion pèse en moyenne davantage sur les femmes que sur les hommes13.
Mayotte ne fait pas exception à cette règle : la trajectoire conjugale détermine pour une bonne part la pauvreté féminine. Ainsi, la grande majorité des femmes allocataires du RSA que nous avons rencontrées et interviewées étaient « séparées » au moment de l’enquête, donnée qui corrobore les statistiques administratives selon lesquelles 68 % des allocataires étaient des femmes en 2018, dont les deux-tiers étaient seules avec un ou des enfants.
Les récits de vie recueillis auprès de ces femmes témoignent de la césure que représente la désunion dans l’économie familiale. Tant qu’elles étaient mariées14 – et davantage encore si leur époux occupait un emploi salarié – les revenus du ménage permettaient de subvenir aux besoins de la famille. Une fois le couple séparé, les femmes se retrouvent doublement exposées à des difficultés économiques : elles bénéficient trop rarement d’une pension (légale ou informelle) de la part de leur ex-mari, tandis que les charges attachées aux enfants leur reviennent en grande partie. Ceci est une caractéristique des sociétés matrilinéaires : les hommes favorisent la famille du lignage à celle issue de l’alliance matrimoniale. Ils circulent de maisonnée en maisonnée, tandis que les femmes sont attachées au foyer matrifocal et à la cellule qu’elles composent avec leurs enfants. Ce principe de distribution des rôles sociaux de sexe dans la prise en charge des enfants, s’il n’était déjà pas parfait pour les générations précédentes15, révèle un peu plus aujourd’hui les inégalités de genre face aux obligations familiales. Avec la « vie chère »16 et les nouveaux standards de consommation dont les enfants et les adolescents sont aussi les premiers promoteurs, la prise en charge de la famille est de plus en plus coûteuse, et les quelques aides reçues de la part des pères sont rarement à la hauteur des besoins. À l’unanimité, les femmes déplorent le caractère aléatoire et discontinu de l’aide apportée par le père du ou des enfants. Si certaines d’entre elles, appuyées en cela par le travail social, s’engagent dans une démarche auprès du juge des affaires familiales pour réclamer une pension alimentaire17, la majorité de celles que nous avons interviewées s’en remet à l’ordre coutumier attaché à l’organisation de la famille matrifocale18.
Les monographies réalisées auprès des femmes allocataires du RSA dévoilent ainsi toute la construction sociale de leur situation de dépendance économique vis-à-vis des hommes. La majeure partie d’entre elles, en effet, n’a pas été scolarisée ou alors sur des niveaux très bas, correspondant aux classes du primaire, au mieux du collège19. Elles restent ainsi enfermées dans un ordre social et conjugal traditionnel selon lequel une jeune fille non ou faiblement scolarisée doit chercher son salut dans le mariage et, dans ce cadre, dans une relation de dépendance économique vis-à-vis d’un homme. Une certaine pression sociale et familiale s’exerce aussi en ce sens, l’enjeu pour les familles pauvres étant de « placer » leurs filles dans un nouveau ménage pris en charge par le mari. Une fois mariées, une autre pression s’exerce sur elles : celle d’avoir un ou plusieurs enfants. À Mayotte, le mariage entre un homme et une femme n’est réellement validé que lorsqu’il donne lieu à une naissance. Dans le cas contraire, la famille du mari peut se réunir et discuter de l’opportunité ou non de rester dans ce mariage si celui-ci n’apporte aucune descendance. De fait, la dimension honorifique attachée au statut du mariage et à la procréation a manifestement un coût économique supérieur pour les femmes qui ont à supporter la charge familiale quel que soit le niveau de participation du père des enfants. Les trajectoires biographiques des femmes allocataires du RSA illustrent tout à fait ces règles sociales et conjugales : qu’elles soient ou non séparées aujourd’hui, elles ont le plus souvent contracté plusieurs mariages (dont certains avec un mari polygame) et, dans l’ensemble, chaque mariage a donné lieu à une ou plusieurs naissances. Cette propriété sociale peut avoir deux effets. Pour celles qui ont encore des enfants à charge et qui sont séparées, elle représente, de fait, un facteur d’appauvrissement qui appelle à la mobilisation d’autres ressources. Les prestations sociales et familiales et les emplois aidés20 remplissent cette fonction économique. À l’inverse, les mères de famille dont les enfants sont aujourd’hui adultes peuvent espérer, dans le meilleur des cas, un soutien financier de leur part. La figure de l’enfant adulte demeure en effet la plus opérante sur le plan des solidarités familiales, suivie de celle du frère. Les autres membres de la parentèle sont plus rarement sollicités ou seulement pour des occasions ponctuelles et dont le caractère d’obligation demeure très fort. C’est le cas, en particulier, pour le financement des réceptions villageoises liées au grand mariage, à la circoncision et aux enterrements.
Pour autant, on note ici ou là des signes de fragilisation de cet ordre coutumier et d’une économie formalisée à l’échelle du lignage. Quand, en effet, les apparentés attendus dans leur fonction d’entraide sont eux-mêmes en situation de précarité, à Mayotte ou en métropole, les logiques de soutien deviennent plus difficiles à honorer. Le registre argumentatif des enfants adultes est parfois sans équivoque et témoigne des situations partagées de pauvreté dans la famille : « je suis moi-même en galère ici, elle touche le RSA là-bas, je ne peux pas lui donner ce que j’ai pas » témoigne ainsi le fils d’une allocataire, âgé de 32 ans, vivant en France métropolitaine où il alterne, depuis une dizaine d’années, entre contrats précaires, assurance chômage et revenus sociaux. Précarisation et individualisation vont ici de pair et informent d’un nouvel ethos de survie individué. Le chômage, la « vie chère », l’obligation pour les jeunes adultes de migrer dans d’autres départements en vue de leur propre survie, sont autant de réalités nouvelles qui sont présentées comme un obstacle au maintien des solidarités. De fait, le recours aux aides publiques (RSA, allocations familiales et allocation de rentrée scolaire essentiellement) et, le cas échéant, aux quelques emplois aidés offerts ponctuellement par les communes et le département est pensé et justifié par les intéressées comme un moyen essentiel d’émancipation féminine et d’autonomisation économique vis-à-vis des (ex)conjoints d’abord, des enfants et des frères ensuite.
Rapportées à leur trajectoire biographique, les prestations se substituent ainsi aux revenus du mari ayant quitté le foyer conjugal, et dispensent les femmes de se mettre immédiatement en quête d’un nouveau mari afin de subvenir à leurs besoins. Cette garantie de ressources contraste avec les revenus discontinus liés aux changements (courants) de situation matrimoniale et à l’irrégularité des aides reçues de la part de leur conjoint. Elle est donc plutôt bien perçue par ses bénéficiaires qui en appellent cependant à davantage de droits pour faire face à l’accroissement des besoins sociaux et du coût de la vie. Si le recours au droit permet de s’affranchir des relations de dépendance inscrites dans le mariage coutumier, il demeure inscrit dans un ordre social continué dès lors qu’il est pensé et légitimé depuis leur place de mère de famille à qui, dans les faits, revient la charge des enfants une fois que le père a quitté le foyer et, bien souvent, ses obligations familiales par la même occasion. En confortant ainsi leur statut de mère nourricière via le recours au droit, ces femmes continuent d’occuper une position sociale gratifiante. Une « assignation à résidence » qui reste un moindre mal car si les rapports de genre sont mis à distance dans l’espace domestique, ils continuent d’opérer et de se combiner aux rapports de classe sur le marché du travail, qui plus est pour ces femmes non ou faiblement scolarisées, et dont les rares expériences professionnelles se cantonnent aux emplois aidés et aux activités non déclarées (ménages, gardes d’enfants, ventes sur le marché, etc.). Selon une approche intersectionnelle, la famille – et plus précisément ici le statut de mère de famille – constitue ainsi une structure refuge et intégrée21 : si l’émancipation féminine est portée par une volonté d’autonomisation économique face aux hommes, elle n’est pas présentée comme devant remettre en cause la place et la fonction de la femme/mère au sein du foyer. Celles-ci ne sont pas décrites comme des positions aliénantes, bien au contraire.
En marge de l’État. Les formes de régulation endogènes de la pauvreté féminine
Vous savez, ici, à Mayotte, culturellement, un salaire c’est pour cinq ou six personnes. Il n’y a pas moi, ma femme et mes enfants, comme dans le modèle occidental. Il y a ma mère, mes tantes, mes oncles, tous ceux qui ne travaillent pas, et qui comptent sur l’enfant qui a fait des études, qu’il arrose un peu toute la famille. Moi, tous les mois, je fais des courses pour ma mère ou je lui donne de l’argent. On est trois frères dans la famille, on fait tous la même chose (fonctionnaire territorial, né à Mayotte, 37 ans).
Traditionnellement, la société mahoraise est régie par un ensemble d’obligations privées qui ont comme double fonction la prise en charge matérielle de l’ensemble des apparentés et la réaffirmation des liens qui les unissent et qui concourent ainsi à présenter l’image d’un groupe intégré. La famille élargie22 demeure le lieu d’exercice privilégié de ces solidarités. Celles-ci sont très codifiées. Elles informent des comportements attendus des uns et des autres en fonction de leurs positions dans les cycles de vie. « À Mayotte, on a coutume de dire qu’“avant de se marier, il faut d’abord avoir marié sa mère” » (Barthès, op. cit., p. 37), c’est-à-dire avoir fait la preuve que l’on est en mesure de prendre en charge une famille. Les relations d’obligations, dont une bonne part sont sexuées, se déclinent ainsi sur plusieurs axes de parenté : la mère assure l’entretien et l’éducation de ses enfants, le père survient à leurs besoins et projette l’apport d’une maison en dot pour le mariage de sa fille, le fils adulte participe à la prise en charge de sa mère, le frère célibataire soutient financièrement sa sœur, le neveu vient en aide à ses oncles et tantes dans le besoin, etc.
Du fait du développement économique observé aujourd’hui à Mayotte et des inégalités d’accès à la condition salariale, les comportements attendus sont également fonction de la position socioprofessionnelle des uns et des autres. Si la réussite individuelle est désormais promue de par l’adhésion des familles aux enjeux de la scolarisation, celle-ci doit être socialement investie au profit de la famille, du village, de sa confrérie (twarika), etc.
La réussite sociale ne découle donc pas directement de la réussite économique mais de l’habileté à l’employer pour élargir son réseau d’influence. L’accumulation de richesses n’est pas appréhendée comme une fin en soi qui satisferait les intérêts privés, mais essentiellement parce qu’elle concourt à établir des liens entre les personnes (ibid., p. 31).
Comme toute règle sociale, l’obligation de solidarité demeure très fonctionnelle à Mayotte du fait de la prégnance des formes de contrôle et de sanctions sociales afférentes23. Prendre de la distance avec ce régime d’obligations, c’est aussi prendre le risque d’une « mise à mort sociale », d’une moindre intégration dans son groupe.
L’enquête « Migrations, famille et vieillissement » conduite par l’INED nous informe ainsi de la vitalité des solidarités familiales à Mayotte24. On y apprend, par exemple, que l’entraide financière régulière y est deux fois plus importante que dans les autres DOM. Les données détaillées de l’enquête dévoilent à la fois les difficultés économiques vécues par un grand nombre de ménages et les logiques de redistribution monétaires et non monétaires opérées à l’échelle de la famille. Alors que la moitié des adultes âgés de 18 à 79 ans déclarent avoir des difficultés à boucler leurs fins de mois, 56 % des personnes interrogées disent aider régulièrement des proches, et 34 % le font sous la forme d’une aide financière. Dans 75 % des cas, l’aide est destinée aux parents, et plus particulièrement à la mère de famille (60 %). Ces différentes formes de redistribution interviennent dans un contexte marqué par de forts taux de chômage et d’inactivité ainsi qu’un faible niveau de protection sociale. Elles assurent, de fait, une fonction de régulation sociale et de mutualisation des risques que l’État n’a pas encore totalement organisée localement.
Les données que nous avons recueillies confirment largement ces pratiques d’entraide monétaires et non monétaires : elles sont déclarées à la fois par les pauvres qui reçoivent, et par les apparentés qui donnent. Si l’entraide familiale est d’abord une valeur sociale et symbolique de premier plan à Mayotte, dans les milieux paupérisés que nous avons côtoyés, elle est aussi et surtout une nécessité économique. Compte tenu de la faiblesse du montant des prestations sociales et familiales25 sinon de la difficulté, pour un grand nombre de ménages, de recourir à ces droits, peu de familles pauvres parviennent à tenir leur budget sur la seule base des revenus sociaux. L’étude des économies familiales dévoile au contraire la démultiplication des transferts privés et les règles d’échanges formalisées à l’échelle du lignage. Ainsi, il est très courant pour les enfants d’assumer une part des charges mensuelles de leurs parents, et de leur mère en premier lieu : les différents membres de la fratrie s’organisent, en fonction de leur propres revenus et charges familiales, pour régler les factures et autres abonnements, pour déposer chaque semaine un sac de courses ou des ressources vivrières s’ils disposent eux-mêmes d’un champ. Pour d’autres – et c’est particulièrement vrai des enfants résidant en France métropolitaine ou à La Réunion – l’aide est strictement financière et est formalisée par un versement mensuel ou trimestriel s’il s’agit d’une aide régulière, un versement ponctuel si l’aide est soumise à la demande expresse du parent. Ces logiques de transferts monétaires reposent également sur la reconduction de formes de tontine mensuelle (shikoa) à la fois à Mayotte et dans les autres départements français. Composées pour l’essentiel de femmes, ces tontines constituent un support important des entraides réalisées sur un axe à la fois collatéral (entre sœurs et cousines) et ascendant (aide apportée à la mère en particulier). Quand leur tour est venu de recevoir l’argent collectivement épargné, ces femmes peuvent ainsi destiner une part de leurs ressources au financement d’une maison, d’un événement familial ou tout simplement pour faire face aux dépenses courantes de la famille.
Sur le plan des aides non monétaires, on observe en premier lieu des formes d’échanges autour de l’usage du foncier agricole. Les femmes trop âgées pour le cultiver délèguent ce travail à leurs enfants ou à leurs collatéraux (et en priorité à ceux qui n’ont pas d’emploi), les ressources étant ensuite partagées entre les différentes parties de l’échange26. Ce travail peut aussi être délégué à un étranger qui conserve ainsi une part des récoltes pour ses propres besoins et qui en redistribue une autre part au propriétaire. Il s’agit moins ici d’entraide que de rapports économiques, mais l’enjeu demeure la survie des uns et des autres : ceux qui possèdent la terre et ceux qui ne possèdent que leur force de travail.
Une autre forme d’entraide essentielle s’observe autour de l’habitat et des formes d’hébergement. Au recensement de 2017, 15 % des ménages mahorais étaient logés à titre gratuit, contre 2 % en France métropolitaine27. Les règles qui fondent les pratiques d’hébergement suivent, elles aussi, les étapes du cycle de vie. Ainsi, une jeune femme non mariée a de grandes probabilités d’habiter dans le foyer matrifocal occupé par sa mère. Les premiers salaires perçus sont destinés à faire vivre ce ménage selon une logique de partage des responsabilités : la mère fournit la maison, l’enfant en assure la charge. Quand elle se marie, la fille en principe part occuper la maison fournie par son père où elle y accueille son époux ou ses époux successifs. Dans un certain nombre de cas – et notamment parmi les ménages pauvres qui n’ont pas les moyens de construire une maison pour chaque fille – la maison fournie en dot est celle qui était déjà occupée. Dans ce cas, la mère sera accueillie par un autre de ses enfants ou de ses collatéraux. Lorsque ces obligations ont été prévues suffisamment à l’avance, la mère ira plutôt occuper la maison que ses enfants lui auront construite, conformément aux attentes socialement définies sur ce point.
La construction de l’habitat figure parmi les signes les plus saillants de la réussite sociale et du prestige que l’on peut en tirer. Construire une maison, pour sa mère et/ou sa fille, c’est honorer ses obligations familiales. Peu importe, d’ailleurs, le temps que l’on mettra à finaliser cette construction. C’est l’acte qui prime, le signe envoyé à la communauté villageoise. Car si la construction de l’habitat répond à la nécessité de loger les siens, elle vient signifier plus largement le lien indéfectible au village natal. Y construire une maison, c’est mettre en acte son statut de Munyeji, de « propriétaire et natif du village ». « Mguéni mkirini » dit le dicton local : « les étrangers dorment à la mosquée ». A contrario, un natif du village doit y avoir sa maison, qu’il l’occupe lui-même ou qu’il la mette à disposition d’un apparenté. La forte migration des Mahorais observée ces vingt dernières années n’a pas altéré cette obligation, bien au contraire. Construire un habitat dans son village natal permet d’y signifier sa présence matérielle et symbolique, son attachement. Ceux et celles qui ne parviennent pas à honorer cette obligation n’auront d’ailleurs jamais l’idée de revenir s’installer à Mayotte28. On leur reprocherait, à coup sûr, d’être partis vivre en France métropolitaine ou à La Réunion pour leur seul profit, sans retour pour le village. Ces attentes, ici, contraignent ainsi très souvent les économies familiales, là-bas. Des Mahorais, vivant dans des cités HLM des grandes villes métropolitaines ou de La Réunion, « se serrent la ceinture » au jour le jour pour s’acquitter de leurs obligations dans leur village natal.
Dotée d’une forte fonction symbolique, la construction de l’habitat au profit des mères et des filles participe, de fait, de la régulation de la pauvreté féminine. À Mayotte, moins d’un ménage sur trois est locataire de son logement (contre 40 % en métropole), ménages occupés en majorité par des étrangers et des Français « expatriés » (Thibault, Art. cit.). Les natifs de Mayotte se déclarent plus souvent propriétaires ou hébergés. Il faut également savoir, sur ce point, que rares sont les constructions qui font l’objet d’un acte notarié. Qu’il s’agisse des villages de brousse ou des communes urbaines, les habitats sont généralement érigés sur le terrain ou le bâti (construction d’un étage supplémentaire)29 déjà occupés par la famille qui ne dispose pas pour cela de titre de propriété30. Pour autant, s’agissant des populations les plus pauvres, l’habitat occupé est souvent de faible confort, sinon insalubre. Le statut de propriétaire, s’il permet de faire des économies de loyer, n’enlève en rien le caractère précaire des modes de vies observés. Par ailleurs, le fait d’occuper un terrain non-titré ne permet pas d’être éligible aux aides à la pierre proposées par le Conseil départemental, tandis que les aides destinées à soutenir financièrement les ménages (Fonds social logement et Fonds d’aide sociale urgence logement) aboutissent rarement dans les faits. Les référents uniques du RSA enregistrent ainsi de nombreuses demandes en ce sens de la part des allocataires, mais observent que c’est encore du cercle privé que le salut arrive le plus souvent : les enfants cotisent pour assurer les travaux d’habitat. À ce titre, le rythme soutenu de la construction de l’habitat à Mayotte semble être un indice de l’importance des transferts monétaires à l’échelle des lignages, transferts par ailleurs très difficiles à mesurer. Dans un contexte où les politiques sociales du logement peinent à se déployer31, les modalités de répartition des ressources économiques et symboliques ne se réduisent pas, ici, à l’action publique32 mais puisent, au contraire, dans des réseaux familiaux qui s’étendent de Mayotte aux autres départements français. En cela, avec 26 % des natifs âgés de 18 à 79 ans qui vivaient hors Mayotte en 2016 (Marie et al., Art. cit.), le 101e département se présente pour partie comme les pays du Sud qui régulent leur pauvreté par les transferts envoyés par la diaspora33.
Les différents exemples présentés ici montrent ainsi dans quelle mesure les transferts privés répondent à deux objectifs simultanés : celui de contenir les situations de pauvreté dans le groupe familial d’abord, celui de satisfaire au régime d’obligations ensuite. Le premier est de nature économique, le second de nature symbolique, rattaché à un ensemble de prescriptions sociales et religieuses. En qualité de troisième pilier de l’Islam, la zakât, cette aumône destinée aux miséreux, est une pratique respectée à Mayotte. Tout musulman doit en calculer le montant en fonction de ses propres moyens et s’en acquitter chaque année. S’agissant plus précisément de la culture mahoraise, les aides matérielles ont également une portée parfois plus symbolique qu’économique. En venant en aide à ses parents, l’enfant adulte vient s’acquitter de la dette qu’il aura tout au long de sa vie à leur égard (Blanchy, op. cit.). Il obtiendra ainsi leur bénédiction, leur assentiment (rhadi). Dans le cas contraire, l’enfant peut être banni du groupe familial, ce qui représente évidemment une sanction très lourde que d’aucuns ne souhaitent vivre. Ainsi, les transferts monétaires entre enfants et parents ne sont pas conditionnés par la seule nécessité économique des seconds. Ils s’observent également dans des milieux sociaux plus aisés.
L’enchâssement de l’économie symbolique et de l’économie attachée au salariat produit manifestement des effets dans la régulation sociale de la pauvreté en général, et de la pauvreté féminine en particulier. À l’échelle d’une famille élargie, ceux et celles qui disposent d’un emploi salarié sont en effet amenés à redistribuer une part de leurs ressources, à soutenir financièrement un apparenté, de manière régulière ou ponctuelle. Selon l’enquête « Migrations, famille et vieillissement », 46 % des hommes âgés de 24 à 64 ans reversent une partie de leurs revenus au reste de la famille. Cette part augmente pour ceux qui sont en emploi, avec 55 % des hommes et 48 % des femmes (Marie et al., Art. cit.). Parmi les ménages allocataires du RSA, beaucoup témoignent de transferts reçus de la part d’un ou de plusieurs apparentés « qui ont un travail », c’est-à-dire un emploi salarié. Les discours recueillis selon lesquels, à Mayotte, « culturellement, un salaire c’est pour cinq ou six personnes »34, prennent tout leur sens dès lors que l’on observe les économies des ménages paupérisés. Le qualificatif de « famille-providence » utilisé par Claudine Attias-Donfut et Nicole Lapierre pour décrire l’institution familiale en Guadeloupe35 s’avère particulièrement approprié pour Mayotte. En marge d’un État qui n’a pas encore les qualités providentielles qu’on lui prête à tort ou à raison36, les familles mahoraises assurent en quelque sorte, et à leur échelle, le principe de redistribution assis sur les régimes assuranciel et assistanciel de la protection sociale. On note, sur ce point, que les différences de salaires perçus par les uns et les autres conditionnent très justement les pratiques d’entraides. Par exemple, les membres de la parentèle qui appartiennent à la fonction publique et qui disposent, à ce titre, de traitements relativement avantageux grâce à l’indexation des salaires à hauteur de 40 %, seront particulièrement attendus dans leur fonction d’entraide. On observe ainsi une appropriation de l’économie de la départementalisation avec des formes de redistributions privées qui sont d’autant plus nécessaires que les transferts sociaux sont, pour l’heure, largement déficitaires.
Conclusion
Avec, d’un côté, une économie portée par des emplois publics sur-rémunérés et, de l’autre, un faible déploiement des politiques de redistribution et de lutte contre la pauvreté, la départementalisation de Mayotte participe, dans un premier temps, d’une reconfiguration et d’un durcissement des inégalités. L’étude des deux figures contemporaines de la pauvreté féminine que sont la pauvreté prise en charge par l’action publique et la pauvreté régulée dans le cercle privé permet de mesurer la recomposition des rapports de solidarité au prisme du genre. Lorsqu’elles font la démarche de recourir aux quelques revenus sociaux nouvellement distribués, les femmes témoignent d’une volonté de s’affranchir des situations de dépendance économique qu’elles ont vécues jusqu’alors et qui, bien souvent, les ont fragilisées dans leurs obligations et leur économie familiales, qui plus est dans un contexte de forte instabilité des unions conjugales. Peu voire non diplômées, elles savent que seuls les emplois aidés et les transferts sociaux peuvent leur permettre de disposer de revenus monétaires en leur nom propre ; revenus qui sont aussi de plus en plus nécessaires pour faire face à la monétarisation croissante des échanges. Ces ressources s’ajoutent, dans des proportions variées selon les familles, à celles issues des transferts privés et d’une économie d’autosubsistance.
A contrario, les femmes davantage concernées par le non-recours témoignent, à la fois, des difficultés et des contraintes rencontrées pour faire valoir un droit par ailleurs minoré, de la vitalité des solidarités exercées à l’échelle de la famille élargie et, enfin, de la dimension honorifique attachée à ce régime d’obligations. Avoir les moyens de se passer d’une aide publique, c’est aussi présenter l’image d’un groupe familial intégré. Dans le cas présent, les rapports de genre qui sous-tendent les principes d’attribution et de redistribution des ressources sont moins perçus du côté de la domination et de la dépendance que de celui de rapports de solidarité qui demeurent suffisamment opérants pour contenir et atténuer les inégalités sexuées. Rapportée aux transformations induites par la départementalisation, la régulation de la pauvreté féminine s’appuie moins, ici, sur l’action publique que sur une redistribution intrafamiliale des ressources inégalement distribuées à l’échelle de la société salariale. Au final, on remarque que si les modes de régulation varient ainsi d’une figure de la pauvreté à l’autre, ils témoignent invariablement de la reconduction de rapports de genre dans les strates inférieures de l’espace social. Les aspirations en termes d’émancipation féminine et d’autonomisation économique demeurent triplement contraintes pour ces femmes non ou faiblement diplômées ne maîtrisant pas toujours la langue française, exclues de fait des possibilités nouvellement offertes par la condition salariale, et insuffisamment prises en charge par des politiques d’insertion et de lutte contre la pauvreté qui restent à construire à Mayotte.