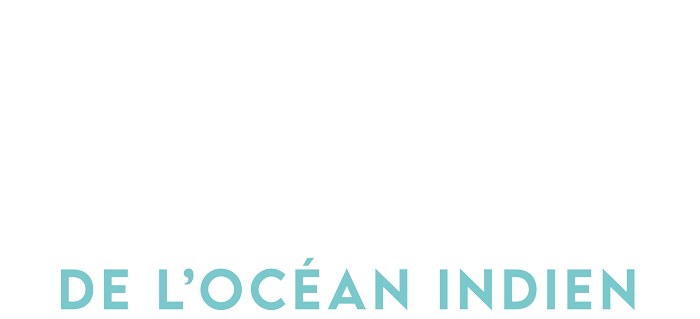Introduction
Dans le jargon de l’Afrique du Sud, tsotsi est un terme utilisé pour désigner les délinquants urbains noirs, les voyous des rues ou un membre de gang. Tsotsi est une déformation de « tsotsa », qui signifie en langue sesotho « habillé de façon voyante ». Leur histoire remonte aux gangs de prison du début du XXe siècle et aux célèbres gangs des années 1930 qui sévissaient dans les banlieues de Johannesburg. Les propos de Nelson Mandela dans son autobiographie « La longue marche vers la liberté » décrivent bien les conditions de vie des tsotsis de l’époque : « Les gangsters, appelés tsotsis, armés de crans d’arrêt, étaient légion. À l’époque, ils imitaient les vedettes des films américains et portaient chapeau mou, costume croisé et cravate aux couleurs vives […]. Il y avait les grands tsotsis, en costumes zazou, et les petits tsotsis, les arnaqueurs. » Aujourd’hui, le terme « tsotsi » désigne les jeunes délinquants à la dérive alors qu’il avait à l’époque une connotation plutôt « glamour » du banditisme. Au costume zazou s’est substitué le jogging américain, les Nike/Reebok et, souvent, le pistolet à la ceinture…
L’Afrique du Sud est souvent citée comme l’un des pays les plus violents au monde. On parle selon l’expression locale de « world capital of crime ». On ne peut comprendre l’importance du phénomène des gangs sans avoir à l’esprit la violence de l’environnement sud-africain (Pinnock, 2016 ; Lindegaard, 2017), où l’organisation criminelle gouverne les villes, en premier chef au Cap (Samara, 2011). Cet article est le fruit d’une thèse et d’un second terrain de post-doctorat dans les townships de Bontheuwel et de Mitchell’s plain des Cape Flats dans la banlieue du Cap.
Doc. 1 Les Cape Flats, banlieues orientales de la métropole du Cap
(Photo libre de droit, wikipédia)
Notre guide était Dashia, un musulman pratiquant et ancien tsotsi. Furent réalisés trente-huit entretiens semi-directifs avec des membres appartenant principalement aux Americans et aux Young Americans.
Il peut être pertinent d’examiner ici dans quelle mesure l’économie criminelle des Cape Flats loin de menacer la société civile, comme on le suppose généralement, pourrait être susceptible d’atténuer l’impact d’une crise de la gouvernance de l’État et de l’économie formelle. La gouvernance criminelle fonctionne-t-elle comme ce que Karl Polanyi (1957 [1944]) a identifié comme un « contre-mouvement » contre les forces destructrices du capitalisme qui peuvent retarder ou soumettre des formes plus radicales de protestation contre l’État ? (Standing, 2006).
Dans une première partie, on explorera le gangstérisme comme une activité criminelle qui structure les townships, sociétés sans État à maints égards, et participe d’une gouvernance par le crime. Ce contre-gouvernement, arguera-t-on dans une seconde partie, s’est institué pour une série de raisons plurielles reposant sur une matrice composite ancrée dans le temps long de l’histoire. En définitive conclura-t-on que la ritualisation du gangstérisme exprime une reconstruction d’un modèle de société s’agençant dans un anarcho-primitivisme imputable aux apories du paradigme néolibéral. Ce dernier montre en ces marginalités urbaines la fin de « l’histoire » à travers l’apocatastase qu’a infléchi Mandela par l’entremise d’un salut remis au marché à travers le consensus de Washington de 1994. Le triptyque libéralisation, privatisation, dérégulation de celui-ci a contribué à amplifier un apartheid non plus exclusivement de races, mais de classes (Houssay-Holzschuch, 2000) nous laissant penser le gangstérisme comme un anarcho‑tribalisme.
Les gangsters comme entrepreneurs de violence
Les gangsters sont des entrepreneurs de violence qui dominent par les armes des territoires (turfs) au détriment des résidents des townships1, premières victimes de cette criminalité. Certaines estimations de criminologues comme Pinnock (1997) laissent penser que, pour la seule ville du Cap, 10 % de la population serait liée, de près ou de loin, au gangstérisme. Celui-ci ne peut se réduire pourtant à sa dimension déviante. Les activités criminelles structurent des identités et co-organisent des espaces urbains.
Comprendre le gangstérisme
Il n’existe aucune définition véritablement consensuelle du gangstérisme (Standing, 2006). Il faut cependant préalablement distinguer le crime organisé, des syndicats du crime et des gangs. En général, les gangs tendent à être moins structurés que les syndicats. Ils sont souvent basés sur un territoire, leurs activités criminelles sont moins sophistiquées que celles des syndicats, leurs membres sont en moyenne plus jeunes et ils s’identifient eux-mêmes par le nom du gang. Les membres du gang ont le sens de la cohésion qu’ils renforcent en créant une atmosphère de peur et d’intimidation. Le premier intérêt académique pour les gangs de rue trouve son origine dans la tradition américaine de l’École de Chicago des deux phases des années 1930 et 1950-1960. Il s’inscrit à l’origine dans une vague criminelle et un contexte récurrent de conflits entre gangs à Chicago, objet d’une vaste enquête sur la criminalité, en 1924, lancée par l’Illinois Association for Criminal Justice (Landesco, 1929). Prenant acte du phénomène, plusieurs lignes théoriques interprétatives ont été proposées. D’abord celle qui s’appuie sur la théorie de la « désorganisation sociale » pour expliquer l’apparition de gangs dans des zones interstitielles de la société en milieu urbain (Trasher, 1927 ; Shaw et McKay, 1969). Selon Trasher (1927), le succès des gangs exprime l’affaiblissement du contrôle social, révélant ainsi une crise sociale profonde dans la fraction la plus démunie de la population américaine, dont les groupes d’immigrants nouvellement installés. Les gangs sont ici appréhendés comme une forme temporaire et transitoire d’organisation de jeunes à terme intégrés. Le concept central ici de « désorganisation sociale » est plus tard critiqué notamment par Whyte (1996), avec son étude en observation participante d’un quartier italien pauvre de Boston, où il démontre qu’il y règne une organisation complexe basée sur un système d’obligations réciproques. Selon l’auteur, ce quartier est en réalité organisé, mais d’une façon différente. À partir des années 1950, apparaissent des théories prenant appui sur les théories « sous-culturelles » et sur les théories de la « tension » (Merton, 1938 ; Parsons, 2013). Ici, l’objet de recherche est la relation entre une sous-culture délinquante juvénile transmise par les pairs et la source de la délinquance définie par un problème d’ajustement et de tension entre structures sociales et valeurs culturelles dominantes de la société. Ce sont les travaux de Cohen (1993), puis de Cloward et Ohlin (1966), qui étudient le processus d’apparition de différents types de sous-cultures délinquantes, en fonction des contextes dans lesquels se trouvent placés les membres des gangs. Les auteurs tentent ainsi de rendre compte de trois types de sous-culture délinquante et orientation des gangs, sans qu’elles soient exclusives : les gangs criminels, les gangs conflictuels et les gangs retraitistes, lesquels se caractérisent par un mode d’adaptation à la marginalité sociale et à l’illégitimité locale. Enfin, dans un autre champ issu de l’École de Chicago, se situe la théorie interactionniste de l’étiquetage ou du « labelling », qui permet de comprendre comment la « désignation » d’un individu en tant que déviant, peut l’amener à se regrouper avec d’autres individus objets de la même désignation, forgeant ainsi une identité collective pouvant prendre parfois la forme d’un gang et en adopter les logiques (Becker, 2008).
Le quotidien Tsotsi
Décrivons tout d’abord les principales caractéristiques des gangs sud-africains (Haefele, 2003) :
-
Le nom du groupe : « Americans », « Hard Living Boys », « Fancy Boys », « Cape Town scorpion », « Restorama kids », « Gambling boys », « Stupids », « Dirty Bastards », « Mafias », etc.
-
Le territoire appelé turf qui est délimité par des graffiti.
-
Le code vestimentaire : des vêtements d’une couleur ou d’une marque et/ou d’un style particulier par exemple.
-
Des signes tels que les chaînes en or, des piercings, des dents en or ou des diamants, voire des incisives très fréquemment arrachées – dents de la passion selon la terminologie locale, signe de virilité et symbole de pouvoir sexuel − chez les Coloured, à savoir les Métis qui ont des ancêtres issus de plus d’une des diverses populations habitant la région, notamment les Khoisan, les Bantous, les Européens, les Austronésiens, les Asiatiques du Sud ou les Asiatiques de l’Est.
-
Des tatouages. Ils sont nombreux, répartis un peu partout sur le corps ou le visage de temps en temps, − mais surtout le bout des phalanges et les pieds − et sont écrits artisanalement à l’aide d’une aiguille jamais stérilisée, qui participe de la propagation du sida.
-
Des communications à travers des signes de la main.
-
L’utilisation de l’argot des rues qu’on appelle au Cap le Kombuis chez les Coloured.
-
Des armes : qu’elles soient à feu ou blanches. Chaque tsotsi se doit d’en posséder plusieurs.
L’un des paradoxes du gangstérisme dans les Cape Flats est qu’il semble recevoir dans une certaine mesure un soutien de la communauté. Cette situation n’est pas propre aux townships sud-africains : les favelas du Brésil sont une autre illustration de ce phénomène qui est donc en contradiction (Standing, 2003) avec la vision traditionnelle d’un crime organisé comme un phénomène antisocial, tel qu’il est décrit dans maintes publications alimentées par les universitaires ou les politiques. On peut penser par exemple à la fameuse description donnée par Kofi Annan, secrétaire général des nations unies, où il qualifie le crime organisé de « société acivilisée, une force diabolique qui défait le bon travail de la société civile ». La partie présente tentera d’explorer les relations entre le crime organisé et les communautés qui font les Cape Flats. Plus précisément, on verra pourquoi la communauté soutient parfois des criminels et l’impact qu’elle a sur la construction de ces derniers.
Les violences des tsotsis sont fréquemment condamnées par les résidents des townships. Que les externalités négatives soient non négligeables, que les agissements criminels transgressent une morale universelle de type kantienne sont des évidences à rappeler. D’autant que, nous allons tenter de le montrer, ces violences participent fréquemment d’une situation belligène lors des guerres entre gangs. Cependant, les analyses traditionnelles de l’impact social du crime organisé ont tendance à être trop simplistes. Dans les Cape Flats, zone où sont situés les townships du Cap, nul doute que la violence ne cesse de ronger le tissu social et de mettre à mal la paix civile. Pour autant, l’économie criminelle ne saurait être seulement considérée comme un mal condamnable, une menace de stasis pour la société. La frontière entre économie criminelle et économie légale est floue. C’est pourquoi, dit Ashley, « ici tout le monde est un gangster. Si tu ne fais pas du hijacking, tu profites de voitures ou autres biens volés. Tout le monde fait ses courses au marché noir ». Difficile donc d’avoir un raisonnement manichéen. À en croire les gangsters et le commissaire de police Michael, responsable du township de Bontheuwel, ceux qui ne volent pas sont souvent coupables de recel. Dans des zones oubliées de facto par les entreprises et par l’État, l’économie criminelle peut développer des dimensions sociales. Le crime organisé peut représenter une réponse rationnelle à la survie et, plus durant l’apartheid qu’aujourd’hui, à la résistance. Aussi est-il nécessaire d’apprécier à la fois la dimension anti-sociale du gangstérisme et ses aspects sociaux. Bien qu’unanimement condamnés par les dirigeants nationaux, tous les résidents des Cape Flats ne répondent pas avec la même violence face à l’économie criminelle. Il arrive même que certaines communautés montrent un soutien ostensible à des criminels pourtant honnis partout ailleurs. Les habitants des Cape Flats sont à la fois victimes du gangstérisme – principale source des violences criminelles –, et soutiens de certains gangsters. C’est pourquoi nous soutenons l’idée d’une ambivalence des tsotsis en matière de cohésion sociale.
Un État dans l’État
L’appui aux criminels peut se résumer à fermer les yeux ou à donner de fausses informations aux policiers. Cependant, le soutien est parfois explicite et actif. D’après Mail and Guardian, durant le procès de Rashied Staggie, ancien chef charismatique du gang des Hard Living, des femmes ont hurlé : « vive Staggie ! C’est le don de Dieu ! Il est le héros du peuple ! ». Une peinture murale a été installée près de chez lui, ce qui n’est pas sans rappeler le culte de la personnalité de hauts dignitaires communistes. Un membre de l’Église explique :
Dans ce township, 60 % des habitants sont soit au chômage soit vivent d’une allocation. Un des chefs de gang valait 40 millions de rands, ce qui est énorme comme valeur assignée à une personne pour ce titre. Il a été arrêté par la police et la communauté a réagi violemment. Je veux dire qu’il y a eu des scènes horribles. En une nuit, ils ont récolté un million de rands2 pour la caution du chef de gang ! Pour une communauté aussi pauvre, trouver autant d’argent en dit beaucoup sur la stature de la personne. La communauté l’a vu comme étant une victime de la brutalité policière.
Doc. 2 Peinture murale de Rashied Staggie
(Photo libre de droit)
Toutefois, l’on se doit de souligner l’hétérogénéité des gangsters. La plupart des membres de base des gangs des rues tendent à avoir un comportement anti-social. Pour autant, l’élite criminelle a à la fois les moyens et l’intérêt de développer des relations plus fraternelles avec la communauté car ils ont intérêt à ne pas attirer la police. Dans son étude sur la violence dans les Cape Flats, Stefen Jensen (p. 89, 2008) explique bien cette distinction :
Les gangs des rues sont généralement considérés comme causant plus de dommages aux gens ordinaires du township à travers les vols, les cambriolages, les agressions ou les simples intimidations. Tandis que les « marchands » sont faciles d’accès, les « laities » (jeunes gens) sont incontrôlables.
Trois raisons principales peuvent expliquer pourquoi l’élite criminelle est soutenue. Parce qu’elle fournit des revenus, qu’elle amorce l’esquisse d’une gouvernance de la communauté et qu’elle fait des dons parés de l’aura légitimante de la philanthropie, l’élite criminelle entretient des relations complexes avec la population. Par cette approche, on se réfère à des études classiques du crime social d’un groupe d’historiens marxistes incluant Eric Hosbawm (2008) et Edward Thompson. Dans l’étude des « bandits sociaux », ces universitaires ont dévoilé comment les activités illégales étaient soutenues par les communautés paysannes en raison de leur défiance vis-à-vis des lois qui visaient à protéger les richesses des classes dominantes. « Les bandits sociaux, écrit Hobsbawm, étaient des paysans hors-la-loi que l’État et le seigneur considéraient comme criminels mais que les gens voyaient comme des héros, des champions, des combattants de la justice et de la libération » (ibid., p. 83). Cependant, le crime n’est ici ni social ni perpétué par des Robin des bois romantiques, mais plutôt par des criminels cyniques.
La criminalité souligne et accentue la destruction des communautés et, en même temps, fournit des ressources pour leur survie. Étant donné le nombre important d’acteurs impliqués dans les divers trafics, il est évident que l’économie criminelle procure des emplois et des biens à des milliers d’individus qui sont exclus socialement. Il ne faut donc pas réduire les activités criminelles à leur simple dimension déviante : elles constituent aussi des activités rationnelles. On peut parler comme Hein Marais (1998, p. 23) de « mécanisme d’adaptation ». Un habitant de Bontheuwel témoigne qu’ : « On peut pas attendre des familles qu’elles posent trop de questions quand la nourriture est sur la table ». Des vendeurs font régulièrement du porte à porte en proposant des biens volés sans se cacher aucunement. De la même manière, des boutiques d’alcool sans licence (shebeens) ont pignon sur rue. En un mot, l’économie informelle est institutionnalisée. Elle est de plus parfois valorisée, du fait que prédomine une vision innovante du crime organisé. Les criminels sont vus, par beaucoup des habitants du township que j’ai interrogés, comme des businessmen. Hein Marias écrit :
Beaucoup d’entreprises criminelles sont exemplaires de l’entrepreneuriat. Elles réussissent là où les autres échouent. Elles excellent en innovation (p. 81).
La seconde dimension sociale de l’élite criminelle des Cape Flats est liée à leur rôle de régulation de la vie communautaire. À cet égard, il y a des similitudes avec les classiques Mafiosis siciliens qui fonctionnaient comme une forme de gouvernement criminel dans une région où l’État était déliquescent et inefficace. Plus complexes sont donc les groupes criminels : s’ils créent, à première vue, une impression d’anarchie, une analyse plus fine montre une certaine allégeance à des règles susceptibles de produire de l’ordre, fût-ce dans la terreur. Durant l’apartheid, l’État s’est focalisé sur la ségrégation, obnubilé par la sécurité des Blancs et l’inféodation des Noirs ; l’absence d’État-Providence a rendu les Cape Flats ingouvernables. Bien que des efforts aient été faits par les différents gouvernements depuis 1994, il est évident que l’État n’est toujours pas apte à contrôler les zones les plus pauvres des Cape Flats, généralement sous la mainmise des gangs, raison pour laquelle la qualification de « zone grise » peut prendre ici tout son sens. Aussi pourrait-on parler de « gouvernance par le bas ». L’élite criminelle, en structurant la vie communautaire, bénéficie du soutien plus ou moins actif des habitants, qui ne peuvent cependant que regretter la faible visibilité de la « main gauche de l’État ». On est donc loin de la situation anarchique que les théoriciens prêtent aux nouveaux conflits. La criminalité peut, dans une certaine mesure, créer du lien social, voire une certaine cohésion entre des individus en situation précaire, dépendants les uns des autres.
Certains criminels importants adoptèrent des stratégies cyniques durant les élections de 1994. Selon des activistes ANC3 dans les townships à cette époque, des membres du Parti National4 conspirèrent avec des chefs de gangs pour la prospection électorale. Ainsi, certains hommes politiques, incluant Nelson Mandela, étaient attaqués par des gangs de rue dans les townships coloured. Des membres de l’ANC tentèrent d’arranger des rendez-vous secrets afin de rétablir la confiance. Paradoxalement, et en apparence seulement, l’élite criminelle arrive à maintenir sa « popularité » par des actes de philanthropie. Dès lors, la communauté les voit comme des héros locaux. Au Cap, certains criminels, à l’exemple de Staggie, sont plus flamboyants. Une de ses actions les plus notables a été de distribuer des billets depuis sa voiture. Irvin Kinnes (2000, p. 43) écrit ainsi :
L’acte de jeter de l’argent par les fenêtres était un spectacle. Staggie descendait les rues du township et disait aux enfants qu’il allait jeter de l’argent quand il reviendrait. Par conséquent, des centaines de personnes, incluant des adultes, sortaient dans les rues. Ils attendaient agglutinés la voiture salvatrice. Puis couraient autour afin de récupérer l’argent. De cette manière, le chef de gang lançait jusqu’à 20 000 rands par les fenêtres pour sa communauté.
Par conséquent, les relations entre criminels et victimes sont contradictoires et ambivalentes. Elles ne peuvent se réduire à de la pure défiance dans un monde où règnerait une anarchie absolue que scelleraient des heurts ethniques. Les affrontements ont lieu avant tout entre criminels durant les guerres des gangs et les premières victimes sont issues des townships. De sorte qu’il faut pour le moins nuancer la perspective développée, comme on l’a vu, par les théoriciens des nouveaux conflits présentant leurs singularités à travers la thèse d’une institutionnalisation d’une violence chaotique dont la population civile en ferait les premiers frais.
Un contre gouvernement
Généalogie
Le gangstérisme fleurit sur l’absence de l’État social ; il forme ainsi, comme le qualifient les sociologues Suzan Strange et Letizia Paoli (2008) pour le cas italien, un véritable « contre gouvernement » (p. 43). Il convient d’en étudier plus précisément les causes. La violence de l’apartheid fut à la fois d’ordre physique et symbolique. Une multitude de lois « sécuritaires » draconiennes vont entrer en vigueur entre le milieu des années 50 et la fin des années 80. Un comportement considéré comme normal dans une société libre était criminalisé, tels que faire grève, vivre ou se promener dans une zone réservée aux gens d’une autre race, avoir des relations interraciales, posséder une littérature jugée subversive depuis le Kama Sutra jusqu’au Capital de Marx.
Les raisons de la colère
Il semble qu’il y ait un lien entre la transition politique de la dernière décennie et la croissance du taux de criminalité. Tous les pays ayant connu une transition démocratique ont, peu ou prou, été victimes d’un regain de violence le temps que se consolident les institutions démocratiques. La transition sud-africaine aboutit à une restructuration du système de justice criminelle : abolition d’un certain nombre de lois et promulgation de nouvelles. Aussi, beaucoup de fonctions judiciaires ont été affaiblies. De plus, le personnel de police, habitué à un système autoritaire, a dû connaître un temps d’adaptation pour à nouveau travailler dans une structure s’inscrivant dans un État de droit.
Certaines études concernant les hauts taux d’actes violents quand elles se réfèrent à l’histoire de l’Afrique du Sud, suggèrent que les familles souffrent de « violence institutionnalisée » depuis des décennies. La violence politique semble avoir détruit bon nombre de familles en minant notamment le contrôle parental sur les enfants. Or, la fragilisation de l’unité familiale peut prédisposer aux comportements délinquants comme l’a aussi montré Venkatesh (2008) dans son étude des gangs américains. La remise en cause de l’autorité parentale n’est pas née ex nihilo de la fin de l’apartheid, elle s’inscrit dans une histoire longue de « délégitimation » des adultes, accusés par les adolescents de ne pas s’être assez battus contre l’apartheid.
Historiquement, le développement des gangs en Afrique du Sud est inextricablement lié à l’histoire de l’apartheid. Comme le souligne Jensen (ibid., p. 25), « la législation de l’apartheid a grandement contribué à l’essor du gangstérisme et ce tout particulièrement dans les townships. Le Group Aera Act, les Pass laws,5 les iniquités institutionnalisées ont joué un grand rôle en délégitimant le pouvoir en place et en formant des contre-sociétés ». Bon nombre d’activistes de 1985 sont ainsi devenus des chefs de gang.
Plus une société dispose d’armes, plus elle est violente. Or, la société sud-africaine est lourdement armée. Selon les registres de la police, plus de 3,5 millions de Sud-Africains possèdent légalement 4,2 millions d’armes à feu. On estime à environ 1,5 million d’armes illégales circulant dans le pays. Du fait de frontières poreuses et du coût peu élevé des pistolets, de nombreux adolescents sont susceptibles de les acheter. Il est probable que les gangs sont derrière un nombre significatif de vols (CIMC, 1998, p. 25) avec armes à feu, tels les hijackings, vols « classiques » de voitures, voire les meurtres qui sont majoritairement commis dans le cadre d’affrontements entre gangs rivaux terrorisant les populations des aires touchées par le phénomène. Des couvre-feux informels ruinent la qualité de vie des résidents des townships des Cape Flats, l’insécurité le soir étant permanente.
Il y a, en outre, une forte corrélation entre l’âge et le crime ; « la chose probablement la plus importante à propos de la criminalité est qu’elle est commise principalement par des adolescents et des jeunes adultes » (Hagedorn, 2008, p. 365). Les chiffres de mise en accusation de la ville du Cap indiquent que les jeunes hommes âgés en 2005 de 18 à 20 ans ont trois fois plus de chance d’être accusés de vols que les jeunes de 20 à 23 ans. Or, l’Afrique du Sud a une population jeune. L’urbanisation qui est un phénomène mondial est déterminante dans le développement des violences ; les taux de criminalité sont toujours plus hauts dans les villes que dans les zones rurales – bien que l’on connaisse des expropriations parfois meurtrières de fermiers blancs. Du fait de la plus ou moins grande concentration d’individus, il y a un processus de compétition pour des ressources limitées – principalement en matière d’emploi – ainsi qu’un plus grand stress et, partant, une augmentation du risque de conflits. De facto, l’Afrique du Sud est le troisième pays le plus urbanisé d’Afrique : 58 % des Sud-Africains vivent en ville. C’est là aussi une caractéristique croissante des nouveaux conflits violents qui se déroulent de plus en plus au sein des villes.
La matrice structurelle
Les performances médiocres du système judiciaire ne doivent évidemment pas être interprétées comme une cause de violence. Le but premier de la justice est de juger, de condamner aussi justement que rapidement les crimes et délits. Or, les statistiques donnent une image des limites du système judiciaire sud-africain. Pas plus de 20 % des crimes et délits en 2006 auraient abouti à une condamnation des coupables. D’autant que les enquêtes de « victimation » indiquent un écart de plus en plus abyssal entre les statistiques officielles et les estimations des acteurs de terrain comme les ONG. La majorité des crimes – et pas seulement en Afrique du Sud – est commise par une petite proportion de criminels. Entre 10 et 20 % des criminels sont responsables de 80 % des crimes perpétrés. Pour que le système judiciaire inspire plus confiance aux victimes, il est nécessaire de restructurer et d’améliorer les capacités punitives et restauratrices de l’État.
Dans une certaine mesure, les violences criminelles semblent avoir été intégrées à l’habitus des Sud-Africains. La violence de la société militarisée durant l’apartheid aurait un effet mimétique sur la génération suivante. La jeunesse a appris à user de la force pour obtenir ce qu’elle voulait. L’anomie, selon Merton (1938), désigne l’inadéquation entre les objectifs qu’une société fixe à ses membres – l’opulence essentiellement dans une société de consommation – et les moyens qu’elle leur donne pour les atteindre de façon légitime. Les crimes, les vols, les autres comportements déviants auxquels certains ont recours pour atteindre ces objectifs sont alors l’expression de l’anomie. Beaucoup de jeunes se joignent aux gangs pour s’émanciper économiquement, mais aussi pour protéger leurs familles très fréquemment déstructurées par le sida. Tous les jeunes que j’ai interrogés avaient été victimes de la violence des gangs avant même qu’ils n’en fassent partie.
Si je ne faisais pas partie de ce gang – me dit un jeune de 15 ans –, j’aurais été une victime d’un autre gang ; si t’en fais partie, c’est pour éviter d’en être victime.
C’est là un paradoxe de la reproduction sociale du gangstérisme. Par ailleurs, la pression des copains est grande :
Au début, je n’en faisais pas partie, je ne voulais pas, ça me semblait trop dangereux mais on m’a appelé « sissie » ou « moffie ».
Il y a donc une déviance dans la déviance, au sens où l’entend Becker (1997). L’individu qui refuse d’accepter le groupe, fût-il déviant, est considéré comme un étranger. Dans tous les cas, les jeunes des townships sont généralement stigmatisés comme des outsiders. Soit par la population qui oscille entre dénigrement et compassion – d’aucuns parleraient de syndrome de Stockholm –, soit par les gangsters eux-mêmes qui n’acceptent pas la non-inféodation à la loi du groupe. Il n’a par exemple pas été aisé d’approcher les habitants de Mitchell’s Plain – un ensemble de townships coloured – très méfiants dès lors qu’on commence à les interroger sur les gangsters (tsotsis). Certains jeunes m’ont même affirmé durant ma première ethnographie avoir mis un contrat sur ma tête après m’avoir vu discuter avec le commissaire du township. Je fus, dès le lendemain, rapidement étiqueté d’« espion ». Pour des raisons de sécurité, j’ai dû changer de terrain.
La violence est tellement présente qu’elle semble s’ancrer, dès le plus jeune âge, dans le rapport à l’autre des Sud-Africains, spécialement ceux vivant dans les « zones de pauvreté » qui sont autant de « zones grises » ; la déviance est donc devenue en quelque sorte pour beaucoup la norme. Le droit de la force prévaut aux lois de l’État. L’adhésion à un gang peut s’expliquer comme une lutte pour développer un réseau de contrôle sur un environnement peu favorable. Par ailleurs, il semble que les jeunes adhérant aux gangs souffrent plus que la moyenne d’une mauvaise estime d’eux-mêmes comme l’a aussi démontré Jankowski (1991) parmi les gangs américains. Se joindre à un gang leur ferait développer paradoxalement une plus grande sociabilité. Le gang est en quelque sorte un substitut de la famille. Le sida, en effet, décime les townships et détruit des familles. Le rapport à la mort est donc différent. Les gangsters ont, d’après mon ethnographie, dans une certaine mesure mythifié la mort dès lors qu’elle est le fruit de guerres des gangs (entre Hard Living Boys, Americans, Funky Kids, par exemple) s’affrontant pour conquérir un territoire, un marché – drogue ou prostitution essentiellement. Mais ils agissent aussi souvent pour le simple motif de mesurer les rapports de force susceptibles de maintenir une cohésion aux gangs, tout en la banalisant quand elle est l’aboutissement du sida.
Les inégalités sont aussi, bien qu’elles n’expliquent pas tout, sources de tensions d’autant plus vives que la fin de l’apartheid laissait espérer, sinon leur disparition, du moins leur résorption progressive. Elles sont à l’origine d’une augmentation du sentiment de « frustration relative » et de l’un de ses corollaires : la violence.
La démocratisation était accompagnée d’espoirs importants que la pauvreté et les inégalités fussent réduites à des niveaux plus acceptables. L’ANC ne promit-elle pas « une vie meilleure pour tous », et « un niveau de vie correct et une sécurité socio-économique » pour chacun en 1994 ? Ces droits fondamentaux étaient inclus dans la constitution de 1996 :
Chacun a le droit d’avoir accès à un système de sécurité sociale, d’avoir suffisamment de nourriture et d’eau. L’État doit prendre des mesures législatives pour que chacun puisse actualiser chacun de ses droits.
On est en droit de s’interroger de manière comparative sur le degré d’inégalités. De cette évaluation de l’accroissement des inégalités, on peut mieux comprendre comment et pourquoi la stasisation est encore une menace pour la société sud-africaine alors même que la démocratie sociale semble s’être institutionnalisée. En raison de l’explosion des statistiques suite à la fin de l’apartheid, un tableau de la situation économique peut être esquissé un peu plus finement grâce à la parution de nombreux indicateurs économiques, comme celui des revenus. Il y a une certaine indétermination quant à l’accroissement exact des inégalités. Cependant, à l’aide du coefficient de Gini, quelque contestable soit-il pour les économistes, qui est compris entre 0 – situation où les revenus sont parfaitement égalitaires – à 1, totalement inégalitaires, l’on peut esquisser une tendance nationale et internationale à la hausse : selon Seekings (2007), le coefficient de Gini est de 0,58 en 2007. L’Afrique du Sud est donc très inégalitaire. Et même plus que durant l’apartheid si l’on tient compte uniquement des inégalités de revenus. Aussi la stasis en Afrique du Sud, c’est-à-dire la fragmentation socio-économique, n’est plus organisée politiquement comme durant le régime de l’apartheid avec le principe de développement séparé qui prévalait. Mais elle demeure une réalité en ce sens que la structure sociétale fragmentée et divisée selon des critères socio-économiques perdure, voire s’amplifie. Si cet accroissement d’exacerbation des inégalités s’inscrit dans un mouvement mondial, il convient de souligner que l’Afrique du Sud (tout comme la Namibie et le Botswana) est particulièrement concernée et figure, avec le Brésil (0,57), parmi les pays les plus inégalitaires au monde. La France avec un coefficient de Gini inférieur à 0,34 et surtout les pays du nord de l’Europe (0,27 en moyenne) ou le Japon (0,24) sont les pays les plus égalitaires. Incontestablement, ce sont aussi les pays les moins touchés par la criminalité de masse. Les inégalités sont donc l’une des variables à prendre en compte pour appréhender les logiques de stasisation.
Comme l’écrivait déjà le journaliste John Pilger, en 2000, dans le Mail&Guardian, « l’apartheid n’est pas mort. Tous les riches certes, ne sont plus blancs, mais la plupart des Blancs sont encore riches ». Ainsi en est-il de la répartition des revenus : 10 % des plus riches détiennent plus de 45 % de la richesse totale (Seeking et Natrass, 2005). La fluidité de la société est mise à mal par la faible mobilité sociale, tout spécialement l’ascension des individus issus des catégories socio-professionnelles les plus basses. À l’apartheid de race se substitue un apartheid de classe, même si se profile l’émergence d’une nouvelle classe noire (black empowerment), bourgeoise. Mais ces black diamonds n’ont souvent cure des inégalités.
Les inégalités sont aussi sociales. La perception – par définition subjective – des inégalités et de la dégradation de certaines variables sociales ne semble pas être disproportionnée, si on la compare aux données objectives, fussent-elles critiquables. Ainsi, un autre indice qu’est l’IDH (Indice de Développement Humain) corrobore l’hypothèse d’une baisse de la qualité de vie moyenne ; on peut en déduire une hausse des inégalités sociales, dans son acception la plus large, étant donné que les conditions de vie des plus riches n’ont guère changé. L’IDH a augmenté jusqu’en 1995 en Afrique du Sud, puis il a baissé de manière spectaculaire pour passer de la 90e place au milieu des années 90 à la 113e – sur 177 pays classés – en 2019 en grande partie imputable au sida. Or l’IDH est l’un des indicateurs qui, s’il se dégrade, augmente les risques de conflit infra-national, tout particulièrement en Afrique.
La dimension ritualisée du gangstérisme comme expression d’une contre société
Partout les garçons ont un besoin de rituels afin de marquer leur passage à l’âge d’homme. Si la société ne leur fournit pas, inévitablement, ils inventeront les leurs. (Eliade, 1959, p. 90)
Le gangstérisme comme mise en abyme
Le gangstérisme peut renvoyer par la puissance des rituels, le sens de la hiérarchisation, l’importance des armes à feu dans la vie du groupe et le règne de la force physique à des logiques de militarisation. La scène montrée dans le film romancé Tsotsi sorti en 2005 d’une femme braquée dans sa voiture se reproduit quotidiennement en Afrique du Sud. Lors de mon arrivée en avril 2008 à Mitchell’s plain, j’ai été témoin d’un début de hijacking. Il est légitime d’explorer, derrière le mobile financier, les mécanismes de ces violences et les ressorts des conflits qu’elles engendrent.
Dashia, mon informateur principal, musulman pratiquant depuis 3 ans, mais ancien tsotsi, m’a souvent accompagné interroger des gangsters à Mitchell’s Plain, le plus grand township coloured avec son 1,1 million d’habitants ; un jour, nous nous arrêtâmes à un coin de rue où, malgré une journée pluvieuse, se réunissaient des jeunes de 13 à 18 ans. Tous ont cessé l’école entre 9 et 13 ans. Quand je mentionne le mot « police » puis « armée », ils s’esclaffent. « Ici, c’est nous les chefs. On en a rien à foutre de leurs règles. La règle c’est ça ! ». Et eux de me tendre un 357 magnum. En réalité, si nier la force ordinale des gangs comme peuvent le faire certains très rares politiciens locaux relève de l’ineptie, il convient de nuancer quelque peu le tableau. Non que les tsotsis ne soient pas très souvent les princes de leurs turfs mais, plutôt, qu’une certaine hétéronomie peut être constatée dans la mesure où une part irréductible de groupes vigilants ou de policiers scrupuleux contribuent dans certains quartiers à rétablir un semblant d’ordre, fût-il des plus précaires.
Dashia me montrera un autre jour un killer ou hitmen (Shaw et Skywalker 2016) particulièrement avenant. Pour le décrire en quelques mots : il a 18 ans, il ressemble plus à un Xhosa qu’à un coloured. Il a arrêté l’école à 11 ans. On me dira après qu’il est séropositif. Son discours est relativement pauvre, il a l’air très timide et semble introverti. De ses crimes, il ne semble avoir aucun remords : la froideur n’est-elle qu’apparente ? La culture de la rue rejette les affects au rang d’accessoires de métrosexuel, de moofie (pédale), elle fait passer les sentiments dans le domaine du privé qui tend à s’effacer au profit d’une sphère publique oppressante où l’on valorise la violence plutôt que les passions amoureuses et où les femmes sont réifiées à l’image de la métaphore pompdinge (« choses que tu baises »), usitée de manière récurrente pour les désigner. En me promenant dans le terrain vague qui sert de lieu d’affrontements dans le cadre régulé de matchs de foot, je réalise à quel point le privé n’existe quasiment pas pour ces jeunes : des dizaines de préservatifs usagés jonchent le sol fangeux ; n’ayant, par promiscuité, aucun lieu d’intimité, les adolescents ont leurs rapports sexuels sur l’herbe, et presque dans la boue.
Se pose la question de leur socialisation. On l’a dit, dans un contexte anomique, le gang offre une sorte de structure familiale alternative. Par la discipline et la rigidité des règles auxquelles font allégeance les gangsters lors de leur assignation statutaire, via des rites codés et précis, l’on peut sans aucun doute conférer au gang une structure et une organisation paramilitaires, où la guerre contre l’adversaire est l’horizon probable de l’activité criminelle.
Contre le capitalisme, tout contre
Les gangsters sont profondément pénétrés par des valeurs libérales, par des idéaux de société de marché où l’opulence et le consumérisme sont en quelque sorte des fins en soi. De là parlera-t-on de « glocalisation » : l’Afrique du Sud des tsotsis ; leur quotidien est un syncrétisme culturel entre société et traditions teintées de couleur locale et modèle américain de marché néo-libéral où les marques de sport particulièrement sont valorisées comme symboles d’appartenance au village global. Le marché noir fleurit, on l’a dit, dans les Cape Flats. En s’insérant dans un gang, les adolescents espèrent pouvoir atteindre l’opulence. Parallèlement à cela, l’affiliation statutaire à une organisation militaire ou criminelle, qu’elle prenne le nom de mafia, de firme ou de gang, est fortement traversée par un désir d’appartenance à une communauté d’expérience et, partant, de sens.
Pierre Clastres (1974), dans sa désormais thèse classique de la société contre l’État, a démontré avec brio que les « tribus » ne sont pas pré-étatiques, allant à l’encontre du paradigme dominant évolutionniste, mais, plutôt, qu’elles se sont construites pour éviter l’apparition d’une instance centrale hiérarchisante. Dans Archéologie de la violence, Clastres s’oppose ainsi aux interprétations structuralistes et marxistes de la guerre dans les sociétés amazoniennes. Selon lui, la guerre entre tribus – terminologie utilisée par Clastres – est une façon de repousser la fusion politique, et donc d’empêcher la menace d’une délégation de pouvoir menant aux dérives intrinsèquement liées à la trop grande taille d’une société. Cependant, les sociétés dites « primitives » – on parle à raison maintenant de sociétés traditionnelles ou, avec Lévi-Strauss, de sociétés froides – refusent la différenciation économique et politique en interdisant le surplus matériel et l’inégalité sociale. On voit bien ici que le gang peut s’appréhender sous l’angle ethnologique, car le groupe criminel constitue bien plus qu’une simple organisation à but lucratif ; il est aussi, selon nous, l’avatar d’un modèle de société traditionnelle dans sa dimension structurelle − où l’affiliation statutaire prime sur le contrat social, mais où l’agencement des individus laisse une grande place aux reconnaissances institutionnalisées d’inégalités − reconfiguré dans une société chaude. On récuse évidemment toute perception sclérosante des gangs visant à les essentialiser sous un visage impavide et impassible. Les gangs sont des groupes humains : ils sont dans l’histoire, dans la modernité, ce « mouvement dans l’incertitude » que Balandier (1988) se plaisait à définir. Ne constituent-ils pas des sociétés tièdes pour prolonger la métaphore de l’auteur de Tristes tropiques ? Il n’en reste pas moins que la structure et l’affrontement perpétuel des gangs permettent d’éclairer en quoi et comment ces groupes violents nés en partie de la fragmentation de la société constituent des moyens de construire une cohésion sociale à leur niveau tout en compromettant gravement le bien-être des communautés et de la société sud‑africaine.
Le rite comme catharsis
Afin de comprendre la criminalité juvénile, il est nécessaire de comprendre ce qu’est l’adolescence. David Cohen (1991, p. 44) décrit l’adolescence comme « une corde faite de nœuds de symboles et de magie faisant passer l’enfant vers la maturité ». C’est une période largement créative et de prise de risque pour les garçons qui se manifeste aussi par un appel à l’initiation. Mircea Eliade (1992), dans ses travaux sur le sujet, a adopté une approche comparative dans une douzaine de cultures à travers le monde. L’initiation des garçons commence avec deux évènements :
-
Une séparation avec les parents plus ou moins brutale. La mort de l’un d’entre eux par le sida ou autres violences urbaines dans le cas sud‑africain.
-
Le novice part ensuite en forêt, dans le désert ou dans la nature sauvage. La rue est investie de cet aspect symbolique là, selon nous.
Dans des sociétés moins anomiques, ces rites sont reconnus comme tels. On pourrait multiplier les exemples à l’infini : au Vanuatu, les adolescents plongent de tours très hautes faites de lianes afin de montrer qu’ils sont assez courageux pour devenir des hommes ; chez les juifs, à 13 ans, le garçon durant la bar mitzvah devient le fils du commandement et devient responsable de ses actions. À Rio de Janeiro, les adolescents surfistas se mettent au-dessus des trains. S’ils touchent les lignes électriques ou tombent, ils risquent de se blesser sérieusement ou de se tuer. Dans les Cape Flats, les jeunes membres doivent « casser la bouteille » : c’est-à-dire être la personne qui allume dans une bouteille un mélange de dagga et de mandrax que tous les autres membres du gang se mettent alors à fumer. Parmi les membres plus âgés, il est possible d’occuper une position supérieure en tuant un tsotsi d’un autre gang. En visant in fine le respect, ou la peur de l’autre. Tom Driver (1991, p. 89) a suggéré que la « ritualisation, fût-elle violente, est notre premier langage, pas notre langue maternelle, mais plutôt notre grand-mère. Ce ne sont pas nous qui avons inventé les rituels, ce sont eux qui nous ont inventés ».
Arnold Van Gennep (2013) a montré que de nombreuses cultures créaient des rites de passage durant les moments de « crise de la vie » : naissance, puberté, mariage, paternité/maternité et la mort : « Pour les groupes, comme pour les individus, vivre c’est sans cesse se désagréger et se reconstituer, changer d’état et de forme, mourir et renaître » (p. 90). La vie, explique-t-il, est constituée de phases : rites de séparation (ou préliminaire, pour détacher le sujet de son ancienne condition), rites de seuil (rite transitionnel) et rites d’incorporation (post-liminaire). La séparation implique un détachement symbolique et/ou réel durant l’espace du rite. L’individu se différencie du reste de la communauté. L’individu doit mourir, puis renaître sous un nouveau jour.
Dans les rites de seuil, l’état du « voyageur » est ambigu, passant à travers un empire qui est indéfini. À ce niveau, il y a une suspension des règles établies et l’individu est souvent appelé à faire ce qui est interdit. Le rituel « liminaire » emploie sa propre structure qui est différente de la structure de la société. Les adolescents s’y engagent dans des rites de transgression. Durant le rite d’incorporation, les rituels sont utilisés pour symboliser l’entrée derechef dans la communauté et dans le nouveau groupe. L’ensemble de ces rituels est à la fois un processus individuel relevant de l’intériorité subjective et un processus social de continuité. Les rites de passage semblent donc être universels et particulièrement importants dans les sociétés traditionnelles. Travaillant parmi le peuple Qaba dans le Transkei dans les années 60, Joan Broster (1982) découvrit que les jeunes adolescents étaient intronisés dans le Umtshotsho ; un club où ils dansaient sous la supervision d’un « magistrat » qui, selon des règles très strictes, acceptait ou non qu’ils fassent partie du Umtshotsho. Plus tard, dans cette culture, les adolescents participaient à d’autres rituels de transition, les femmes étaient éloignées des hommes durant l’Intonjane et les garçons devenaient, au terme d’une cérémonie les circoncisant, des abakwhetas. S’il n’y a pas de rite de circoncision chez les gangsters, tout comme chez les Qaba, il existe un certain nombre de rites que l’on peut classer selon la typologie de Van Gennep.
Rite de séparation
La séparation commence dans les rues par la construction du « Nous » et du « Eux ». Au travers d’un processus de différentiation et d’alignement, les jeunes rompent avec leur enfance. Ils vont essayer de se faire accepter dans un groupe d’adolescents. C’est souvent la communauté qui, comme l’a magistralement montré Norbert Elias (1997), fabrique des outsiders du fait de la peur de l’autre. Ainsi se confie un jeune membre des Young Americans :
J’ai été labellisé gangster parce que je restais avec mes amis à l’entrée des magasins (…) ma famille m’a ensuite dit qu’elle me laisserait tomber si je devenais un tsotsi.
Doc. 3 Tsotsis fumant à Michell’s plain
Source libre de droit
Le langage est un des traits distinctifs du gangstérisme. Il existe un argot propre aux tsotsis utilisé afin de se démarquer du « monde normal » (dixit), avec des mots comme moofi (mauviette, pédale), dagga (herbe), etc. Les sujets de conversation préférés des gangsters sont les filles et les batailles. Le pistolet est central dans les conversations. Ainsi :
La chose la plus agréable dans le gang, c’est le son du flingue. Ça effraie l’ennemi et ça fait du bien de voir l’ennemi courir. J’ai toujours pensé que ce serait amusant de faire partie d’un gang, de sortir la nuit, de marcher avec un gun pour tirer sur quelqu’un.
Les gangsters sont très prolixes sur les styles de bataille qui existent. Un membre des Americans a insisté longuement, lors d’un entretien, sur la différentiation des combats en fonction des gangs :
Chaque gang a sa propre manière de se battre. Les Americans ne se battent pas le jour. Nous nous battons la nuit et nous nous séparons en équipe de trois ou quatre. Nous entourons les ennemis et nous leur tirons dessus de tous les côtés. C’est pour ça que nous sommes les plus forts.
Doc. 4 Deux jeunes gangsters se battant à Michell’s plain
Source libre de droit
Outre le langage, il faut insister sur leur gestuelle. Des signes de la main divers peuvent signifier que quelqu’un court dans une bataille, une autre position des mains, que quelqu’un s’apprête à tirer. Les gangs ont chacun leur devise souvent tatouée sur le bras. L’un de ceux que j’ai rencontrés arborait fièrement un « when two killers meet one must die ». Beaucoup des citations qu’ils affectionnent sont fatalistes et cyniques. Sur un mur j’ai ainsi pu lire ce graffiti :
I want them to be losers, but still the winner of my pride
I was born free, but not to stay free
I broke my mother’s heart to please my friend
Born to Kill
Born to lose
When days are dark, people are few
Doc. 5 Photographie d’un American
Source libre de droit
Les Americans sont, sans doute, ceux qui ont, selon l’expression de Michel de Certeau (1990), le plus « braconné », c’est-à-dire adopté les ruses qui font d’une culture d’en haut une réalité acceptée et modifiée par le bas. Le drapeau américain comme symbole de la nation américaine définit ainsi le territoire du gang. Selon les membres, les six rayures blanches du drapeau américain signifient « travail propre : argent » et les sept rayures rouges (sale travail : sang). Le nom du gang AMERICANS signifie pour eux : « AllMighty Equal Right Is Coming And Not Standing ». Leur devise est : « In God we trust, In Money we believe ».
Doc. 6 Photographie d’un American
Source libre de droit
Ils ne s’habillent qu’avec des vêtements américains, ont une constitution imaginaire, un président, un cabinet, une Maison Blanche et ils comptent généralement leur monnaie en dollars ! David Childester a introduit le concept de religion monétaire pour désigner ce sacre de l’argent. Le dernier élément essentiel participant du rite de séparation est le territoire appelé turf ; c’est un formidable moyen de lier le groupe. À Bonteheuwel ou Mitchell’s plain, il ne couvre souvent que quatre à cinq blocs, soit une centaine de mètres en moyenne. Il peut s’étendre au fur et à mesure des batailles gagnées. Le territoire implique que le garçon qui y a grandi appartienne au groupe. Lors de ma première ethnographie en mars 2006, une guerre des gangs a débuté à cause d’un problème de turf. Les Americans ont en effet décidé de kidnapper un garçon de 13 ans qui devait, par son origine spatiale, appartenir aux Hard Livings. Bien qu’on l’eût appâté avec des Reebok neuves et une chaîne en or, il eut « l’affront » de décliner l’offre. Les Hard Livings, de suite, organisèrent des représailles : une bataille qui dura jusqu’à mon départ, en juin 2010.
Les rites liminaires
Dans les gangs, les rites liminaires marquent le commencement de ce que les tsotsis appellent la « chute libre » (Free Fall) qui place le jeune pour un temps ou pour toujours au-delà des limites sociales. Cela peut se traduire par des batailles de gang, des hijackings ou des meurtres prémédités. Le jeune tsotsi doit gagner non plus l’appartenance, mais un statut. Il deviendra véritablement tsotsi après avoir été testé par ses compagnons de gang. La bataille est centrale, on l’a dit, dans la vie d’un gang. Les combats sont déclenchés par des problèmes divers :
C’est souvent une question de territoire – me dit un tsotsi – il suffit qu’un gang adverse empiète sur le nôtre et c’est l’affrontement. Notre espace est très délimité. L’ampleur de notre business en dépend. Parfois aussi, il y a des problèmes avec une drogue qui est de mauvaise qualité, parfois c’est à cause d’une fille.
La bataille est l’occasion de montrer sa virilité :
Tu construis ta réputation en montrant aux gens que t’as pas peur… quand il y a une guerre des gangs et que je suis tout seul, je dois leur tirer dessus afin de leur montrer que je n’ai pas peur.
Doc. 7 Photographie de deux Americans
Source libre de droit
Les rites post‑liminaires
Dès lors, le jeune est presque inévitablement lié à une carrière de criminel. Il est, pour Michael, le commissaire, définitivement perdu. Un tsotsi me confirme cette impression :
Une fois que tu fais partie d’un gang, y a pas moyen d’en sortir, c’est presque impossible, t’as pas l’argent pour changer de quartier et t’es rattrapé par tes anciens camarades du gang qui voudront pas te lâcher ou te considéreront comme un traître.
Un autre affirme :
En plus, t’as tes tatouages, t’as beau essayé de les effacer, ça reste et les autres savent ton passé, tu ne peux pas quitter un gang car il y a plein de secrets que tu partages, si la police a des informations à propos d’un meurtre commis quelque temps auparavant, le gang pensera que c’est toi qui as donné des renseignements et ils te tueront.
Une autre manifestation du rite est la mutilation corporelle : qu’elle vienne de cicatrices de coups de couteau ou de balles d’armes à feu, elle est la manifestation et la condition de possibilité de la solidarité du groupe. Un individu non « marqué » par ces signes peut être ostracisé ou, du moins, susceptible d’être mal vu du gang. On peut sans doute comparer les blessures des gangsters aux circoncisions ou aux scarifications du peuple Dinka par exemple, dont parle Van Gennep qui les considère comme des « marques de masculinité et de signes d’union ». Le premier meurtre est essentiel : c’est l’incarnation de la césure entre le « monde normal et le monde des déviants ». Il est aussi un moyen de gagner des échelons pour accéder au cercle supérieur du pouvoir et pour devenir, peut-être, un futur chef de gang. « Souvent les potes qui ont tué l’ont fait dans l’intérêt d’être plus forts. Ils voulaient montrer qu’ils pouvaient contrôler leur peur et qu’ils avaient la carrure pour dominer les autres » m’a expliqué un tsotsi. Parfois existe-t-il une confusion entre la réalité et le rêve. La prise de métamphétamine et de hachich (dagga) obéit à un rituel de passage. Les jeunes gangsters sont usuellement sous cette substance pendant les crimes et les délits en raison du caractère désinhibant de ce cocktail. Le meurtre est ainsi dépossédé de son caractère déviant :
Quand je me battais avec les Americains et que je tuais l’un d’entre eux, j’étais comme dans un film, ce n’était pas la réalité.
Un des gangsters xhosas que j’ai interrogé arborait sur ses doigts un tatouage « the hated one » (le chercheur André Standing a rencontré pareillement un jeune sur le buste duquel on pouvait lire « my mother hates me ») souhaitant montrer par là qu’il est un « dur à cuire » et qu’il a su se faire détester des autres. Le tatouage est un excellent marqueur de la personnalité de l’individu et du groupe identitaire auquel il appartient. « Ça nous lie entre nous, on est tous solidaires face à notre devise ». Leur adversité est revendiquée en principe uniquement contre l’ennemi. Selon un tsotsi : « je tue uniquement mon ennemi, pas les gens qui vivent en paix ». Les chiffres indiquent cependant qu’une frange non négligeable, mais difficilement quantifiable, d’individus hors de la criminalité organisée sont les victimes de la violence létale de quelques tsotsis. Citons l’exemple de ce jeune adolescent (laitie) qui avait 14 ans lorsqu’il a voulu voler une arme à feu à un policier circulant seul dans son quartier :
Il n’était pas en service… j’étais sous tik6, j’avais 14 ans, j’ai tiré 16 fois dessus… je me suis fait arrêter : 5 ans de prison. Aujourd’hui, j’ai un autre meurtre sur le dos. Je ne veux pas finir ma vie en prison mais bon, ici il n’est pas possible de s’en sortir…
On ne peut enfin comprendre le gangstérisme si on ne prend pas en compte les complexes identitaires taraudant les individus qui en font partie. De même, la structure familiale doit être intégrée comme élément favorisant – ou non – l’implication dans la délinquance.
Conclusion
S’il va de soi que l’on ne naît pas gangster mais qu’on le devient, il n’en reste pas moins qu’il existe une ambiguïté sur le degré de responsabilité des tsotsis. Toute cette ambiguïté pourrait reposer sur le concept d’habitus bourdieusien. Dans ses « méditations pascaliennes », Bourdieu n’affirmait-il pas qu’il se sentait proche d’un certain jansénisme, montrant par là son scepticisme à l’égard de la liberté. Pour autant, on ne tombera pas dans un fatalisme absolu qui ne ferait que déresponsabiliser et finalement déshumaniser les criminels.
En 1972, Laura Nader7 anthropologue américaine mettait en garde de ne « pas étudier les pauvres et les sans pouvoir : tout ce que vous direz sur eux pourra être retenu contre eux ». On contestera d’une part que les pauvres et les sans pouvoir ont toujours une forme de pouvoir, entendu par Weber, comme la capacité dans une relation à imposer sa volonté. On a voulu ici par ailleurs être plus nuancé en montrant qu’au regard de l’environnement, plus précisément du taux record de criminalité, beaucoup de jeunes Sud-Africains des Cape Flats plus qu’ailleurs sont victimes d’une violence qu’ils reproduisent et dont ils deviennent en définitive des coupables. La « loi de conservation de la violence », élaborée par Durkheim puis réactualisée par Bourdieu dans ses Méditations Pascaliennes ayant trait à :
l’illusion populiste qui se nourrit aujourd’hui d’une rhétorique simpliste de la « résistance », « est à relativiser ». Quoi qu’elle en soit elle « porte à ignorer un des effets les plus tragiques de la condition des dominés, l’inclination à la violence qu’engendre l’exposition précoce et continue à la violence : il y a une loi de conservation de la violence, et toutes les recherches médicales, sociologiques et psychologiques attestent que le fait d’être soumis à des mauvais traitements dans son enfance […] est significativement lié à des chances accrues d’exercer à son tour la violence sur les autres (et souvent sur ses propres compagnons d’infortune), à travers crimes, vols, viols, voire attentats, et aussi sur soi-même, avec l’alcoolisme ou la toxicomanie notamment.
Ainsi des familles interrogées, il ressort que tous les adolescents d’une même fratrie ne tombent pas uniformément dans la délinquance.
Quant à ceux plongeant dans la spirale d’une criminalité qui tentent de se justifier en se parant du voile de la légitimité tout particulièrement par le biais d’actes philanthropiques, ils bénéficient évidemment de circonstances atténuantes : ambiance familiale délétère, absence du père, prévalence exceptionnelle du sida, violences urbaines, prolifération d’armes à feu, désordres post-traumatiques dont souffrent près d’un enfant sur cinq des townships, taux de chômage à 50 % minent la construction de soi. Facteurs qui expliquent que les jeunes aient besoin de se créer des véritables contre-sociétés structurées sur des rites de passage qui leur permettent de compenser la perte du lien social dont ils sont victimes en raison d’une crise majeure du capitalisme qui en ces marginalités urbaines s’effondre.