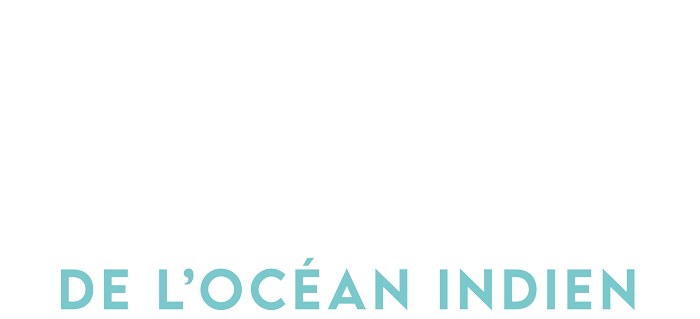Pourriez-vous nous donner les grandes lignes de votre parcours ?
Au terme d’un cursus estudiantin de géographie suivi à l’Université de La Réunion et des premières appétences pour une géographie urbaine, sociale et culturelle, j’ai opté, en niveau Maîtrise, pour un travail de terrain en Afrique du Sud, sous la direction du Pr. J.-L. Guébourg. Étant originaire du cirque de Cilaos, cette ambition se trouvait très probablement motivée par une volonté, fut-elle définie dans le temps, de me « désinsulariser » et de goûter à une altérité́ nouvelle.
Mon Mémoire de recherche a porté sur la singulière ville-nouvelle industrialo- portuaire de Richard’s Bay située au Nord-Est du pays. La mission de terrain de deux mois fut source d’étonnement et de dépaysement. Elle marqua une affection qui ne s’est plus jamais démentie pour l’âpre nation arc-en-ciel. Dans le prolongement, le DEA (Diplôme d’Études Approfondies) s’est orienté sur la métropole de Durban (aujourd’hui eThekwini).
Adossé à une Allocation de Recherche du Ministère de la Recherche, un projet doctoral a suivi, ouvrant à l’intégralité des aires urbaines de la province du KwaZulu-Natal (avec une démarche scientifique liant intra et interurbain). Avec du recul, il est sans doute possible de discerner, déjà, un intérêt liminaire pour les contrées peu ou moins connues, souvent périphériques (à l’intérieur de ces espaces mêmes), celles oubliées et en déshérence, et plus généralement, pour les disparités intrinsèques aux « Suds ».
J’ai soutenu ma Thèse de Géographie en 2003 sous la direction de M. J.-L. Guébourg, devant un jury composé de Mme T. Saint-Julien, M. P. Gervais-Lambony et de M. J.-M. Jauze.
Après trois années en qualité de Moniteur de recherche, puis d’ATER, l’année suivante a marqué la qualification par le CNU. Dès lors, j’ai concuru et accédé au poste de Maître de Conférences (section 23) à l’Université de La Réunion. Un Bonus Qualité Recherche m’amène alors à participer au programme « Sécurité, gouvernance des villes d’Afrique australe » en 2005 à Ibadan au Nigéria. Je m’intéresse à ce moment au terrain mozambicain dans le cadre d’un premier déploiement spatial, sans perdre pour autant de vue l’Afrique du Sud (travail sur la région de Johannesburg).
À la même période, à l’Université de La Réunion, j’intègre l’équipe décanale de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, en tant que Chargé de Mission sur les TICE auprès du doyen G. Fontaine, puis plus tard du doyen J.-M. Jauze. J’accepte également volontiers la responsabilite pédagogique de la deuxième année de la Licence de Géographie.
Peu à peu et du fait de liens étroits avec le champ de l’urbanité et de la culture, mon champ réflexif s’ouvre à la question du Patrimoine (en particulier culturel) et même, un peu avant cela, aux enjeux de la valorisation touristique. Je retiens une exaltante participation au Festival International de Géographie (FIG) de St-Dié des Vosges en 2011, en compagnie de quelques collègues du laboratoire. Le travail sur le rôle des icônes historiques et la mythification de personnages débute à cette période. La notion de marges, de dissonance, de refoulement, et surtout leur réappropriation et leur requalification sous diverses formes, m’interpelle, et plus largement le vaste champ du « Dark tourism ».
Tout cela se fait dans une démarche ouverte et interdisciplinaire au sein de mon laboratoire, le CREGUR (Centre de Recherches et d’Études en Géographie), sise dans l’Unité de recherche OIES (Océan Indien, Espaces et Sociétés), prenant place elle-même dans notre maison commune, l’UFR LSH à l’Université de La Réunion, sans oublier la fédération de recherche OSOI (Observatoire des Sociétés de l’Océan Indien), à laquelle j’appartiens en compagnie ici d’autres disciplines et composantes.
En 2017, je m’engage dans la responsabilité de Référent pédagogique (L1-L2) du Portail Sciences Humaines et Sociales (SHS), qui inclut quatre spécialités : Géographie, Histoire, Sciences Sociales et Information-Communication. La gestion pluri et interdisciplinaire occupe à ce moment une grande partie de mon temps. Elle offre parallèlement une ouverture d’esprit, que ce soit du côté du travail collégial avec les collègues enseignants d’une autre discipline, comme d’une pédagogie adaptative auprès d’étudiants se prédestinant à d’autres voies que la géographie.
En 2017, j’intègre l’AFRAMO (l’Association Franco-Mozambicaine de Sciences Sociales) et nous invitons, avec ma collègue et fidèle amie, Marie-Annick Lamy-Giner, certains de ses membres à un colloque scientifique « Le Mozambique et canal du Mozambique : un espace à l’heure des défis et recompositions ». Lors d’une des dernières missions de recherche en 2019, un ultime terrain de recherche s’ouvre à moi, dans l’optique d’un nouveau déploiement spatial et va concerner cette fois le terrain tanzanien. Les contours des villes de Dar es-Salaam, de Bagamoyo ainsi que de l’île aux épices de Zanzibar sont esquissés.
À partir de l’année 2019-2020, j’intègre le Conseil de Faculté de l’UFR LSH qui offre un regard large sur les enjeux, défis et stratégies de la vie d’une composante. En même temps, je me lance dans ce projet d’HDR, avec pour garant le collègue et Professeur, alors doyen de la Composante LSH, M. J.-M. Jauze. Je m’essaye à un délicat exercice d’introspection, visant à clarifier un positionnement de recherche et dans le même mouvement, dresser certaines perspectives scientifiques.
À quelle « géographie » vous vous rattachez ?
D’emblée et pour tordre le cou à certains débats (vains), la géographie est de mon point de vue une science qui n’est ni dure ni molle, mais résolument « souple », c’est-à-dire offrant une réelle plasticité. Dans ce contexte, on peut la considèrer comme résiliente et saillante. On pourrait même la voir – et la sentir – comme à fleur de peau, tenace même et disons-le, batailleuse voire impertinente.
Je me suis attaché à cette (haute) idée que cette discipline tient en définitive une place majeure dans notre existence et ce, c’est là toute l’ironie, sans la revendiquer nécessairement. Elle parvient assurément à rendre accessible, proche, ce qui peut sembler hors du regard et hors de portée. Elle fait écho, par les thèmes qu’elle manipule, au vécu, à notre quotidien. Simultanément, la discipline géographique est un hymne à la vie, une réalité presque charnelle qui renvoie à la totalité des sens.
Pour répondre plus précisément à la question, je me rattache à quatre champs disciplinaires : la géographie urbaine critique, de là où je suis parti en qualité d’africaniste ; la géographie critique du patrimoine et l’approche géographique du tourisme, là où je suis arrivé, avec un intérêt spécifique pour la valorisation du patrimoine culturel sensible, les lieux de mémoire ; et enfin à la discipline géopolitique qui met en lumière les jeux d’acteurs, les enjeux, représentations et territorialités encadrant le tout.
Toutefois, j’ai tendance à voir les choses de manière entière, non figée, sans prés carrés, bien que des sensibilités thématiques puissent logiquement s’exprimer. Car la géographie demeure une « science globale ». Centrée sur les jeux d’échelle et les jeux d’acteurs, mêlant synchronie et diachronie, c’est à ce moment-là qu’elle peut pleinement revendiquer son impertinence. C’est pourquoi je plaide, à l’instar du Professeur Jacques Lévy, pour une interdisciplinarité voire une post-disciplinarité.
Dans le champ universitaire, j’ai en outre à cœur de combiner mes axes de recherche à mon contenu pédagogique, ce qui s’apparente à une vraie source d’épanouissement. En la matière, il faut considérer la recherche, et plus encore la valorisation de cette dernière (elle-même prenant de multiples formes) et la didactique comme intrinsèquement liées, l’une questionnant et se nourissant sans cesse de l’autre.
Au final, je me rattache à une géographie ouverte qui est celle d’une science d’une action située, pour reprendre les termes de Paul Claval. Celle qui consiste à fournir à la société les « clés » en vue de la compréhension analytique, sans parti pris ni fausse pudeur, des phénomènes spatiaux par les sociétés avec, en filigrane, leur dignité, leur bien vivre… Soit une géographie qui ambitionne d’être citoyenne à l’intérieur d’environnements parfois incertains.
Quel a été le déclic de l’HDR ?
Lorsque je porte un regard sur le cheminement suivi, depuis ma qualification aux fonctions de MCF puis mon recrutement à l’UR en 2004, et le déclic survenu pour conduire ce travail, deux mots-clés surgissent : « maturation » et « envie ».
Je considère que la carrière universitaire peut être marquée par le « poids de l’habitude » et par des « équilibres stabilisés ». Le poids de l’habitude (ou sentier de dépendance) renvoie au fait que des singularités historiques, qui s’installent logiquement et qui sont justifiées à une période mais cessent d’être optimales ou rationnelles, parviennent tout de même à perdurer dans la mesure où les changer implique parfois un effort élevé (disruption douloureuse, crainte de l’inconfort inhérent, dynamiques auto-renforçantes). Et ce alors même que ce changement peut s’avérer salutaire. Cela éclaire, sans doute en partie, l’absence de résolution, du moins pendant une période, à me décider et à m’avouer qu’il était temps de franchir le pas et de m’engager dans un tel projet, adossé à une réflexion mûrie. Le rituel tend à rassurer, mais peut refréner tout dépassement.
La théorie des équilibres ponctués renvoie pour sa part à la fonction universitaire qui peut avoir tendance à s’équilibrer et à se stabiliser durant une période plus ou moins longue, où les évolutions sont très graduelles. Et ces équilibres stabilisés peuvent ponctuellement être bouleversés et se modifier brutalement (on parle alors de bifurcations surgissantes). À ce moment, la question est : quelles sont ces bifurcations qui font sauter les verrous ?
Il faut, je crois, parler de moments charnières. Me concernant, il s’agit de :
-
la réalisation du dossier de MCF hors classe qui a permis de mettre de l’ordre, de faire ce travail d’inventaire nécessaire à la constitution de repères dans mon propre parcours ;
-
le co-encadrement de doctorant(e)s (4 aujourd’hui en compagne de mes collègues, Mme Lamy-Giner, M. Jauze et M. Taglioni) et l’organisation de colloque (comme celui sur le Mozambique en 2018) qui ont véritablement fait prendre goût au fait d’impulser et d’encadrer la recherche ;
-
une longue mission de terrain dans trois États africains en 2019 (Tanzanie, Mozambique, Afrique du Sud) qui a été un moment décisif, où la pensée réflexive a été éprouvée et s’est affutée, sans doute par approche contrastive ;
-
enfin, je n’aurai pas pu rédiger ce mémoire d’HDR, je le concède, sans ce temps fondamental pour se poser, s’extraire des missions nombreuses qu’offre le milieu universitaire : en cela l’obtention d’un CRCT en 2020 fut primordiale.
Au final, le déclic se nourrit, je pense, à la fois d’une certaine maturité mais aussi d’un besoin de dépassement, celui de voguer vers de nouvelles aventures.
Quels sont vos objets de recherche ?
Je travaille sur la valorisation des « marges patrimoniales ». Le point de départ de ma recherche (décrit dans le volume inédit de cette HDR) est qu’il existe des objets patrimoniaux urbains ou associés à une urbanité se situant dans les marges, les écarts. Ils incarnent un « réservoir patrimonial ». Ce dernier se constitue de monuments divers, de sites ou de traces matérielles (accompagnés du récit qui les environne), et gagne à être mobilisé dans l’époque qui est la nôtre : celle d’un temps hypermoderne.
Parler de patrimoine (culturel me concernant) suppose aussi d’avoir une vision entière, holistique, des matériaux patrimoniaux. Cette dernière engage tangibilité et intangibilité (objet concret/abstrait) mais aussi régime de mobilité/d’immobilité (objet statique ou pouvant être déplacé), avec toutes les combinaisons possibles. C’est pour cela que je préfère parler « d’objet-lieu ». Comment, dès lors, définir cet objet de recherche ?
La marge patrimoniale réunit trois critères de mon point de vue :
-
Une idée de refoulement tout d’abord, associée à un contexte passé, sensible, pesant (dans ce travail tout ce qui se rattache à l’apartheid, à la colonisation, à la guerre civile…).
-
Une idée d’image de lieu ensuite, pas forcément très positive, connotée, ce qui convoque les effets de réputation voire d’évitement.
-
Enfin une idée de charge mémorielle : car il existe aussi un désir, voire un besoin sociétal de compréhension, de réappropriation, de réévaluation de ce passé riche et trouble : l’expression de « besoin patrimonial » peut ici être convoquée.
Afin de progresser dans ma démarche, des outils existants gravitant autour du champ du patrimoine culturel ont évidemment été mobilisés (cf. les travaux de V. Veschambre, de G. Di Méo). Ils expriment plusieurs réalités :
-
Une première réalité se nouant autour de l’idée de « dynamique » ; aucun objet patrimonial n’est stable ou figé, d’où le processus, la patrimonialisation, que nous affectionnons tout particulièrement, les géographes.
-
Une seconde axée autour du « décisionnel », de la notion de choix, ce qui induit un positionnement d’acteurs et une part de subjectivité, d’agenda politique.
-
Une troisième s’organisant autour de la potentielle « mise en tourisme » et qui conduit, dans le prolongement des travaux de M. Gravari-Barbas et d’O. Lazzarotti, à appréhender ensemble tourisme et patrimoine.
En somme, le corpus du travail adhère à une démarche itérative, par étapes, avec des tâtonnements et le fait de l’affiner constamment. In fine, les objets-lieux (au nombre d’une trentaine retenue dans ce travail) sont ceux de la marge ; ils peuvent subir un processus de réappropriation, de réévaluation (le recodage), dont les facteurs légitimant et interreliés sont : la touristification, la charge identitaire, le positionnement politique et les stratégies territoriales ; et il en ressort des impacts sur le terrain, organisés autour de phénomènes bien visibles de surdéterminations (la mémoire de faits notoires ou de personnages iconiques est instrumentalisée, des hyper-lieux ressortent…), mais derrière lesquels on voit poindre de nouvelles différenciations, à plus grande échelle cette fois.
Quels sont les principaux apports et résultats développés dans votre HDR ?
J’en dégagerai quatre.
Tout d’abord, des lieux-types se dégagent du terrain étudié, qui je le précise s’organise autour d’un triangle spatial ponctué par les métropoles de Durban, Johannesburg et Maputo. Ils dessinent une typologie. En intégrant patrimonialisation et mise en tourisme, des lieux dits « capsules », « arènes » et « circuits » ressortent.
-
Le premier renvoie à un monde muséal assez classique, clos, et se différencie essentiellement entre grands musées prestigieux et musées à dimension régionale/locale.
-
Le second renvoie à des immersions dans des espaces vivants, aux côtés d’habitants ou de performeurs ; on distingue ici tour de « village culturel ethnique » et visite des quartiers pauvres périphériques (comme les « township tours » en Afrique du Sud).
-
Le troisième renvoie à une logique nomade, sous forme de cheminements se cristallisant autour d’une communauté ou d’un personnage fameux (une figure totémique comme Gandhi au KwaZulu-Natal) ou bien d’un patrimoine architectural et monumental (tour de la baixa à Maputo).
Ensuite, ces lieux-types peuvent se combiner. Et parmi les prestations offertes localement, la présence de statues, rendant hommage à des personnages historiques, est souvent de mise. La rédaction de ce travail a été marquée par un contexte de forte mobilisation internationale autour de la contestation des statues (à la suite des émeutes parties des États-Unis après la mort de G. Floyd). L’impact médiatique fut considérable. Deux précisions à ce stade. D’une part, cet enjeu (et ces tensions parfois vives) existent depuis avant 2020 en Afrique du Sud (avec le mouvement Rhodes must fall opérant sur les campus). D’autre part, même si cela se fait davantage à bas bruit actuellement, la question n’est selon moi toujours pas apurée, les plaies restent vives. D’où un travail conduit sur une « échelle des crispations », soulevant des propositions. Il repose sur l’analyse critique des positionnements face aux monuments dans les pays étudiés. Je pars du principe que les contestations se nourrissent, ou d’un statu quo fragile qui peut être plus ou moins « aménagé » : on peut par exemple littéralement sécuriser le périmètre autour des statues ; ou d’une intervention résolue (de la puissance publique) qui ne fait que déplacer ou occulter le problème et ne le règle pas forcément : par exemple on va déplacer la statue. Car s’il faut condamner toutes formes de violences, il convient aussi d’entendre, de comprendre le malaise. D’où une étroite voie possible, qui peut amener vers un apaisement et dont les formes sont la recontextualisation du message ou le rééquilibrage statuaire. D’autres mesures existent sans doute pouvant enrichir ces scenarii d’évolutions.
Un troisième apport se tourne plus volontairement vers les structures muséales étudiées en ce travail, qu’elles viennent du passé ou qu’elles soient récentes et davantage en phase avec ce que les acteurs veulent donner à voir de leur territoire. En partant d’une déclinaison en quatre grandes formes des musées de sociétés (musée, musée en plein air, mémorial, centre d’interprétation), articulée autour de deux dominantes (émotionnel / pédagogique), on constate, d’une part, la grande variété des formes présentes dans l’espace étudié. Au-delà, des formes nouvelles se glissent dans les interstices, renvoyant à des combinaisons possibles. L’exemple qui me vient à l’esprit est la visite guidée des quartiers précaires : à Soweto, on alterne entre un espace vécu et ses formes d’art présentes dans l’espace public même (une sorte de musée à ciel ouvert) et un lieu mémorial à Orlando autour d’un évènement marquant : les émeutes des écoliers de 1976. Il en ressort une absence de cloisonnement, des glissements possibles et dès lors une hybridité muséale.
Un quatrième apport tente de répondre à la problématique de départ. Ces phénomènes de patrimonialisation des marges amènent-ils des impacts sur le terrain ? Et quelle est leur nature ? Une première réponse incite à penser que des processus de surdétermination de lieux et de faits sont apparents ; soit une standardisation. Des icones émergent aisément (N. Mandela, S. Machel…), des sites patrimoniaux incontournables également, de même qu’une mise en récit assez conventionnelle et qui s’inscrit dans une vision nationale. On pourrait parler d’un « patrimoine culturel du courant dominant ». Cependant le jeu d’échelle, si utile en géographie, pousse à relativiser ce premier résultat. Des différenciations (et donc une fabrique de la différence) deviennent visibles à grande échelle, lors de la confrontation avec le bassin de vie local. Des lieux sanctuarisés ressortent mais ils tranchent avec les environs ; le discours unitaire se confronte lui à la mémoire locale et produit des ambiguïtés.
Quelle méthodologie de recherche ?
J’adhère à la méthode hypothético-déductive où induction et déduction sont en rapport dialectique constant. Dans le cadre d’une démarche pragmatique et qui intègre la nécessaire part de sensibilité du sujet, j’associe ensuite sources premières et secondaires, dans une démarche qui demeure avant tout qualitative.
Ma recherche se fonde d’abord sur l’observation exploratoire directe externe. C’est-à-dire que je scrute ; c’est l’observation flottante, selon l’expression consacrée par C. Pétonnet (1982). Il est coutumier de dire que l’observation (du lieu abordé) est un moment clé, attendu et privilégié des chercheurs en géographie. La découverte du terrain est un passage sacralisé où l’environnement immédiat est minutieusement inspecté pour ne pas dire littéralement « absorbé » (en tout cas c’est l’image que je m’en fait…). La totalité des sens y est en émoi. Travailler sur des terrains étrangers africains s’avère qui plus est un stimulus incontestable, souvent gage d’inattendus et d’imprévisibilités. Une pratique que j’affectionne particulièrement, en lien avec la thématique du tourisme et du patrimoine culturel, est l’observation des visiteurs/acteurs présents en un lieu donné. Elle donne énormément à voir sur l’appréhension tierce d’un espace. En l’espèce, l’on apprend beaucoup du déroulement, par exemple des tours guidés, le regard, en pointillé, se faisant alors tangent. L’observation s’effectue le plus souvent avec support visuel (photographies) et carnet de terrain (ou à tout le moins via une prise de notes au terme de la visite de terrain), où elle prend le caractère « diffus » qu’affectionnent les anthropologues.
J’utilise également beaucoup l’observation participante, bien utile dans l’environnement patrimonial. Concrètement, elle vise à étudier, à titre d’exemple un groupe de visiteurs, en en faisant cette fois partie. Cela consiste à prendre part aux tours organisés en compagnie d’autres personnes. Le chercheur partage alors leur espace-temps en se faisant « accepter » tacitement par les membres éphémères. Il participe de la sorte aux pérégrinations, activités et discussions du groupe. Ce faisant, il se fait lui-même sujet dans une belle mise en abyme. Cette démarche permet une lecture des « ambiances », la sensibilité étant aiguisée, l’aspect sensoriel augmenté. Par un subtil jeu d’emboîtement, le chercheur devient une des composantes d’un tout : il dispose d’une position privilégiée.
Enfin, les entretiens et questionnaires tiennent une place fondamentale. Cette source d’informations s’effectue auprès de personnes-ressources préalablement identifiées. C’est une étape clé de la recherche de terrain. L’acteur, spécialiste dans son domaine, devient la caution morale ou scientifique qui viendra nourrir, éclairer, contredire les hypothèses de départ. Outre l’entretien direct, l’entretien déambulatoire est d’usage fréquent sur mes terrains d’étude, du fait des thématiques abordées. La discussion se noue sur le lieu même, le chercheur devant jongler entre sa trame de questions – afin de n’ôter aucune spontanéité – et les traits saillants du décor ainsi que les péripéties du moment. Ceci amène le propos à naviguer d’un point à l’autre, commencer puis s’interrompre.
En quoi l’HDR est-il un exercice compliqué ?
C’est un exercice passionnant mais, je ne le cache pas, délicat et très exigeant. Déjà par rapport aux raisons évoquées précédemment : soit se faire violence à un moment donné afin de s’extraire de sa zone de confort ; dresser de nouvelles perspectives et imaginer l’après. On regarde derrière, on s’ancre et on envisage les projections possibles.
Tout cela s’opère en continuant à gérer ses missions pédagogiques et administratives qui peuvent être chronophages et à flux tendus à certaines périodes. En somme s’extraire d’un environnement prégnant pour se consacrer exclusivement à un autre. Et quand le temps de la rédaction est achevé, il faut encore gérer toute la partie administrative (les étapes de l’inscription à l’HDR au sein de son Université) ainsi que l’organisation de la soutenance. Même si on est très bien aidé à ce niveau, elles génèrent une grosse charge mentale.
Mentionnons aussi le fait d’accepter (ou de ré-accepter) l’idée que l’on sera finement évalué, critiqué ce qui fait évidemment partie du jeu universitaire.
Enfin, la démarche traduit une nécessaire introspection, un effort de compréhension sur son parcours, son itinéraire, sa carrière et qui demande de l’investigation (presque du travail archivistique…) ainsi qu’un effort de mise en perspective (savoir prendre de la hauteur… sur soi-même) et cela n’est jamais un exercice très aisé.
Quel encadrement doctoral ?
Je co-encadre actuellement quatre étudiant(e)s inscrit(e)s en thèse.
Tout d’abord la doctorante Margaux Malsan (OIES-CREGUR). Le Directeur de thèse est J.-M. Jauze. Son sujet de thèse porte sur la « Gentrification et politiques publiques : des pratiques habitantes au rôle des politiques publiques ». L’étude aborde la confrontation – et ses singularités inhérentes – du concept de gentrification au sein des espaces ultramarins (avec une application à l’île de La Réunion), à travers deux quartiers urbains : Carosse à St-Gilles (commune de St-Paul) et Terre Sainte situé dans la commune de Saint-Pierre. Elle questionne le rôle et les postures des acteurs pouvant susciter et accompagner le processus.
Je co-encadre ensuite la doctorante Lauriane Verhoog (OIES-CREGUR). Son Directeur de thèse est F. Taglioni. Le travail porte sur : « Territoire et identité : L’implication de la pensée culturelle sur l’organisation sociospatiale dans deux PMA de l’océan Indien – Concilier appartenance culturelle et développement à Mahajanga, Madagascar et à Inhambane, Mozambique ». Il interroge les temporalités précoloniales, coloniales et post-indépendantes au sein de l’environnement urbain de ces deux espaces, pour l’un situé en Afrique australe, pour l’autre dans le Sud-Ouest de l’océan Indien. Sont également analysés leurs impacts spatiaux, tant à l’échelle nationale que locale. Son objectif est de questionner l’hybridité des liens identité-développement.
Plus récemment et en compagnie de M.-A. Lamy-Giner (en tant que Directrice de thèse), je co-encadre deux autres doctorants sur le terrain africain.
Tout d’abord Albano Brito (OIES-CREGUR) sur le sujet du « retour aux armes au Mozambique : contextes géopolitiques et enjeux socio-spatiaux ». Ce travail doctoral mêle Géopolitique et Sciences politiques et se penche sur les ressorts spatiaux et temporels des tensions et conflits récents au Mozambique, qu’ils soient le fait des groupes rebelles de la Renamo comme des mouvements djihadistes au nord. Le projet s’inscrit dans le Programme INTERREG V Océan Indien qui vise à renforcer l’insertion régionale de La Réunion et de Mayotte dans l’océan Indien et de répondre aux enjeux de co-développement des pays de la zone, ainsi que d’accroître le potentiel international de recherche et d’innovation dans la zone. Il est appuyé par l’ambassade de France au Mozambique et en Eswatini.
Enfin Léo Abgrall (OIES-CRESOI), dont le sujet concerne la « Géohistoire du braconnage dans le parc transfrontalier du Grand Limpopo, enjeux politiques et spatiaux de la protection et de la gestion ». L’étude est menée dans le parc transfrontalier du Grand Limpopo, composé du parc national Kruger (Afrique du Sud), du parc national Limpopo (Mozambique) et du Gonarezhou (Zimbabwe). Elle cherche à comprendre comment le braconnage se produit dans le parc et quels sont ses principaux impacts. Sont ici étudiées les différentes politiques de conservation et de lutte contre le phénomène depuis 2001, dans le but de créer un modèle de conservation.
Nul doute que ces co-encadrements ont été et sont pour moi une expérience des plus enrichissantes, qui n’est absolument pas pour rien dans la conduite de cette HDR. En effet, c’est par le suivi et les échanges exigeants avec ces doctorants, sérieux et motivés, que s’est sans doute forgée cette volonté mûrie de diriger la recherche (laquelle se nourrit, de surcroît, des comités de thèse et de la direction, plus ancienne, d’étudiant(e)s du Master Géographie).