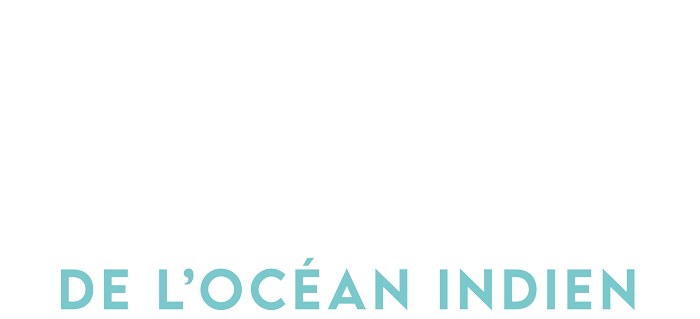L’île est, on le sait, le site des utopies, de Platon à Houellebecq, en passant par Thomas More, Campanella, Daniel Defoe et tant d’autres, l’espace insulaire devenant ainsi la métonymie et/ou la métaphore du site habitable ou inhabitable, à la mesure ou à la démesure des hommes (surtout, plus que des femmes), dans la consonance ou l’impossibilité des rapports entre les humains et le monde matériel. De même que l’utopie littéraire a, semble-t-il, besoin de l’île, de même l’île aurait besoin de l’utopie, en particulier l’île créole. Celle-ci, en effet, déserte jusqu’au XVIe siècle, sauf dans les Caraïbes, souffre d’une absence de mythes de fondation, est en déficit d’origines, et l’élaboration complexe d’un « en commun » au cours de l’histoire est liée à des processus conflictuels de créolisation et, de ce fait même, sans cesse remise en question. L’île créole indianocéanique, minuscule et relativement éloignée des continents qui bordent l’océan Indien, vit, peut-être davantage que d’autres îles créoles, une relation difficile avec l’espace qui l’entoure – l’océan – et les représentations qui la constituent comme morcelée, en manque d’archipel, absente de tout regard.
En décembre 2012, alors que, selon certaines prophéties mayas, la fin du monde était annoncée comme imminente, l’organisme chargé du tourisme à l’île de La Réunion développait sur les murs des couloirs du métro parisien une campagne dont le message était à peu près celui-ci : « venez attendre la fin du monde dans un authentique paradis ». Le même organisme avait aussi axé sa stratégie de communication depuis plusieurs années sur une représentation de l’île créole comme celle de tous les métissages et de l’harmonie interculturelle, pendant que l’île Maurice adoptait le slogan « une nation arc-en-ciel » qui remplaçait l’ancien mot d’ordre de l’après indépendance, « inn sél lépép inn sél nasion »1. Toujours en 2012, l’UNESCO intégrait au patrimoine naturel de l’humanité les Hauts de l’île de La Réunion sous l’intitulé « Pitons, cirques et remparts », après avoir inscrit sur sa liste représentative du patrimoine immatériel la montagne du Morne2 et l’Apravasi Ghat3 de l’île Maurice. Pour ces deux derniers cas, deux espaces mythiques étaient à la fois valorisés et séparés, celui des Marrons en ce qui concerne le Morne, celui des Mauriciens d’origine indienne pour l’autre. À La Réunion, les « Pitons, cirques et remparts » étaient purement et simplement renvoyés à une dimension matérielle et naturelle – des montagnes, des abîmes, des effondrements volcaniques –, ce qui permettait d’effacer de la mémoire et de la représentation collectives les traces et l’histoire des guerres entre les marrons et les milices – « détachements » – au service de l’ordre esclavagiste, les anciens sentiers de guérilla4 étant désormais parcourus par les randonneurs et les compétiteurs internationaux du « grand raid » et de « la diagonale des fous ».
La littérature prend en compte ces représentations et ces interrogations qui, semble-t-il, pourraient se ramener à cette simple question : comment vivre malgré tout lorsque les conditions du vivre – seul, en communautés séparées, ou ensemble – ne sont guère réunies ? Les légendes, les mythes, les utopies sont des réponses possibles, que les récits renvoient à un âge d’or d’avant les catastrophes liées au fait même d’habiter et proposent des généalogies grandioses ou rassurantes, ou bien qu’ils préfigurent des avenirs apaisés et un espace non seulement partagé mais parcouru ensemble.
« Utopie » est ici pris dans un sens très large, suivant en cela la proposition de Norbert Elias :
[…] une utopie est la représentation imaginaire d’une société, représentation contenant des propositions de solutions à des problèmes non résolus, bien particuliers, de la société d’origine, à savoir des propositions de solutions qui indiquent les changements que les auteurs ou les porteurs de cette utopie souhaitent ou bien les changements qu’ils redoutent, voire peut-être les deux à la fois5.
Les littératures des îles créoles de l’océan Indien ou sur ces îles proposent ainsi des scénarios utopiques qui s’affrontent. On pourrait retrouver ici, dans une perspective un peu différente, l’hypothèse avancée par Jean-Michel Racault. Confrontant les notions de « créolisation » et de « métissage », il suggère que « la première [met] l’accent sur la coupure géographique et culturelle imposée par la distance qui sépare de sa métropole une colonie en voie d’autonomisation, la seconde sur le renouvellement résultant de la diversité des apports ethno-culturels »6. Mais, dans les deux cas, il s’agit bien de fonder quelque chose à partir de ce qui est conçu comme n’ayant pas réellement de fondation sur le lieu créole lui-même. Que cette tentative de fondation repose sur le conflit ou l’harmonie ne change rien ; l’utopie consiste à vouloir donner du sens à ce qui est perçu comme étant insensé, à vouloir s’approprier ce qui a été imposé, à transformer le dehors en dedans, la perte en profit. En ce sens, les différents scénarios ou discours correspondent à ce qu’Annie Le Brun perçoit de l’entreprise littéraire, politique et philosophique sadienne : « […] bâtir un monde à partir de ce qui est en train d’être mis au ban du monde »7. Et, peut-on ajouter, à partir de ce qui est toujours, quelle que soit la période historique, en train d’être mis au ban du monde et de l’histoire.
Cet article se veut être à la fois une généalogie et une cartographie de ces récits et des poèmes qui s’efforcent de construire la possibilité d’habiter une île créole. Le corpus choisi comporte uniquement des textes francophones sur lesquels on s’appuiera pour montrer les modalités littéraires et idéologiques de cette utopie et de son impossible effectuation.
Dans les récits des premiers voyageurs, l’île créole est représentée comme un espace édénique. On retrouve ces caractéristiques chez Thomas Herbert, Carpeau du Saussay, François Leguat, Flacourt. Ce dernier définit déjà La Réunion comme un paradis terrestre. Duquesne, qui souhaite que les protestants victimes de la politique de Louis XIV créent une république huguenote à Bourbon, constitue, quant à lui, un dossier dans lequel il compile les descriptions les plus enchanteresses fournies par les récits disponibles. Dans sa « description particulière de l’île d’Eden », il explique qu’il a retenu cette appellation « comme lui convenant le mieux, parce que sa bonté et sa beauté la peuvent faire passer pour un paradis terrestre […] »8. Quant à Leguat, qui est l’un des rares à avoir tenté l’aventure proposée par Duquenne, il décrit ainsi l’île Rodrigue :
L’air de Rodrigue est admirablement pur et sain, et une grande preuve de cela, c’est qu’aucun d’entre nous n’y a été malade pendant les deux années du séjour que nous y avons fait, nonobstant la grande différence du climat et de la nourriture. […] L’air est riant et serein, et les chaleurs de l’été sont fort modérées, parce que, précisément à huit heures du matin, il se lève tous les jours un petit vent nord-est ou nord-ouest qui rafraîchit agréablement l’air et qui, tempérant la plus ardente saison, fait que l’année entière est un printemps et un automne continuels, sans qu’aucun de ces temps mérite le nom d’hiver ; aussi peut-on s’y baigner toute l’année. Les nuits ont une fraîcheur douce et restaurante. […] Elle n’est, comme je l’ai déjà remarqué, qu’un continu d’agréables coteaux tout couverts parfaitement de beaux arbres dont la verdure perpétuelle est tout à fait charmante. Ces arbres sont rarement embarrassés de broussailles, et ils forment quelquefois très heureusement des allées naturelles qui, en garantissant des ardeurs du soleil, forment en même temps une perspective qui est merveilleusement embellie par la vaste étendue de mer qu’on entrevoit quelquefois au travers de leurs troncs élevés et unis9.
Quant à Bernardin de Saint-Pierre, alors qu’il fait de l’Isle de France un lieu abominable et invivable, il déclare à propos de l’île voisine, qu’il connaît à peine, « Bourbon par ses rivages escarpés est propre au bonheur »10. Cette dimension édénique, on la retrouve partiellement dans l’habitation de la « petite société » de Paul et Virginie, puisque le jardin de Paul a tout d’une réplique sur terre du jardin originel, et même d’un jardin sans fruit défendu puisque la connaissance n’est pas ici objet de désir et qu’aucun serpent ne se cache dans le labyrinthe. D’ailleurs cette similitude avec le jardin d’Éden est explicitement rappelée par le narrateur :
[…] l’amour, l’innocence, la pitié, développaient chaque jour la beauté de leur âme en grâces ineffables, dans leurs traits, leurs attitudes et leurs mouvements. Au matin de la vie, ils en avaient toute la fraîcheur : tels dans le jardin d’Éden parurent nos premiers parents, lorsque sortant des mains de Dieu, ils se virent, s’approchèrent, et conversèrent d’abord comme frère et comme sœur ; Virginie, douce, modeste, confiante comme Ève ; et Paul, semblable à Adam, ayant la taille d’un homme, avec la simplicité d’un enfant11.
Ce qui caractérise aussi l’éden insulaire chez Saint-Pierre, c’est sa capacité à dépasser les contraires, à être, conformément à ce qu’il développe dans les Études de la nature, dans l’harmonie12. Ainsi, en est-il, par exemple, de la nature du sol du « bassin » dont le narrateur de Paul et Virginie dit que « Le fond de ce sol est si rempli de roches et de ravins, qu’à peine on y peut marcher ; cependant il produit de grands arbres, et il est rempli de fontaines et de petits ruisseaux »13.
Mais l’île est édénique avant tout pour des raisons matérielles. Le voyageur qui y débarque vient d’affronter des mois de voyage en mer dans des conditions peu agréables. Le navire, que Michel Foucault définit comme l’espace hétérotopique par excellence, est un locus horribilis. Après la traversée, lors de laquelle le sujet a éprouvé la négativité du monde, l’île est le lieu, le bon lieu. Pierre Auriol note, à juste titre, à propos des voyages de James Cook que :
La terre dont on s’approche, ce peut être l’inconnu tant désiré que l’on va enfin découvrir mais c’est souvent, plus prosaïquement, le havre qui va permettre de refaire le plein en eau et de reconstituer l’approvisionnement en vivres frais afin de contrecarrer les risques de survenue de cette maladie [le scorbut] qui a tout pour terrifier : ce lent dépérissement des fibres mêmes du corps, cette sourde consomption qui engourdit les membres avant d’entraîner le gonflement des tissus et provoquer la chute des dents, n’ont pas la soudaine évidence, somme toute rassurante, de la blessure ou de la plaie ouverte14.
Si l’île est ainsi propre à occuper dans les imaginaires européens la place d’un éden, c’est aussi que, dans la Bible, ce dernier est déjà défini comme une terre entourée d’eau. Et comme le signale Arlette Girault-Fruet, le XVIIe siècle situe aussi le paradis terrestre dans une île de l’océan Indien, au large de Ceylan15. Dans ces récits, en grande partie influencés par un tel imaginaire, les richesses de l’île/éden sont inépuisables, ce qui, du coup, provoque l’étonnement et la déréliction lorsque, du fait de l’homme, les richesses en nourriture et en arbres s’épuisent, que les bêtes nuisibles, comme les rats débarqués des bateaux, prolifèrent. L’île créole correspond donc exactement au topos du locus amoenus. À la suite de bien d’autres, Arlette Girault-Fruet rappelle que :
À l’origine, l’amoenus locus est la référence fondamentale de toute description de la nature, depuis l’époque de la Rome impériale jusqu’au XVIe siècle. […] Le lecteur qui s’étonne d’une description initiale si conventionnelle, se trouve en réalité devant un voyageur qui tient, avant toute chose, à ce que l’île soit la concrétisation de ce qu’il a appris à considérer comme le lieu de plaisance idéal, qui dispensera sans effort les joies dont il est sevré depuis si longtemps16.
L’auteure signale que « ces composantes, toujours les mêmes, appartenaient déjà à la tradition homérique »17. Le paysage idéal est ainsi constitué d’arbres, de forêts, de ruisseaux, de sources, de prairies, de chants d’oiseaux, de parfums, de fruits, de printemps éternel. « L’amoenus locus incarne donc, aux Mascareignes, le lieu de la surabondance, il est l’indice insistant d’une nature impétueuse, suréminente, dont la véhémence entre en résonance avec les transports du voyageur qui retrouve la terre »18.
Mais il y a aussi des raisons historiques. Comme le rappelle Pierre Auriol :
le voyage n’a jamais connu un quelconque âge d’or, n’a jamais été porté par l’innocent désir de se vouer à la recherche de calmes lointains. Il est le produit de l’expansion territoriale, de l’oppression, de l’histoire. Il est provoqué par la guerre et non par le candide souci de sacrifier à l’attirance de l’ailleurs19.
On sait que l’extase de Christophe Colomb devant les merveilles des îles Caraïbes est suivie d’une prise de possession, du massacre des autochtones, de la mise en branle de la gigantesque et multiséculaire machine de la traite négrière et de l’esclavage20. On sait aussi que l’entrée de Vasco de Gama dans l’océan Indien transformera la très ancienne route des échanges commerciaux et de pèlerinage entre l’Afrique, le golfe persique et l’Asie21 en un espace de sanglante prédation, d’assujettissement et de destructions.
En ce sens toute utopie coloniale lie en grande partie prise de possession et prédation. Il est ainsi loisible d’étendre à l’ensemble du désir utopique colonial ce qu’Annie Le Brun dit du parcours de Léonore et de Sainville dans Aline et Valcour de Sade :
[…] à l’inverse de ce qu’il a fait avec Les Cent vingt journées de Sodome, Sade opère à ciel ouvert, et même dans la transparence des après-midi idylliques du meilleur monde, ou mieux encore sur l’horizon ouvert par la vitesse du voyage. Car les deux tours du monde, en sens inverse, de Léonore et de Sainville, partis à la recherche l’un de l’autre, sont loin d’être seulement une drôlerie : ils déterminent aussi l’ampleur de la scène et du mouvement que Sade a ici choisi de donner à sa quête. […] La noirceur qu’il avait travaillé à isoler à l’intérieur du laboratoire de Silling, voilà qu’il la remet en circulation, lâchant dans le monde les êtres de proie qui en sont porteurs22.
Mais le départ hors de l’Europe vers des terres lointaines s’inscrit aussi dans une histoire de guerres, de meurtres de masse, de violences sur le sol européen lui-même, qu’il s’agisse de la Reconquista espagnole, des guerres portugaises ou de la guerre de religions en France, comme elle s’inscrit dans une histoire de pauvretés, d’exploitation et de misère. Partir vers les terres lointaines « pour y trouver du nouveau », c’est aussi quitter l’Europe, ne serait-ce que pour quelque temps, même si c’est pour, par un paradoxe apparent, la reconstruire partiellement et imaginairement à la manière de Robinson Crusoé et préparer ainsi les « missions civilisatrices » à venir. Pierre Auriol note que :
Seuls les héros de voyages imaginaires, ceux de Rabelais, de Swift ou encore de Restif de la Bretonne, parviendront à contourner la malédiction de la violence. Pour cette tradition littéraire, voyager n’est pas quitter mais s’installer d’un coup, ou presque, en dehors d’une histoire, celle du continent européen, et découvrir d’autres histoires. À l’écart de l’Europe, existent d’autres terres qui, lieux de tous les possibles, déroulent là-bas des splendeurs inconnues et de merveilleuses bizarreries23.
En ce sens, l’île bienheureuse est, avant tout, un espace textuel, situé dans « l’espace de la bibliothèque et de la mémoire »24. Selon la formule de Pierre Auriol, « voyager revient à déplier la figure de rhétorique de l’antithèse qui oppose la terre du possible, l’île, au continent européen voué à l’histoire et à la répétition du malheur »25. C’est, selon une perspective un peu différente, ce que déclare Raphaël Barquissau à propos de l’espace insulaire décrit et raconté par Bernardin de Saint-Pierre dans Paul et Virginie : « Une alchimie secrète travaille en lui les matériaux de ce passé. L’Isle de France se transfigure : elle devient un paradis perdu qu’il peuplera de ses chimères »26.
On retrouve, d’une certaine façon, ce locus amoenus, mais spatialement déplacé à l’intérieur même de l’île qui a perdu depuis longtemps ses mystères et ses merveilles, dans les souvenirs et récits d’enfance de la bourgeoisie réunionnaise du XXe siècle. Le poète réunionnais Jean Albany, dans Vavangue, récit d’une pérégrination dans l’île à la découverte de la flore et des mots de son enfance, s’exclame ainsi :
Mon éden…
Ma terre natale27.
Un peu plus tôt, il avait noté que « L’arrivée à Gillot tient du mystérieux. On devine à peine ce que j’appelle le doigt de Dieu surgi de l’océan Indien »28.
Dans ces récits et poèmes d’écrivains insulaires du XXe siècle, l’espace idéal est devenu celui des Hauts, autrefois lieu de terreur et d’horreur en raison de son climat et de la présence des Marrons. Ainsi, Raphaël Barquissau, dans son récit d’enfance et d’adolescence, présente les Hauts comme l’espace des vacances, du « changement d’air » où écrit-il, « le Blanc […] se revigore librement, loin des yeux des Noirs, au contact de la vie sauvage »29. Se reconstitue donc là le mythe de l’éden des premiers jours :
On mangeait à des heures impossibles, on manquait de bien des commodités, on était les uns sur les autres, on s’isolait, faute de W.C., dans les pignons d’Inde où grimpait la vanille ou dans les buissons épineux de corbeilles d’or, dites galabers du nom de leur malencontreux introducteur, qui envahissent dans l’île tous les terrains vagues ; mais on était presque toujours dehors, sauf par la pluie ; on respirait un bon air revivifiant et l’on jouissait pleinement d’une vie plus libre au contact de la nature30.
Mais, quelque soit l’endroit, il demeure de la rêverie d’Éden la dimension sensuelle. Barquissau écrit ainsi :
Sans être la Nouvelle-Cythère de Bougainville, l’heureux climat de l’île, la mer qui l’entoure de cette frange d’écume où naquit Aphrodite, le feu volcanique qui l’a formée et d’où jaillit encore la lave, l’arôme de ses feuillages, la saveur musquée de ses fruits, tout y incite à la volupté31.
Ce topos de l’île sensuelle, incitant à la sensualité, est aussi signalé en filigrane dans Paul et Virginie à propos de la relation qui existe entre Marguerite et Mme de la Tour :
Seulement, si d’anciens vœux plus vifs que ceux de l’amitié se réveillaient dans leur âme, une religion pure, aidée par des mœurs chastes, les dirigeait vers une autre vie, comme la flamme qui s’envole vers le ciel lorsqu’elle n’a plus d’aliment sur la terre32.
Comme le rappelle Arlette Girault-Fruet, cet amoenus locus est l’exacte antithèse de l’océan :
la précipitation avec laquelle le voyageur prétend reconnaître l’amoenus locus dans le rivage insulaire avant même l’atterrage parfois, montre clairement qu’il veut faire échec aux démons qui peuplaient l’océan, rompre physiquement et mentalement avec le locus horribilis qu’il laisse derrière lui pour renouer avec la vie, sans restriction ni réserve33.
C’est pour cette raison que, dans sa lecture de Paul et Virginie, lecture qui en apprend plus sur les fantasmes de l’auteur que sur Bernardin de Saint-Pierre, Raphaël Barquissau déclare que le monde insulaire, qui « cristallise autour d’une Ève centrale le monde primitif et presque édénique où Bernardin va faire revivre son éternelle chimère d’une société idéale »34, est celui d’une utopie et même d’une « attendrissante utopie »35 :
Ce n’est ni la France, ni l’Europe, ni les Isles qu’il habite : c’est l’Utopie. Le mot semble fait pour lui. « Ou topos ». Point de lieu réel. La quatrième dimension. Il se crée un paradis qu’il peuple des amis qu’il se forge. Et lui-même y joue le rôle qu’il veut.
Comme on peut le noter, cette image de l’île créole comme éden – image qui sera fortement contestée, ainsi qu’on le verra, par les poètes réunionnais de la fin du XXe siècle –, ce topos qui invente littéralement et littérairement l’île, est une production extérieure, européenne, même si elle sera reprise, pour être prolongée ou rejetée, par les écrivains insulaires eux-mêmes. D’une certaine façon, bien entendu, cette notion d’éden insulaire s’élabore en contrepoint d’un autre espace, qui est l’espace continental de départ, c’est-à-dire l’Europe. Ce n’est pas pour rien que Bernardin de Saint-Pierre se sent obligé de préciser à l’ouverture de son roman que le monde dont il parle est situé « derrière le Port-Louis de l’île de France »36. De même, il oppose le désir d’isolement de ses personnages aux habitudes des Européens qui ne rêvent que de richesse et de gloire :
[…] mais dans cette île, située sur la route des Indes, quel Européen peut s’intéresser au sort de quelques particuliers obscurs ? Qui voudrait même y vivre heureux, mais pauvre et ignoré ?37
Le mouvement de bascule s’opère, en effet, à partir du moment où le récit de l’île cesse d’être ressenti comme une projection extérieure et est récupéré par les insulaires pour faire de l’île le point d’où s’origine toute vision du monde, du monde extérieur à l’île et d’abord du monde insulaire, et de ce qui le fonde. Comme le relève Guilhem Armand, il s’agit de passer d’une « vision européocentrée plaquée sur une altérité encore méconnue à une mythologie véritablement ancrée »38. Fonder l’île comme l’origine du point de vue implique que cette fondation inscrive une pluralité d’univers culturels ou même un seul. L’île devient ainsi le monde, comme l’écriront au XXe siècle des poètes aussi différents que Jean Albany ou Jean-Henri Azéma39. Car, comme le note Cédric Mong-Hy, « l’île est la forme de chaque chose : de l’humain, du sol, de la Terre entière, vaisseau spatial sur les flots de l’espace sidéral »40. Ainsi, dans la présentation de la collection « La Roche écrite » des Éditions Grand Océan, Jean-François Reverzy écrit :
Restent encore à découvrir les Lettres vives de l’hémisphère sud et ce qui vient y résonner de la sagesse des continents perdus : Atlantides, Lémuries ou patries premières de l’Humanité que font revivre en leur œuvre d’écriture les poètes, grands initiés des transferts insulaires.
Mais déjà le roman de l’époque coloniale avait opéré ce transfert pour proposer son propre récit de fondation, instaurer sa propre utopie. Déjà les « romans du marronnage » du début du XIXe siècle, quelle que soit leur idéologie explicite, instaurent l’utopie d’une souveraineté marronne dans les Hauts de l’île, royaume, dictature ou république, conformément à ce qu’avait déjà perçu Sade41. Marius-Ary Leblond, quant à eux, construisent, au début du XXe siècle le récit des cirques comme espace de la régénérescence de la race blanche, thème développé en particulier dans Le Miracle de la race (1924). Mais, dans les années 1950, dans la continuité du roman colonial, Claire Bosse publie un roman, Colonisation de l’île Bourbon ou l’idéal amour42, qui se présente comme la version heureuse, du point de vue des Blancs, de Bourbon pittoresque, le roman inachevé d’Eugène Dayot (1848). Le récit de Bosse reprend les caractérisations racialisées et racistes des marrons, qualifiés par exemple d’« absolus sauvages »43, de « hordes barbares »44, de « loups avides »45. En contraste, l’auteur parle de « la vie paisible et souriante des habitants civilisés du littoral », qui jouissent de « l’éternel printemps de l’île ». Mais, en même temps, le monde marron reprend le topos de l’éden. Ainsi le lecteur apprend que :
Les noirs marrons […] chassaient les innombrables oiseaux des forêts, pêchaient poissons et tortues, cherchaient le « miel vert » abondant et savoureux des « mouches » (abeilles), enfin jouissaient largement des richesses de cette belle nature exotique, florissante et neuve46.
Bien entendu, la nature y est merveilleuse47 et même les cyclones les plus violents ne laissent pas de traces48. En réalité, ce texte, qui inscrit la longue guerre entre deux utopies racialisées et de classe, celle de la souveraineté marronne dans les Hauts et celle des maîtres sur le littoral, propose de fonder la possibilité d’habiter l’île sur un génocide. Pour pouvoir vivre « sous le ciel si beau de cette île de lumière »49, la seule solution est l’extermination de masse des marrons. La capture et la mort de ces derniers, autrement dit l’éradication totale du marronnage, sont présentées comme la condition du « bonheur sans nuages » de l’île : « L’île entière est libre, libre ! », s’écrie Jean, le personnage principal du roman50. Et, s’adressant à Mathurine, ancienne marronne redevenue esclave par affection maternelle pour une jeune Blanche enlevée par les marrons et qu’elle a sauvée, Françoise, l’héroïne du récit, lui dit : « Tu resteras près de la fille blanche que tu as sauvée d’un sort atroce. Nous aurons, si Dieu le veut, de longs jours de bonheur à vivre ensemble »51.
Cette possibilité que l’éden repose sur un massacre est une position extrême. Mais cela signale clairement à quel point l’utopie d’habiter renvoie à une guerre, un affrontement sans cesse recommencé, ouvert ou souterrain. Par définition, en réalité, l’éden est toujours déjà perdu au moment de son énonciation ; c’est, dans le texte biblique fondateur, le souvenir d’un lieu disparu, avant que les humains n’en aient été expulsés, et, dans le discours insulaire, quelque chose qui n’existe qu’à travers la nécessaire élimination de ce qui l’empêche de se concrétiser. Ce n’est pas pour rien que, chez Thomas More, l’île est un espace détaché d’un continent, et « coïncide avec la reconnaissance d’un espace autre dans le monde », comme le relève Jean-François Géraud qui signale par ailleurs que, dans la cosmographie de l’époque, « chez Thevet, chez Wells, les îles sont les embryons, les semences de futures terres, de futurs continents »52. Jules Hermann s’en souviendra et inversera la proposition avec son mythe de la Lémurie53, ce continent primordial, civilisé à l’extrême, dont l’île créole indianocéanique est l’héritière. Quant à Boris Gamaleya et à Riel Debars, poètes de la fin du XXe siècle, ils couperont l’île de tout continent : elle surgit de l’océan, du liquide, du mouvant. On pourrait donc imaginer, dans ce dernier cas, qu’elle ne serait en perte ou en deuil de rien. Mais, chez ces deux poètes, on le verra, la problématique se déplacera : si l’île n’est en deuil d’aucun continent ni même d’aucune origine, elle est mélancolique en raison de l’impossible habitation dont elle avait rêvé.
Au début du XXIe siècle, dans une posture post hermannienne et post gamaleyenne, le poète Nicolas Gérodou va, quant à lui, fonder l’utopie d’habiter sur le souvenir, la reprise, la reconcrétisation de l’utopie marronne54. Son texte va tisser ensemble la geste de tous les habitants, hors ligne de couleur, présentés comme marrons : Malgaches, Africains, Quivis, Indiens… Le marronnage cesse d’être ici un moment historique pour devenir le signe d’une posture de résistance et de création discontinue fondée sur le lieu. Il s’agit de retrouver « le pays dérobé » et, par là-même, de reconstruire l’accord des insulaires, même après la mort, avec la nature55, à travers, entre autres, le secret des noms de l’origine malgache, makoua, tamoule… Il s’agit, en somme, de rendre les habitants attentifs à la présence56, et de refaire le tissu défait de l’île après la mise à mort des marrons :
Désenchantés, les grands bois depuis lors se murent, s’ils n’entendent les mots conjurés : liane qui empoisonne les meutes, mafatamboua. Figuier-pieuvre, né sur la branche ou la muraille, étranglant l’hôte : c’est l’afoutse. Barbelés infranchissables sont lianes pattepoule tressées ensemble, ou liane croc-de-chien à hauteur de gorge. Sans merci la sève de l’arongue, où trempent les sagailles. Feuilles pitaclées du bois de pintade, pour se muer en roche, la tête sous l’épaule : ce sont paroles du vieux57.
C’est toute la forêt qui demande Laverdure à celui qui passe dans les chemins oubliés, et tu voudrais murmurer Sarlave pour délivrer l’éperdue, pour faire nouer les fleurs en deuil de celui-là58.
Le second texte de « Tombeau de Mafate », fait ainsi de ce dernier le témoin de l’histoire géologique de l’île jusqu’à l’arrivée des hommes et « la réunion des destins » :
Ce fut enfin le tour des hommes, des colonies, des marronnies, et de la longue guerre civile. Mafate contempla l’histoire commune, et la réunion des destins : des sept, le dernier-venu, le premier-né, le sans-tombe.
Le cercle des montagnes honore son nom.
Mais cette volonté d’instaurer le lieu dans la reprise de son pluriel pour y vivre dans la consonance, pour l’habiter, met malgré tout entre parenthèses la guerre des utopies et de leur nomination. A contrario, Roger Théodora, dans sa volonté de trouver une origine non européenne, sinon à l’île, du moins à sa nomination, va pousser jusqu’au bout les propositions étymologiques de Jules Hermann. Il lit ainsi dans « Mascareignes », non pas le nom d’un navigateur portugais, mais une origine malgache. Selon lui, « ilhas masca remhas », signifierait « îles cachées (couvertes) par des forêts »59. En bon continuateur de Jules Hermann, il va chercher derrière chaque toponyme une origine malgache. Il écrit, par exemple :
Les Malgaches avaient donc une connaissance plus qu’honnête de cet archipel. Et je ne pus m’empêcher de tenter de décrypter les autres noms pouvant désigner les Mascareignes. Tirizaha pouvait avoir été repris de tery, « là-bas, très loin » et de zaha, « action de regarder, de considérer, de chercher » : qu’on voit de loin. […] Le nom Cirné ou Syrné sur l’origine duquel les hypothèses de North Coombes n’avaient pas abouti, pouvait venir de Tsirihina qui signifiait « être regardé »60.
Chez Théodora, il s’agit clairement, à travers la recherche d’une origine malgache de l’île et à travers l’affirmation selon laquelle l’île était habitée avec l’arrivée des Européens61, de remettre en question la légitimité du geste colonial fondateur. Comme le signale Jean-François Géraud,
la modélisation de l’espace par l’utopie révèle à la fois la capacité à produire de l’espace et à le reproduire, c’est-à-dire fonde le concept de colonisation. […] cette production/reproduction spatiale, c’est-à-dire cette colonisation, suppose la disparition de toute liberté par le totalitarisme évoqué par More, et débouche […] sur la réalité de l’esclavage et l’hypothèse du génocide62.
L’hypothèse théodorienne propose donc clairement une contre-utopie ou, plus précisément, une utopie qui pourrait se passer de colonisation. Jean-Michel Racault a montré que l’espace utopique, et donc l’île, n’appartient ni à l’ancien monde ni au nouveau monde63. C’est donc un monde absent des représentations et des perceptions ; non cartographié et non arpenté. Dès lors, sa seule mesure ne peut être que celle de l’humain, celle des relations sociales, celle d’une volonté d’instaurer une souveraineté fondée, en dernier ressort sur le contrôle, le panoptique, ce qui en fait d’emblée une dystopie ; sur un espace pensé et organisé uniquement en fonction des humains, maîtrisé par rapport non à ses désirs, mais à ses besoins. Dans cette perspective, l’espace esclavagiste de l’habitation est une utopie en actes64. Or, c’est précisément à cela que répond le paradigme de l’île créole comme laboratoire du monde et comme matrice de l’humanité à venir en tant que Tout-Monde et que monde créole fondé sur la rencontre, la négociation, l’acceptation des différences, la prise en compte de l’autre en soi, comme soi ; comme métonymie de l’harmonie interculturelle. Mais, pour en arriver là, il faut récupérer ce qui a été soit dispersé, soit dénié. C’est cela qui explique le surgissement des textes liés à la mémoire du marronnage comme l’envers de l’habitation. Comme le signale Nadia Minerva,
L’utopie naît d’un sentiment tragique de l’histoire et du désir d’en diriger le cours. Confrontée à la dégradation du présent, la mentalité utopique est animée par une volonté de transformation. Après la mise en œuvre de la perfection rêvée, le dynamisme originaire subit un coup d’arrêt. Bloquée dans un éternel présent, l’utopie abhorre le devenir en tant que suite de situations changeantes et aspire à la stabilité parfaite du temps hors du temps65.
La poésie contemporaine tente, elle, de proposer, précisément, une utopie qui prenne en compte le devenir. Patrice Treuthardt, par exemple, pose une conjonction entre la Lémurie et le marronnage. Dans un poème intitulé « Lémuriale », il propose de remonter les mers :
pour raconter à nos petits-enfants
l’histoire des Lémures
de toutes les Marronnies
auxquels nul poète ne saurait résister66.
Et le poème se termine sur ces vers :
Je quête une île à me ruer dans les vavangues
Moi-Poète
Âme errante à renaître aux brandes de toutes cimes
Et au-delà
Où baillent les grands bés de songe67.
De même, la poétesse Barbara Robert, à partir d’une rêverie sur le nom même de Jules Hermann, imagine un devenir hermaphrodite des habitants, reprenant, mais dans le devenir, le mythe platonicien ou l’utopie de Guillaume de Foigny, La Terre australe connue :
Je viens du grand océan
JE
Hermaphrodéenne
En exposition
Herma(no)phrodite68
Dans cette perspective, l’utopie n’est donc pas figée dans le temps, ni celui d’avant ni celui d’après, elle est à accomplir dans un présent inscrit dans le devenir, comme le fait apparaître Boris Gamaleya à la fin de Vali pour une reine morte (1973) :
et je salue la reine aux noms inaccomplis69.
Ou, de manière encore plus nette, dans Les Langues du magma :
la mer
sans cesse comme un homme à lui-même rendu
qui se souvient de son possible dévasté70.
Mais ces propositions, malgré leur volonté d’inscrire le fait d’habiter dans le devenir et non pas seulement dans le passé ou l’avenir, ne peuvent pas faire l’économie de l’histoire violente de l’île et de sa spatialité tourmentée. Boris Gamaleya, Patrice Treuthardt, Nicolas Gérodou et Barbara Robert inscrivent non seulement la geste marronne comme ce qui est à réintégrer dans l’histoire mais aussi les déchirures internes de l’île dans son espace même. L’île apparaît comme un montage d’îlettes, un archipel intérieur qui inscrit dans le réel la séparation et indique, sinon l’impossibilité, du moins la très grande difficulté de la rencontre et de l’échange. Au lieu d’intégrer ou, à tout le moins, de faire converser les différences, l’île en îlettes les exacerbe, les exhibe, les oppose. L’altérité fonde ainsi l’espace insulaire qui s’efforce de la maintenir en retour. On est donc là dans une configuration dysphorique par rapport à celle que Jean-Michel Racault observe à propos de l’utopie classique : « Tournant le dos au monde imparfait du dehors, l’île se dédouble intérieurement en d’autres îles plus intimes, interpose entre sa perfection et l’hostilité pressentie de l’univers extérieur une succession de clôtures »71. Autrement dit, en tentant de se concrétiser dans le devenir, l’utopie créole secrète ses propres obstacles, y compris à travers la clôture qui l’instaure. Chez Bernardin de Saint-Pierre, dans l’île créole ou, plus exactement dans l’îlette cachée dans l’île créole, la solitude ne renvoie pas à la sauvagerie mais à l’humanité : « En vivant donc dans la solitude, loin d’être sauvages, elles étaient devenus plus humaines »72. Les personnages de Paul et Virginie sont cependant, parce que Créoles, indifférents « pour tout ce qui se passe dans le monde »73, « croyaient que le monde finissait où finissait leur île ; et ils n’imaginaient rien d’aimable où ils n’étaient pas »74. Toute mise en clôture est donc susceptible d’aboutir à un camp retranché. À propos du lieu retiré et inaccessible du château de Silling dans Les Cent vingt journées de Sodome, Annie Le Brun déclare : « Situation délibérément anormale qui exige le sauf-conduit de l’anormalité pour y parvenir »75. La référence à Sade, ici, peut paraître forcée. Or, comme le remarque fort justement Jean-Michel Racault dans son édition de Paul et Virginie, le méchant maître de la Rivière Noire dans Paul et Virginie, correspond au portrait d’un libertin sadien, non seulement en raison de sa totale absence d’empathie, mais aussi parce que l’acceptation de la demande de Virginie est fondée sur la possibilité qu’il entrevoit de la transformer en proie sexuelle :
D’abord l’habitant ne fit pas grand compte de ces deux enfants pauvrement vêtus ; mais quand il eut remarqué la taille élégante de Virginie, sa belle tête blonde sous sa capote bleue, et qu’il eut entendu le doux son de sa voix qui tremblait, ainsi que tout son corps, en lui demandant grâce […] il jura par un affreux serment, qu’il pardonnait à son esclave, non pas pour l’amour de Dieu, mais pour l’amour d’elle76.
Et Virginie en est parfaitement consciente, qui déclare à Paul qui lui propose d’aller demander de la nourriture à cet homme, « Oh non […], il m’a fait trop peur »77. Et un peu plus loin, elle le définit comme « cet homme si grand et si méchant »78, avatar colonial et insulaire du grand seigneur méchant homme. D’ailleurs, le récit que fait Domingue du traitement par la suite réservé par le maître à la « négresse marronne » n’est pas sans évoquer un tableau sadien : « il me l’a montrée attachée, avec une chaîne au pied, à un billot de bois, et avec un collier de fer à trois crochets autour du cou »79. C’est d’ailleurs ce terme qu’utilisera la tante de Mme de La Tour pour qualifier le mari de cette dernière : « un aventurier, un libertin »80. Et la mère de Virginie propose une conclusion intéressante : l’espace naturel du libertin est l’île créole, la colonie esclavagiste, ce « bon pays, où tout le monde faisait fortune, excepté les paresseux »81.
Si, selon Annie Le Brun, « le texte de Sade est d’abord une magistrale désacralisation de l’idée de communauté jusqu’à en établir l’impossibilité »82, quelque chose de ce genre se joue dans l’île créole. Dans Paul et Virginie, au moment même de son énonciation par le vieillard, et même avant le début du récit de celui-ci, à travers la vision que le narrateur premier Européen a du paysage de ruines qui s’étale sous ses yeux, le paradis qui va être décrit, où se rencontrent les plantes et fruits tant des Tropiques que d’Europe, où se mêlent tous les éléments, où les humains et la nature s’interpénètrent tellement que la description de Virginie la rend semblable à l’océan avec « ses yeux bleus et ses lèvres de corail »83, est déjà perdu. Cette perte est déjà mise en abyme par la destruction du jardin lors du cyclone84. Par ailleurs, les deux personnages féminins, Marguerite et Mme de la Tour, sont venus à l’île de France en situation de déchéance, de perte. Leur présence dans l’île est la conséquence de leur impossibilité d’être en France, de leur exclusion, à la fois sociale et spatiale, du lieu d’origine, de leur espace « normal ». En effet, le mari de Mme de la Tour, qu’elle a épousé contre la volonté de sa famille, lui était socialement inférieur. Mais surtout, celui-ci, nous dit le vieillard, « après avoir sollicité en vain du service en France, et des secours dans sa famille, se détermina à venir dans cette île, pour y chercher fortune »85. On est loin, ici, d’une posture de départ vers une quelconque île paradisiaque. De même, Marguerite, victime d’un prédateur sexuel proche des personnages sadiens, est venue à l’île de France pour fuir, sans retour, l’opprobre du monde :
Elle s’était déterminée alors à quitter pour toujours le village où elle était née, et à aller cacher sa faute aux colonies, loin de son pays, où elle avait perdu la seule dot d’une fille pauvre et honnête, la réputation86.
Le début du récit pose une situation d’espoirs déçus et brisés qui s’oppose à toutes les espérances de départ, y compris celle d’aller à Madagascar « dans l’espérance d’y acheter quelques Noirs et de revenir promptement ici former une habitation »87. La clôture créait, en effet, une sensation de sécurité hors de toute sensation d’enfermement, une sorte d’insularité positive. Comme le signale Jean-Michel Racault,
Ici, les murailles sont bien présentes, et elles favorisent une sorte de recentrement de la conscience sur elle-même, mais ce sont des composantes purement naturelles du paysage qui ne créent aucun sentiment négatif d’enfermement88.
Mais, d’entrée de jeu, la clôture qui instaurait et délimitait l’espace utopique a été détruite. Comme le déclare lui-même Bernardin de Saint-Pierre dans les Études de la nature, « L’histoire du maître gâte souvent celle du paysage »89.
L’envers de l’éden, c’est aussi l’espace des hauts, locus horribilis par excellence en raison de son climat et des marrons. Mais il faut aussi noter que dans l’espace prétendument édénique des bas – cet espace strié dont parle Marie-Ange Payet90, en opposition à l’espace lisse, nomade et rhizomatique des marrons, cet « espace d’intensités et de distances » – même les personnages de Bernardin de Saint-Pierre peuvent être « accablés de lassitude, de faim et de soif »91. Par ailleurs, les rôles et les fonctions y sont distribués en raison de la situation sociale, de « race » et de genre, y compris dans Paul et Virginie où Paul cultive le jardin pendant que Virginie se livre à des tâches ménagères :
Bientôt, tout ce qui regarde l’économie, la propreté, le soin de préparer un repas champêtre, fut du ressort de Virginie, et ses travaux étaient toujours suivis des louanges et des baisers de son frère. Pour lui, toujours en action, il bêchait le jardin avec Domingue, ou, une petite hache à la main, il le suivait dans les bois ; et si dans ces courses, une belle fleur, un bon fruit ou un nid d’oiseaux se présentaient à lui, eussent-ils été au haut d’un arbre, il l’escaladait pour l’apporter à sa sœur92.
Si l’éden a un endroit et un envers, si l’espace s’éparpille en îlettes de communautés impossibles qui s’affrontent les unes les autres alors même qu’elles « ne font pas » communauté, habiter une île créole relève donc de la gageure. Le poète Riel Debars fonde son œuvre tout entière sur une critique des utopies créoles, littéraires ou politiques et de l’utopie créole. Autrement dit, dans sa perspective, l’île est habitable – et non pas une pure utopie – à condition de déconstruire les utopies.
Boris Gamaleya, dans Vali pour une reine morte, postule une île en attente de plénitude et de clôture (« en ce temps là la reine en l’attente des rives »), attente nécessairement déçue par l’irruption de l’histoire concrète. Les noces attendues entre l’île et ses habitants se transforment en cauchemar :
lors fut grande ombre chue sur les troques fragiles
et mirage trahi au trouble des marines.
C’est de ce cauchemar que part Riel Debars, contre le discours des lendemains qui chantent qu’il dénonce, par exemple chez quelqu’un comme Alain Lorraine. L’île non réalisée, non habitée est devenue une « terre brûlée », un « carrefour de nulle part où mènent des portulans trafiqués »93, « ce n’importe où des antipodes »94. La venue même dans l’île ne correspond à aucun désir, à aucune recherche d’endroit où vivre, à aucun exotisme ; elle est tout simplement liée à des erreurs de navigation, à un déroutement. La déroute est ainsi au cœur et à l’origine de l’île créole, quel que soit l’endroit d’où l’on vient, quelles que soient les raisons et les conditions de l’arrivée. Plus que jamais, l’île est considérée comme un espace purement imaginaire, textuel, un fantasme qui ne renvoie à rien d’autre qu’à soi-même :
la splendeur des îles est un reflet
dans le regard des voyageurs95.
Le discours sur le passé est présenté comme une imposture96 et, pire, l’île est elle-même un non espace :
cet espace sans espace
au dessus d’un océan d’eaux mortes97.
Dès lors, l’éden n’est rien d’autre que le nom donné à une prédation, « l’inventaire établi d’un commerce possible »98 :
Toute île est à prendre
Pour qui sait abolir le désert
Cette île fut nommée avant que d’être prise
ÉDEN99.
Plus encore, l’éden est présenté comme une pure affabulation de l’esprit, quelque chose qui ne s’est jamais incarné, la négation même de la vie :
l’âge d’or n’a pas de corps
l’éden est un désert de vivre100.
Là où Raphaël Barquissau, Claire Bosse et Jean Albany faisaient de la civilisation la métaphore de l’être créole, « le miroir de l’âme créole » n’est plus, chez Debars, que « la hargne rustique des conquêtes »101, et l’utopie accomplie a pour nom l’esclavage : « les pasquinades de l’utopie accomplie/dégoulinent de chaînes »102. Le mythe de l’origine lémurienne est qualifié d’infamie, déconstruisant ainsi le discours hermannien sur l’ancienneté et la splendeur des généalogies créoles ; il n’y a plus désormais, ramenés au même niveau, que les chiens et les rêves103.
En fait, dans la poésie debarsienne, tout élément insulaire perd sa matérialité. Non seulement les habitants ne sont plus que des fantômes, des spectres104, mais l’espace insulaire lui-même n’est plus que liquide où tout se mêle et se confond, sans horizon, sans amarre :
à l’horizon l’océan
l’île et l’océan
pas même un désert et son socle de certitudes
à l’horizon une terre sans amarres
un monde d’avant l’homme105.
L’île créole devient ainsi la métaphore du navire, de tout navire : négrier, marchand, militaire. L’île n’est alors plus rien d’autre qu’une hétérotopie, au sens où l’entend Michel Foucault106.
Dans l’île créole, à en croire la littérature, une mimicry est à l’œuvre, où se joue, sans jamais être résolue, une dialectique entre identification et rejet, sécurité et menace, sentiment d’être soi et d’être étranger à soi, de ne jamais vraiment être soi sans jamais vraiment être étranger à soi non plus. Quelle que soit l’idéologie des textes, quelle que soit leur postulation, les récits et les poèmes de l’île créole indianocéanique montrent, signalent ou laissent apparaître un monde de violence et de terreur. Les constructions utopiques sont, en cela, une tentative d’y mettre fin ; de fonder un site habitable. En fait, à lire les textes des mondes créoles, on a l’impression que ces îles n’existent pas, n’ont jamais existé, n’existeront peut-être pas. L’énoncé le plus net de cette inexistence de l’île, de cette difficulté pour ses habitants à l’habiter, se trouve sans doute dans ce vers d’Aimé Césaire, « Je commanderai aux îles d’exister » (Cadastre). Mais peut-être pourrait-on dire de l’utopie ce que Gramsci dit de la crise : il y aurait utopie lorsque l’ancien refuse de mourir et que le nouveau n’arrive pas à naître. C’est peut-être cela qui caractérise une île créole : n’arriver ni à naître ni à mourir. Ou, si l’on préfère, ce qui caractériserait une île créole, c’est que personne n’arrive à adhérer au lieu tel qu’il est.